
Un couple musulman devant un groupe de muftis. Page d’un manuscrit dispersé de Gulistân de Sa’di
Inde vers 1610-1615.
Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Loi & justice page 2
Le règne des califes de Médine fut supplanté par celui des califes omeyyades en l’an 661 de notre ère (an 41 de l’hégire). Les nouveaux « seigneurs de l’islam » et leurs gouverneurs furent à l’origine du développement d’un certain nombre de traits fondamentaux du culte et du rituel des musulmans et ce, même si leur principale préoccupation était d’ordre politique. Ils représentent, dans ce domaine, la tendance « centralisatrice », et de plus en plus bureaucratique, d’une intervention méthodique contre l’individualisme bédouin et le caractère anarchique de l’ancien mode de vie des Arabes. Dans de très nombreux domaines, le règne des Omeyyades représente l’accomplissement – après l’intermède troublé du califat de Médine – des tendances qui s’étaient dessinées à l’époque ou Mahomet était lui-même le « commandeur des croyants » et le maître incontesté de la communauté musulmane. C’est sous les Omeyyades que la société islamique commença véritablement à se constituer, avec ce que cela implique de mélange intime du fait religieux et du fait socio-politique.
Les califes, sous ce règne comme sous les précédents, étaient surtout préoccupés par les guerres de conquête. Ils s’empressaient aussi de lever des impôts dans les territoires conquis et de verser des subventions en argent et en nature aux bénéficiaires arabes. C’était de la « razzia » organisée et codifiée. Nous trouvons des traces de ces opérations juridico-militairo-fiscales dans les documents administratifs de l’époque. On demeurait dans le contexte de la législation des califes de Médine mais l’environnement socio-politique avait changé radicalement.
Les Omeyyades n’intervenaient pas dans l’application de la loi du talion, telle qu’elle avait été confirmée par le coran. Ils s’efforcèrent tout au plus d’empêcher le retour des querelles tribales et établirent une comptabilité du prix du sang, conformément aux anciens usages. Par ailleurs, ils contrôlaient tant bien que mal l’application des châtiments purement islamiques, pas toujours en stricte conformité avec les commandements du coran.
Ce sont aussi les califes omeyyades qui nommèrent les premiers « juges islamiques » ou « qâdis ». La fonction de qädi (ou cadi) fut instaurée dans les nouvelles conditions issues de la conquête arabo-musulmane et tout d’abord dans les grands centres urbains du nouvel empire. Pour la nouvelle société arabe, l’arbitrage « à l’ancienne » n’était plus adapté, d’où le remplacement des « arbitres-devins » par le cadi islamique. La différence demeurait cependant subtile car la plupart des cadis étaient des devins. La principale différence résidait dans le fait qu’ils étaient nommés officiellement par l’administration du calife. Le cadi était donc un délégué du gouverneur, lequel, dans les limites fixées par le calife, avait toute autorité sur ses provinces, tant sur le plan administratif que sur le plan législatif et judiciaire. Il pouvait donc déléguer son autorité judiciaire à son « secrétaire juridique », le cadi. Le gouverneur, sorte de sous-dictateur, conservait évidemment le pouvoir de se réserver toute action judiciaire et, bien entendu, de révoquer le cadi sans avoir à s’en justifier.
Par leurs décisions, les premiers cadis furent les véritables fondateurs de ce qui allait devenir la « loi islamique ». Ils jugeaient en toute indépendance (du moins en principe) et en vertu de l’ « opinion juste » («ra’y »), se fondant sur la pratique coutumière qui, par la nature des choses, incluait les règlements administratifs et prenait en compte la lettre et l’esprit des commandements coraniques et autres normes religieuses. Et tandis que les problèmes juridiques n’avaient pas été islamisés au-delà du stade atteint par le coran, la fonction de cadi s’imposa comme une institution typique de la période omeyyade pour laquelle l’efficacité administrative et l’islamisation allaient de pair.
Un exemple typique de l’influence qu’exercèrent les premiers cadis sur le droit islamique est fourni par le code de procédure. Le coran n’avait pas seulement adopté l’usage des documents écrits en tant que preuve, il avait également promu le témoignage par serment dans certaines circonstances (sourate V). Le droit islamique a, comme nous l’avons déjà fait remarquer, rejeté la première disposition et contourné la seconde. Sans les premiers cadis, les commandements coraniques auraient sans douté été appliqués à la lettre. Toutefois, ils exigèrent constamment d’imposer des garanties à l’usage exclusif du témoignage comme preuve juridique.
La juridiction des cadis ne s’étendait qu’aux seuls musulmans. Les populations non musulmanes administrées par les islamistes conservaient le droit d’être jugées par leurs institutions traditionnelles, y compris les tribunaux rabbiniques et ecclésiastiques dont on sait qu’ils avaient largement doublé l’organisation officielle de l’empire byzantin. Les musulmans adoptèrent même certaines fonctions inconnues de la société arabe comme celle d’ « inspecteur du marché » (ou « agoranome ») qu’ils rebaptisèrent « âmil al-sûq » ou « sâhib al-sûq ». Plus tard, sous les premiers Abbassides, cette fonction d’inspecteur du souk donnera naissance au bureau islamique du « muhtasib ». De même, les musulmans empruntèrent à l’administration sassanide la fonction de « greffier ».
Au sein des communautés musulmanes implantés en Europe, on entend parfois dire que, puisque les musulmans de jadis permettaient aux non musulmans de conserver leurs structures juridiques, les Occidentaux devraient, de même, permettre aux musulmans implantés en Europe de se soustraire aux lois occidentales. C’est une forme de raisonnement particulièrement spécieuse qui plait aux jeunes musulmans cherchant à échapper à notre système législatif et juridique. Elle est cependant sans aucune valeur, primo parce que cet argument se fonde sur des faits appartenant à un passé lointain, secundo parce que les peuples non musulmans dont il est question étaient des peuples conquis et privés de leur autonomie politique. Or, à notre connaissance, les musulmans implantés en Europe sont venus s’installer chez nous de leur plein gré. Ils n’ont pas été « conquis » par les Européens. S’ils veulent absolument être régis par le droit coranique, rien ne les empêche d’aller s’installer en Arabie Saoudite ou dans n’importe quel pays régi par la loi islamique.
En règle générale, les cadis étaient choisis parmi les dévots. Ce n’étaient pas des juges professionnels. Ils avaient d’autres occupations au sein de la société islamique. A côté des devins, on vit cependant apparaître des personnes qui s’intéressaient aux problèmes juridico-religieux et qui y consacraient leurs loisirs. Leur intérêt pour la religion les amenait à étudier, seuls ou lors de discussions de groupe, tous les aspects que recouvraient l’islam, y compris le droit. Leur propos était d’imprégner la sphère juridique des principes religieux et éthiques tirés du coran.
Le raisonnement des cadis – qui exprimait naturellement leur opinion personnelle (ra’y) – constitue l’ébauche d’une sorte de jurisprudence islamique. Ils réalisèrent ainsi, à grande échelle et de façon beaucoup plus détaillée, ce que Mahomet avait tenté de faire avec sa communauté primitive de Yattrib (Médine). En conséquence de quoi, la pratique juridico-administrative de la période omeyyade se transforma en droit religieux de l’islam. En-dehors des liens personnels très étroits qui existaient entre les groupes de dévots et les cadis, le droit islamique n’est pas né de la pratique mais en tant qu’expression de la quête d’un idéal religieux.
Regardés comme des spécialistes de la loi religieuse, les cadis étaient considérés avec respect par le peuple mais aussi par les autorités en place et même par les califes. Ils devaient leur autorité et leur notoriété à leur souci de faire coïncider leur idéal de vie avec les principes de l’islam. Ils se tenaient le plus souvent en-dehors de la sphère politique, leur principale fonction étant d’émettre des avis sur ce qu’il convenait de faire dans telle ou telle situation. En d’autres termes, ils furent les premiers « muftis » de l’islam. Les conseillers juridiques des gouverneurs avaient fréquemment l’occasion de critiquer les actes posés par le gouvernement, de même qu’ils rejetaient de nombreuses pratiques populaires. Mais il se gardaient bien de s’opposer trop ouvertement aux califes et à l’administration en place.
Avec le recul du temps, l’ensemble de la période omeyyade fut considérée par les arabo-musulmans comme faisant partie du « bon vieux temps ». Cette idéalisation du passé sera la première manifestation d’une tendance qui conduira, quelques dizaines d’années après la chute des Omeyyades, à mener l’une des plus importantes opérations de fiction littéraire que le monde ait connu. C’est une opération qui relevait à la fois de la propagande, de l’autosatisfaction et de l’aveuglement. Elle produit encore ses effets nocifs en ce début du XXIe siècle !

Un couple musulman devant un
groupe de muftis. Page d’un manuscrit dispersé de
Gulistân de Sa’di
Inde vers 1610-1615.
Les groupes de cadis, croissant en nombre au fil des années, se transformèrent peu à peu (au IIe siècle de l’hégire) en ce que nous pourrions appeler des « écoles de droit », terme qui ne sous-entend cependant aucune forme d’organisation précise, ni même l’existence d’un ensemble de lois (telles que nous les concevons). Les cadis continuèrent d’être des personnes privées. On peut toutefois dire que la division des musulmans en deux « classes » - l’élite et le vulgus – date de l’émergence des premières écoles de droit islamique.
Les premières écoles de droit islamique apparurent bien évidemment à la Mekke et à Médine, mais aussi en Iraq (Kûfa et Basra) et en Syrie. Elles développèrent le droit coranique avec de nombreuses nuances et parfois même avec de profondes divergences. Dès le départ, l’interprétation des commandements coraniques fut « à géométrie variable ». C’est une des raisons qui expliquent l’apparition de nombreuses sectes et sous-sectes au sein de l’islam (que l’on doit d’ailleurs considérer globalement comme une secte religieuse). Pour plus de détails, on se reportera à la lecture du chapitre que l’Encyclopédie générale de l’islam (déjà mentionnée) consacre à la loi et à la justice.
Les anciennes écoles de droit islamique avaient cependant en commun un concept central dit de « la tradition vivante de l’école ». Il dominera le développement de la loi et de la jurisprudence islamique du second au VIIe siècle de l’hégire. Rétrospectivement, il apparaît comme la « sunna » (précédent bien établi), la « pratique » (« ‘amal ») ou l’ « ancienne pratique » (« amr qadim »). La « pratique » reflétait en partie les coutumes des communautés arabo-musulmanes ainsi que des éléments théoriques issus des principes religieux. Elle a fini par devenir la « sunna normative » ou « usage tel qu’il doit être ». Une divergence entre la théorie et la pratique se manifestait déjà à ce stade. La « pratique idéale » se situait dans la doctrine unanime des « docteurs religieux » représentatifs de chaque grand centre d’enseignement du droit coranique. Ce consensus - représentant le commun dénominateur de la doctrine élaborée à chaque génération – exprimait l’aspect synchronique de la tradition de chaque école. Il est significatif que le fondement réel de la doctrine de chaque école ne soit pas le consensus de tous les musulmans mais seulement celui des « docteurs de la foi ». Le rôle spécifique de la classe des « ‘ulemâ » (oulémas) dans la société musulmane fut établi à cette époque.
Le besoin de trouver une justification à ce qui s’était jusqu’alors fondé sur l’opinion de la majorité entraîna, à partir des premières décennies du VIIIe siècle de notre ère (IIe de l’hégire), le rejet de la tradition vivante. Ce processus débuta à küfa où le développement de la doctrine d’Hammâd b. Abi Sulaymân (mort en 738 de notre ère) fut attribué à Ibrâhim al-Nakha’i (mort entre 713 et 715). Les Médinois eurent recours à la même astuce et « rétrocédèrent » leur propre enseignement à d’anciennes autorités religieuses mortes au tournant du siècle. C’est ainsi que naquit le mythe des « sept juristes de Médine ». Au moment même où les « docteurs » de Kûfa attribuaient leur doctrine à al-Nakha’i, une autre doctrine de l’époque se voyait parée de l’aura de l’ « époque glorieuse des débuts de l’islam » (à Kûfa) en se trouvant attribuée à Ibn Mas’ud, un compagnon de route de Mahomet qui s’était installé dans cette ville iraquienne. Le mouvement s’amplifia et la plupart des « compagnons du prophète » devinrent identiquement les éponymes des écoles de Médine et de la Mekke. L’Iraq surenchérira dans sa quête de « solides fondements théoriques de la doctrine des anciennes écoles » lorsque le terme « sunna du prophète » passera – au début du IIe siècle de l’hégire – du contexte politique et théologique au contexte juridique, s’identifiant à la « sunna » proprement dite. Les Syriens s’emparèrent à leur tour de cette appellation pour en faire l’axiome selon lequel la pratique des musulmans découle directement de celle du « prophète ». Ce dernier avatar de la sunna n’impliquait pas encore l’existence des « hâdiths » (informations prétendument liées à la « tradition »). Mais il s’en fallut de peu de temps avant que naissent ces « traditions » ne fassent leur apparition et ceux qui les mirent en circulation furent nommés « traditionalistes ».
Sous les derniers Omeyyades, les écoles de loi étaient représentatives de l’opposition islamique aux pratiques populaires et administratives. Le groupe oppositionnel qui se développa au sein du clan des « traditionalistes » ne fit qu’accentuer cette tendance. Tant qu’un « compagnon du prophète » avait représenté l’autorité suprême pour la doctrine d’une école sur un point particulier, il avait suffi à une doctrine divergente de se mettre sous l’égide d’un autre compagnon d’autorité égale ou supérieure. C’est ainsi qu’à Kûfa, toutes sortes d’opinions minoritaires furent attribuées au calife Ali (qui avait fait de Kûfa sa capitale). Mais après que l’autorité du prophète ait été invoquée, une référence encore plus précise fut exigée. C’est ainsi que les « dires issus de la tradition » (hâdiths) firent leur apparition. Ils étaient présentés comme des sortes de compte rendus des témoins des actes et paroles de Mahomet, transmis oralement par une chaîne ininterrompue de « personnes de confiance ».
La principale thèse des « traditionalistes » était que les « traditions du prophète » surpassaient la « tradition vivante » de l’école. Les anciennes écoles commencèrent par opposer une vive résistance à cette « nouveauté » mais elles se retrouvèrent sans réelle défense face à l’agressivité des « traditionalistes ». Elles furent ainsi contraintes à exprimer leur propre doctrine sur des « traditions » supposées remonter jusqu’à Mahomet et à s’intéresser aux « traditions » produites (et généralement inventées de toutes pièces) par leurs opposants.
Telle est l’origine historique de la « fiction littéraire » découlant des « hâdiths ». Il n’empêche que ces « dires » constituent encore, de nos jours, le fondement du « code de vie » de la plupart des musulmans. Il est vrai qu’on ne leur a jamais dit la vérité à propos de leur religion. Dés leur plus jeune âge, ils ont été soumis à des pratiques relevant du lavage de cerveau et du bourrage de crâne. Et ils continuent, bêtement, à croire les balivernes qu’on leur enseigne à propos du coran et du « prophète » !
Lorsque les califes omeyyades furent renversés par les califes ‘abbassides (en 750 de notre ère), la loi islamique possédait ses caractéristiques principales et les premiers ‘Abbassides poursuivirent, en la renforçant, la politique d’islamisation de leurs prédécesseurs. Pour des motifs dynastiques et pour se démarquer des Omeyyades, ils se posèrent en protagonistes de l’islam, attirant à leur cour des spécialistes de la loi religieuse qu’ils consultaient sur les questions relevant de leurs compétences. Cet intérêt des califes pour les questions purement religieuses fut cependant de courte durée. Les premiers « docteurs de la foi » qui avaient formulé des doctrines en opposition avec les pratiques populaires et administratives ommeyades se coupèrent de la réalité. Les califes ‘abbassides et leurs conseillers ne furent pas en mesure d’entraîner l’ensemble de la société arabo-musulmane.
Cet effet secondaire de la « révolution ‘abbasside » se remarque tout particulièrement dans l’évolution de la fonction de cadi. Il n’était plus, sous les ‘Abbassides, que le secrétaire juridique du gouverneur. Généralement nommé par le calife – et jusqu’à ce qu’on le relève de ses fonctions – il devait se limiter à appliquer la loi coranique, sans jamais se mêler des questions politiques. Bien que théoriquement indépendants, les cadis devaient nécessairement s’appuyer sur les autorités politiques pour faire exécuter leurs jugements. Liés par les règles formelles du concept islamique de la preuve, leur incapacité à traiter les questions criminelles devint vite évidente. Et pourtant, sous les Omeyyades, ils avaient traité ces affaires comme relevant de leur compétence. La plus grande part des dossiers criminels fut donc prise en main par la police, échappant ainsi à la sphère d’application de la loi religieuse.
Les volontés centralisatrices des califes ‘Abbassides entraîna, par ailleurs, la création du poste de « premier cadi ». Ce fut d’abord un titre purement honorifique que l’on conférait au cadi de la capitale mais il se mua rapidement en « fonction » et le « premier cadi » devint l’un des principaux conseillers du calife. Il fut même chargé, sous l’autorité du calife, de la nomination et de la révocation des autres cadis. C’était une sorte de « ministre de la justice religieuse ».
Parmi les usages que les califes ‘Abbassides (et sans doute les derniers Omeyyades) empruntèrent à l’ancienne administration des rois sassanides, on peut mentionner l’institution dite « étude des doléances ». Elle avait pour mission d’étudier les dénis de justice, les actes illégaux posés par les cadis, les difficultés survenant dans l’exécution d’un jugement ou encore les injustices commises par des fonctionnaires. Ignorée des Arabes, cette forme de « cour d’appel » à la manière sassanide fut rebaptisée « al-nazar fi’l-mazâlim » (cours des doléances) et entra régulièrement en concurrence avec les cadis. L’existence même de ces « cours des doléances » - qui furent instaurées pour palier à l’insuffisance de la juridiction des cadis – indique que le système législatif de l’islam primitif était déjà en pleine décadence à la fin du VIIIe siècle de notre ère (moins de 200 ans après la mort de Mahomet). C’est là la preuve incontestable que le coran ne peut être regardé comme la base d’une législation digne de ce nom.
Depuis les califes ‘Abassides, une double administration judiciaire – l’une religieuse, l’autre profane – se retrouve dans la quasi-totalité des pays fortement islamisés. La concurrence existe toujours entre ces deux niveaux de compétence (ou d’incompétence !) et cette concurrence est source de nombreux conflits.
En France, le cas de l’île de Mayotte est un parfait exemple des problèmes que soulèvent cette rivalité. Et pourtant, dans le cas de Mayotte, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Cette île, bien que majoritairement peuplée de musulmans, fait partie du territoire français (donc européen) et ne relève que du seul droit « occidental » (français et européen). Il n’est pas admissible, dans ce contexte, que de prétendus « juges religieux » puissent s’opposer aux juridictions légales. Ils devraient être jugés pour subversion ou expulsés du territoire. On s’étonnera d’ailleurs du fait qu’il ait fallut attendre l’année 2003 pour imposer aux habitants de Mayotte le respect pur et simple du droit français, notamment en matière de mariage. Car de deux choses l’une : ou bien Mayotte est une terre française et le droit français doit y être appliqué sans aucune restriction ; ou bien l’on admet que le droit français ne s’applique pas intégralement aux habitants de Mayotte et, de facto, Mayotte n’est plus une terre française !
C’est sous les califes ‘Abassides que la fonction d’ « inspecteur du marché » se trouva définitivement adoptée par les arabo-musulmans. En plus de ses fonctions primitives, celui qui était à présent nommé « muhtasib » fut chargé de faire régner la moralité islamique. Il pouvait déférer en justice ceux et celles qui étaient accusés d’avoir transgressé la morale coranique. Il avait aussi le droit d’imposer des châtiments sommaires (sans autre jugement que le sien), notamment aux ivrognes et aux impudiques. Dans certains cas, il était chargé de couper les mains des voleurs pris sur le fait. Cette fonction d’inspecteur du marché se doublait donc d’un rôle de policier et de bourreau. Elle fut réinstaurée, sous sa forme quasiment primitive, par le régime des talibans d’Afghanistan. En Afghanistan, comme dans l’ancien empire arabe, la volonté d’imposer le pouvoir islamique de n’importe quelle façon avait abouti à créer des fonctions mêlant intimement la religion, la police et la « loi » mais qui ne répondaient pas toujours aux impératifs de justice, loin s’en faut.
Le calife, en sa qualité de « successeur du prophète et commandeur des croyants », avait évidemment un rôle primordial à jouer dans le développement des institutions censées rendre la justice en terre d’islam. Ses compétences étaient identiques à celles des « docteurs de la foi » et autres législateurs religieux. Il était supposé se plier aux exigences de la shari’a et il pouvait exposer son opinion personnelle au sein des écoles de loi. Le calife détenait le pouvoir judiciaire effectif (les cadis n’étant que ses délégués) et jugeait en dernier ressort. Mais il n’avait pas le droit de légiférer (puisque, selon le concept coranique, la loi émane de dieu, non des hommes). Il ne pouvait instituer des règles administratives que dans les limites de la shari’a, les cadis étant obligés de suivre ses instructions à l’intérieur de ces limites. Cette façon de concevoir les choses négligeait le fait que la législation des califes de Médine avait pénétré le tissu de la loi issue du coran.
Les califes suivants – ainsi que des souverains séculiers – établirent à leur tour de nouvelles règles. Mais bien qu’il s’agisse là de véritables « législations », ils continuèrent à parler d’ « administration » afin de contourner les interdits religieux. De cette manière, ils entretenaient la fiction que leurs « règlements » ne servaient qu’à appliquer et renforcer la « loi sacrée ». Cette ambiguïté, savamment entretenue par des artifices de langage, s’étendit à toute l’administration islamique pendant et après le Moyen Age (le nôtre, pas le leur). Parmi les exemples les plus frappants de cette sécularisation de la loi islamique, on peut citer la « siyâsa » des sultans mamelouks d’Egypte (loi qui s’appliquait spécifiquement à la caste militaire dirigeante) et, plus tardivement, le « qânûn-nâmes » des sultans ottomans. Ce n’est qu’au XXe siècle que des efforts réels ont été entrepris, dans certains pays islamisés, en vue d’adopter une législation strictement séculière et moderne. Mais cela ne s’est fait que dans les pays musulmans soumis à l’influence occidentale (comme les pays du Maghreb ou l’Egypte). Car, comme le mentionnaient (en 1970) les rédacteurs britanniques de l’ « Encyclopédie générale de l’islam » : « Mais l’idée que la loi, ainsi que les autres relations humaines, doivent être régies par la religion, est devenue une partie importante de la vision des musulmans arabes, y compris les modernistes ».
Nous pouvons même dire, au vu des évènements récents, que cette « vision des musulmans arabes » s’est propagée à l’ensemble du monde musulman sous l’effet insidieux de la propagande wahhabite (voir chapitre 6). Elle est aujourd’hui très en vogue au sein des communautés immigrées implantées dans le monde occidental. C’est l’un des principaux alibis des fauteurs de troubles et des terroristes.
Peu de temps après la révolution ‘Abbasside, l’Espagne islamisée fit sécession sous la férule d’un survivant du clan des Omeyyades, s’érigeant en califat indépendant. Il n’y a donc rien de bien étonnant à ce que la loi islamique, telle qu’elle fut appliquée en Espagne, ait été différente de celle qui prévalait dans la partie orientale de l’empire arabo-musulman.
En Espagne, le cadi – bien que n’étant qu’un simple juge religieux – fut appelé à siéger au « conseil » (« shûrâ »). Par ailleurs, l’institution nommée « cour des doléances » n’avait pas été instaurée en Espagne cependant que la fonction de « premier cadi » n’y fut créée que tardivement. Les « inspecteurs du marché » conservèrent leur dénomination en Espagne et leur fonction différait de celle du « muhtasib » oriental
La loi islamique ne fut cependant jamais appliquée de façon uniforme dans le monde musulman. On peut s’en convaincre en parcourant le mémorandum que le secrétaire d’Etat Ibn al-Muqaffa’ présenta au calife abbasside al-Mansûr peu avant d’être cruellement mis à mort (en l’an 756 de notre ère). Intelligent et très observateur, al-Muqaffa’, un Perse converti, n’hésitait pas à mettre en évidence certains aspects de la législation islamique, telle qu’elle était à son époque. Des aspects que les sources dites « conventionnelles » ne permettent pas d’observer. Ibn al-Muqaffa’ déplorait notamment les importantes divergences que l’on pouvait constater dans l’application de la justice et ce, au niveau de plusieurs grandes villes. Il relevait les mêmes incohérences d’un quartier à un autre et d’une école de droit à une autre. En conséquence, il conseillait au calife de faire réviser les différentes doctrines, de les codifier et de faire mettre en pratique ses propres décisions en vue d’une uniformisation. Il devait en résulter un « code » qui aurait été imposé aux cadis. Il devait pouvoir être révisé et adapté par les califes successifs. C’était un projet législatif cohérent qui s’inscrivait dans la ligne de notre conception moderne du droit tout en demeurant « islamique » dans son fondement.
Ce projet de code réservait au calife le droit de légiférer légalement et de donner des ordres à l’administration civile et militaire, toujours dans le respect du coran et de la sunna. Cette sunna, Ibn al-Muqaffa’ le savait parfaitement – était très largement fondée sur les règles administratives instaurées par les Omeyyades. Il en concluait que le calife devait être libre de codifier la sunna à sa convenance.
Le contrôle de l’Etat sur le droit (donc sur la religion) - tel que Ibn al-Muqaffa’ le concevait – était en parfait accord avec la tendance qui prévalait au début du règne des ‘Abbassides. L’islam « orthodoxe » refusait cependant de se trouver lié trop étroitement à la structure étatique. Il s’ensuivit que le droit islamique se développa en dehors de toute pratique. Mais à long terme, il exerça plus d’influence sur les esprits qu’il ne perdit de contrôle sur les corps des musulmans.
C’est vers la fin du IIe siècle de l’hégire que al-Shâfi’ fit prévaloir la thèse fondamentale des « traditionalistes » en droit islamique. Pour lui, la sunna n’était pas la pratique « idéalisée » telle que le voulaient les « docteurs ». Elle s’identifiait au contenu des « traditions » qui remontaient à Mahomet et ce, même si une telle tradition n’était transmise que par une seule personne à chaque génération (ce qui la rendait très suspecte – et pour cause – aux yeux des « docteurs » issus des anciennes écoles). Cette nouvelle conception de la sunna – la « sunna du prophète » - transcendait la conception de la « tradition vivante » qui avait prévalu jusqu’alors. Selon al-Shâfi’, le coran lui-même devait être interprété à la lumière des « traditions » et non l’inverse. Le consensus des « docteurs » ne lui convenant pas, il se raccrocha à l’idée selon laquelle la communauté des musulmans ne pouvait se mettre d’accord sur une erreur. Cette thèse spécieuse était suffisamment vague pour justifier le but qu’il poursuivait.
Un tel concept ne laissait aucune place à l’exercice discrétionnaire de l’opinion personnelle. Toujours selon la thèse d’al-Shâfi’, le raisonnement humain devait se réduire à faire des « déductions correctes » et à tirer des « conclusions systématiques » des « traditions ». En fait, il instaurait une véritable dictature intellectuelle, une dictature bien plus rigide, bien plus implacable que le furent le nazisme, le stalinisme ou le maoïsme.
En se ralliant aux thèses « traditionalistes », al-Shâfi’ tentait de couper l’islam de toute forme de développement naturel et continu. En cela, il copiait les rabbins les plus obtus et les plus conservateurs, ceux-là même qui sont à la tête des mouvement juifs dits « ultra orthodoxes ». Par contre, un concept aussi radicalement statique ne parvint jamais à s’imposer au sein des communautés chrétiennes (hormis quelques sectes très peu représentatives). Essentiellement dominé par un point de vue rétrospectif, donc passéiste, le raisonnement d’al-Shâfi’ ne pouvait conduire à des solutions satisfaisantes. Sa démarche était purement personnelle et ses disciples fondèrent très tôt l’école dite « personnelle » (« madhhab ») des Shâfi’is.
Les écoles de Kûfa et de Médine avaient, elles aussi, assisté à la formation de groupes et de cercles et, au début du IIIe siècle de l’hégire, le caractère purement géographique des anciennes écoles avait disparu. Il était remplace par des allégeances personnelles à un « maître » ou à une doctrine. Les Hanafis (disciples d’Abou Hanafi) et les Malikis (disciples de Mâlik), qui perpétuaient les anciennes écoles de kûfa et de Médine, ne modifièrent pas leurs doctrines par rapport à ce qu’elles avaient été avant l’intervention d’al-Shâfi’. Mais elles adoptèrent, au cours du IIIe siècle, en accord avec les Shâfi’is, une théorie juridique d’inspiration traditionnaliste. Elle ne différait de la thèse d’al-Shâfi’ que sur un seul point : elle revenait au principe du « consensus des docteurs » en le considérant comme infaillible (un peu comme l’infaillibilité du pape chez les catholiques romains). Cette théorie commune adhérait au principe d’identification de la sunna avec le contenu des « traditions du prophète » avec cette nuance que les règles juridiques tirées de ces « traditions » devaient être définies par le consensus des « docteurs », ce qui laissait toute latitude aux représentants des «écoles de les définir par eux-mêmes. Le fait que les Shâfi’is aient fini par accepter cette entorse à leur doctrine montre à quel point le concept du « consensus des docteurs » avait su s’imposer au sein de l’islam.
La loi islamique atteignit son plein développement au début de l’ère abbasside et ses institutions sont le reflet des conditions économiques et sociales de la société arabo-musulmane de cette époque. Un trait caractéristique de ce développement réside dans la manière dont fut traitée l’ « usurpation » de la propriété d’autrui, autrement dit le vol.
Les dispositions de la loi islamique du IIIe siècle de l’hégire tendent à protéger le propriétaire légitime de tout bien mais elles nous révèlent également que le vol et l’expropriation sont monnaie courante chez les arabo-musulmans. Elles nous indiquent, par ailleurs, que les cadis étaient incapables de réprimer ces délits. Le « waqf » ou « mainmorte » fut aussi définitivement réglementé à cette époque. Cette disposition pourrait remonter à une forme d’annuité déjà en usage à l’époque préislamique mais elle semble s’être imposée en tant que contribution à la « guerre sainte », ce « djihad » dont il est si souvent fait mention dans le coran. Elle trouva un écho favorable dans le souhait des classes moyennes musulmanes qui cherchaient à exclure les filles – et surtout les descendants des filles – du bénéfice de la loi coranique de succession. En d’autres termes, les musulmans aisés voulaient revenir à l’ancien système familial patriarcal. Ils voulaient aussi assurer le sort des « mawâlis » de manière à en faire des clients sûrs de la famille du fondateur. Ces deux objectifs étaient en total désaccord avec les intentions primitives des législateurs coraniques. Le « waqf » jouissait, d’autre part, d’un degré de sécurité très supérieur aux autres formes de tenure et son usage devint une garantie contre la confiscation. Il en fut de même pour une autre procédure accréditée par la loi islamique : la vente fictive ou « talji’a ».
Ces quelques explications paraîtront sans nul doute « obscures » au non initiés mais elles permettent de comprendre à quel point les méandres de la législation islamique sont tortueux. On comprend aussi que le coran et la sunna ne furent que des alibis commodes que les musulmans utilisaient – et utilisent encore - selon leurs convenances. Le traditionnaliste Ibn Qutayba (mort en l’an 889 de notre ère soit l’an 276 de l’hégire) alla même jusqu’à considérer que le mensonge et le parjure étaient justifiés lorsqu’il s’agissait, pour un musulman, d’échapper à l’injustice d’un souverain, à l’arbitraire des dévots ou à l’insistance d’un créancier à réclamer son dû. Un peu plus tard, le philologue Ibn Durayd (mort en 933 de notre ère) composera un traité relatif aux expressions « équivoques » à l’usage de ceux qui étaient contraints de prêter serment contre leur volonté et ce, afin qu’ils puissent « signifier quelque chose de différent de ce qu’ils semblent dire et qu’ils échappent à l’injustice de l’oppresseur ». On ne s’étonnera donc pas que les arabo-musulmans soient passés maître dans l’art de l’embrouille et des discours spécieux !
Nous pourrions aussi évoquer les omissions du droit islamique en ce qui concerne certains aspects commerciaux, notamment le commerce de gros. Mais nous ne nous étendrons pas outre mesure sur cet aspect mercantile du problème que l’on trouvera exposé dans l’Encyclopédie générale de l’islam.
La loi mâlikie founrit de bonnes informations en ce qui concerne les relations entre voisins, lesquelles sont régies par des groupes sociaux qui ne sont ni l’Etat, ni la province, ni la ville. C’est la famille qui prime et cette préoccupation de tout ramener à elle est renforcée par l’acceptation du fait accompli. La société envisagée par la loi islamique des premiers siècles était principalement urbaine. Néanmoins, ladite loi ne reconnaissait pas la cité en tant que telle. Elle n’attachait pas beaucoup plus d’importance aux différences de statuts sociaux entre musulmans libres (non soumis au régime de l’esclavage). Pour elle, seul le rang de l’époux devait au moins être égal à celui de l’épouse. C’est assez comique quand on sait que Mahomet était d’un rang très inférieur à celui de sa première épouse !
Dans une société au sein de laquelle l’activité économique la plus respectée n’était pas celle du producteur, mais celle du marchand, les moralistes tentèrent de relever quelque peu les fonctions de paysan et d’artisan mais sans jamais y parvenir (aujourd’hui encore, les arabo-musulmans continuent à mépriser le travail manuel, lequel est regardé comme « indigne »). Le commerce du drap était considéré habituellement comme la plus honorable des professions, avec celui des épices. C’était d’ailleurs les professions qui produisaient le plus de profit à l’époque où la loi islamique prit corps. Par contre, les professions de changeurs (agents de change comme nous dirions aujourd’hui) et de marchand de grain étaient discréditées. La première parce qu’elle risquait de transgresser les règlement compliqués en matière d’usure ; la seconde parce qu’elle entraînait une spéculation sur la hausse du prix de la nourriture. Cependant, les deux « commerces inférieurs » par excellence ont toujours été ceux du tailleur et du tisserand. Le mépris qui les touche n’a d’ailleurs rien de spécifiquement islamique. Il remonte bien au-delà des premiers temps de l’islam.
Le début de l’ère abbasside a donc vu la loi islamique se constituer et, à partir du IVe siècle de l’hégire (notre Xe siècle), les « docteurs » de toutes les écoles admirent que toutes les questions jugées essentielles avaient été discutées et réglées. Un consensus s’instaura progressivement et de telle sorte qu’à partir de cette époque, plus personne ne fut censé avoir les qualifications requises pour réfléchir de manière indépendant à la loi religieuse. L’activité des juges fit ainsi ramenée à l’explication, à l’application et à l’interprétation de la doctrine telle qu’elle venait d’être arrêtée, une fois pour toutes. Ce fut la « fermeture des portes de l’ijtihâd », de la réflexion indépendante sur la loi. Et de fait, la législation islamique, religieuse et profane à la fois, n’a plus guère évolué depuis mille ans, notamment dans les pays les plus islamisés, comme l’Arabie Saoudite.
Il faudra attendre le XXe siècle pour que la réouverture de cette porte soit timidement envisagée par un certain nombre d’oulémas et, dans leur foulée, par une partie de la société musulmane.
La rigidité de la loi islamique - nous devrions dire son « inaltérabilité » - est responsable du caractère dangereusement anachronique de l’islam. Elle a aussi et surtout eu pour effet de préserver la religion islamique du déclin qui a affecté les institutions politiques de l’islam. De ce fait, l’emprise de la loi religieuse est demeurée très forte sur les masses populaires, souvent très peu, ou très mal, éduquées. Elle n’avait d’ailleurs que peu d’influence sur le droit pénal, le droit financier, le droit constitutionnel et le droit militaire.
Le code de la famille et de l’héritage a toujours été, dans l’esprit des Arabo-musulmans, plus intimement associé à la religion que tout autre domaine. Cela découle du fait que c’est à ce code que la loi coranique a accordé le plus d’intérêt. Mais, dans ce domaine si spécifiquement islamique, la pratique a été suffisamment forte pour l’emporter sur l’esprit de la loi, voire même sur la lettre du droit religieux strict. C’est ainsi que le statut juridique des femmes – qui aurait dû s’améliorer en vertu de certains commandements coraniques – s’est finalement détérioré à cause des dispositions de la shari’a. Concrètement, ce ne sont pas les règles les plus importantes de la loi coranique qui sont les mieux observées par les musulmans, ce sont celles qui, d’une manière ou d’une autre, ont trait à la vie quotidienne. C’est ainsi que l’institution de la préemption s’avéra d’abord très populaire auprès des juristes. En Inde, elle sera même confirmée et garantie par les Britanniques, en 1772. Cependant, la shari’a n’y attache pas grande importance et des manuels détaillés décrivent les différentes manières de l’éviter. On peut dire la même chose du droit relatif aux contrats ou des règles régissant les transactions immobilières. Et fort curieusement, la jurisprudence islamique n’accorde que peu d’importance à la coutume en tant que source officielle de la loi, alors même que de nombreuses coutumes ont contribué à sa formation.
Au Maroc, dès la fin du Moyen Age, l’école mâlikie se développa dans un certain isolement par rapport au reste du monde islamique. Elle prit bonne note des conditions dominantes en reconnaissant que les conditions réelles ne permettaient pas à la théorie de se traduire telle quelle dans la pratique. En conséquence, elle préconisait qu’il valait mieux contrôler la pratique, dans la mesure du possible, plutôt que de la négliger totalement. Elle soutint alors le principe selon lequel « la pratique judiciaire (« ‘amal ») l’emporte sur la doctrine la mieux affirmée ». Cet « ‘amal mâliki » marocain n’est cependant pas une loi coutumière au sens strict du terme. Elle constitue seulement une alternative doctrinale jugée valide aussi longtemps que les conditions la rendent nécessaire.
En droit islamique, il faut donc imaginer les rapports entre la théorie et la pratique, non comme des sphères séparées, mais comme une interaction et une interférence mutuelle. L’assimilation d’apports non islamiques au cours des deux premiers siècles de l’hégire, tout comme celle de la pratique par la théorie au Moyen Age, ne sont que des étapes d’un même processus. C’est ainsi que fut établi un semblant d’équilibre entre la théorie et la pratique judiciaire, un équilibre délicat mais apparemment inébranlable dans une société fermée sur elle-même. Aussi longtemps que la « loi sacrée » reçut une reconnaissance formelle en tant qu’idéal religieux, les musulmans ne s’obstinèrent pas à ce qu’elle soit intégralement appliquée dans la pratique. Elle ne pouvait toutefois pas abandonner ses prétentions à être la seule théorie valide. Elle ne pouvait pas, non plus, admettre l’existence d’une loi séculaire autonome, ses représentants – les « oulémas » - étant les seuls interprètes supposés qualifiés de la conscience religieuse des musulmans et, pour tout dire, de leur conscience tout court. Le concept selon lequel la loi, en général et en particulier, doit être régie par la religion (autrement dit par une chimère) est demeuré un postulat fondamental de la société arabo-musulmane.
Cette conception théocratique de la société humaine est radicalement incompatible avec les notions de « libre arbitre » et de « peuple souverain » qui sont à la base de toutes les sociétés authentiquement démocratiques. Il en résulte que la société musulmane ne peut, EN AUCUNE FACON, se prévaloir de la démocratie. Par voie de conséquence, une nation qui se réclame de l’islam, de son « livre saint » et de sa « loi sacrée » ne pourra jamais être une nation démocratique.
Si la laïcité et la démocratie concrétisent la marche de l’homme et de la femme vers un avenir libéré des dogmes et des contraintes de l’esprit, l’islam est une machine à écraser la pensée individuelle, c’est une véritable drogue qui entraîne l’être humain vers les profondeurs de l’obscurantisme politico-religieux.
Le concept musulman selon lequel il ne pourrait y avoir d’autre loi que la « loi divine » est source de conflits incessants dans les pays occidentaux où les communautés issues de l’immigration entendent imposer « leur » loi partout et en toutes circonstances. D’autant que la « shar’ia » se veut intemporelle, définitive et universelle.
Ce très dangereux concept, nous devons IMPERATIVEMENT le combattre et le détruire, ce qui implique que nous combattions identiquement le prétendu « livre saint » qui en est la justification : le coran. Il ne peut y avoir la moindre place, dans un pays libre, pour le coran et la loi coranique.
Nous ne sommes pas les seuls, loin s’en faut, à avoir dénoncé le caractère fondamentalement antidémocratique de l’islam. Dès l’avènement de l’ « Ere des Lumières », les plus grands penseurs francophones ont mis en évidence les tares profondes de la religion mahométane. C’est ce que l'on constate en examinant, par exemple, l’excellente analyse de Jean-Louis Castilhon (1720-1793) ou encore la pièce de Voltaire, « [Le] fanatisme, ou Mahomet le prophète ». Ces textes du XVIIIe siècle démontrent, si nécessaire, que la dangerosité de l’islam n’a rien d’une nouveauté et que cette religion était déjà perçue comme une tare de l’humanité par les « Penseurs des Lumières ».
Beaucoup plus près de nous, voici que ce que l’on pouvait lire dans un ouvrage publié en 2002 par le « Service International de Presse » à Paris. Il s’agit d’un extrait du livre de Daniel Hourès « Les Arabes : islam et islamistes » consacré aux Arabes, à l’islam, à Mahomet et au coran.

![]()
L’histoire nous enseigne que de violents mouvements de « réforme religieuse » secouèrent le monde musulman. Tels celui des Almoravides au nord-ouest de l’Afrique et en Espagne (Xie siècle de notre ère), celui des Fulbes en Afrique occidentale (au XIXe siècle) et surtout celui des Wahhâbis d’Arabie (également au XIXe siècle). Tous ces mouvements se donnèrent pour objectif, dans les régions du monde où ils prirent naissance, de faire appliquer la loi islamique de façon exclusive et dans toute sa rigueur. Ils visaient, par voie de conséquence, à abolir le double système d’administration et de justice et à éliminer la loi administrative et coutumière. Ces mouvements s’essoufflèrent ou disparurent mais ils ont fait leur réapparition au cours du dernier quart du XXe siècle, sous d’autres appellations et toujours avec le même programme. Ils se sont notamment reconstitués autour des oulémas wahhabites d’Arabie Saoudite. Ce sont ces mouvements dits « réformateurs » qui poussent les populations musulmanes à la rébellion, à l’incivisme et au meurtre, toujours au nom du coran, de la shari’a et du djihad. Ussama ben Laden et ses sbires représentent l’une des tendances de ce mouvement qui affecte la quasi totalité de la planète en ce début du XXIe siècle.
Les titres et fonctions de la hiérarchie musulmane (par ordre alphabétique) :
AYATHOLLAH : de l’arabe « âyât allâh », signes d’Allah. Titre donné aux religieux qui, dans la hiérarchie chiite, occupent les rangs supérieurs.
CADI : de l’arabe « kâdi » : celui qui décide. C’est le juge qui tranche les différents en premier et dernier ressort. Il peut s’éclairer au moyen de la consultation juridique (fatwa) délivrée par la « mufti » mais il n’est pas obligé d’en tenir compte. A l’époque des califes de Bagdad, fut instituée la fonction de « premier cadi » (khâdi ‘l-khodât ») ou « juge suprême » qui avait essentiellement pour mission de proposer la nomination des cadis au calife.
CALIFE ou KALIFFE : de l’arabe « khalifa », vicaire ou lieutenant. Titre que prirent, après la mort de Mahomet, les souverains qui régnèrent sur les musulmans. Les successeurs de Mahomet, pour mieux affirmer que leur autorité spirituelle était le principe de toute autorité temporelle, se désignèrent eux mêmes comme les « successeurs du prophète et commandeurs des croyants » ou comme les « successeurs de l’envoyé d’Allah ». Les cinq premiers califes (Abou Bakr, Omar Ibn-el-Khattab, Othman Ibn-Affan, Ali fils d’Abou Talib et Hassan, fils d’Ali sont désignés sous le vocable de « califes orthodoxes ». Les derniers califes abbassides régnèrent en Egypte, sous la férule des Mamelouks. Le califat fut aboli définitivement lors de la conquête de ladite Egypte par les Ottomans (1517).
EMIR : de l’arabe « amîr », celui qui ordonne. Dans les premiers temps de l’hégire, ce titre désignait le chef du monde musulman (« emir el-moumenin »). Il était donc équivalent au titre de calife qui s’imposa par la suite. Après la création des titres de « sultan » et de « malek », le mot « émir » ne désigna plus que les petits princes et certains officiers de haut rang. Les descendants de Mahomet, qui se distinguent par le port du turban vert, continuent cependant à se parer du titre d’émir. Il a été conféré à Ussama Ben Laden en sa qualité de chef militaire.
IMAM : de l’arabe « amma », marcher en tête, précéder. Primitivement, ce terme désignait les conducteurs de caravanes. Puis il prit les sens de « guide », « modèle » ou « prototype ». En religion, il signifie « celui qui se tient devant les fidèles et dont ceux-ci imitent scrupuleusement les mouvements ». Par extension, il a parfois été utilisé pour désigner le calife. Pour d’aucuns, le premier imam fut Mahomet. Dans son sens moderne, ce mot désigne essentiellement « celui qui dirige la prière », du moins chez les musulmans sunnites qui n’ont pas de clergé organisé. Selon les mosquées, il peut y avoir un ou plusieurs imams. Notons encore que le titre d’imam est généralement conféré aux fondateurs des quatre rites dits « orthodoxes ». On l’utilise aussi pour désigner les théologiens qui font école, au sultan de Mascate et dans diverses autres circonstances. Ce terme a tellement de sens différents qu’il ne veut rien dire de précis, d’autant que n’importe quel musulman peut s’autoproclamer imam et diriger la prière d’une communauté. Il ne faut surtout pas assimiler le rôle d’imam dans une mosquée à celle d’un prêtre chrétien (curé ou pasteur) ou d’un rabbi juif. L’imam est plus proche du bedeau d’église que du prêtre. Même s’il bénéficie d’un certain prestige auprès des petites gens, il n’a aucune autorité religieuse.
KHODJA : voir « mufti ».
MALEK ou MALIK : titre donné aux rois musulmans. C’est aussi un prénom arabe très courant. Mâlek ben Anas (713-795), élève d’Abou-Hanîfa, fonda une école juridico-religieuse dans sa ville natale de Yattrib (Médine). On lui doit, sous le titre de « Al Mowatta », un recueil des usages de la société arabo-musulmane à ses débuts (premier siècle de l’hégire). On a souvent reproché à cet ouvrage d’avoir, par sa rigidité excessive, entravé toute forme de progressisme au sein de la société islamique. Les disciples de l’école malékite (ou mâlikite) sont nommés « malékia » ou « malékites ». La doctrine malékite est encore très vivace dans le Maghreb mais les vrais disciples de Mâlek, ceux qui adhèrent à la secte des Malékites, sont peu nombreux.
MOLLAH : voir « mufti ».
MUEZZIN : de l’arabe « mo’adhdhin ». Fonctionnaire subalterne chargé d’annoncer les cinq prière du haut d’un minaret. Les muezzins parcourent lentement la galerie circulaire en psalmodiant, d’une voix nasillarde, des phrases (toujours dites en langue arabe) qui signifient : « Allah est le plus grand » (trois fois), « J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah » (deux fois), « J’atteste que Mahomet est l’envoyé d’Allah » (deux fois), « Venez à la prière » (deux fois), « Venez à la meilleure des œuvre » (deux fois), « Allah est le plus grand » (deux fois), « Il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah ». L’office du muezzin aurait été imaginé par Mahomet lui-même. De fait, il remplaçait les cloches des églises chrétiennes dans les petites communautés musulmanes primitives. Une partie du message délivré par les muezzins doit être regardé comme une imposture car nul ne peut « attester » d’un fait dont il n’a pas été personnellement témoin.
MUFTI ou
MOUFTI : Interprète autorisé de la loi
musulmane. C’est une sorte de jurisconsulte qui énonce
des décisions juridico-religieuses nommés « fatwas »
ou « fétoûas ». En Algérie,
on a parfois donné le titre de mufti à des
fonctionnaires supérieurs du culte musulman. En Turquie, ils
sont nommés « khodjas »
et en Perse, on les désigne du nom de « mollahs ».
Le
« grand moufti » de Marseille tient son titre
de la tradition maghrébine et n’est, en fait, que le
recteur de la mosquée principale de la ville.
PACHA : du persan « bacha », altération de « padischah », souverain – Titre porté naguère par les principaux chefs militaires et gouverneurs de l’empire ottoman. Le mot « pacha » ne désignait pas une fonction particulière. C’était un titre honorifique assimilable à celui de « seigneur » chez les Occidentaux. Il s’ajoutait au nom de la personne à qui il avait été conféré. C’est ainsi que le général Mustapha Kémal fut appelé «Kémal Pacha » avait d’être surnommé « Ataturk ». A la guerre, les pachas se faisaient précéder d’un serviteur qui portait une ou plusieurs queue de cheval fixées en haut d’une lance. On distinguait ainsi la hiérarchie des pachas en fonction du nombre de queues (de une à trois). Les pachas « à trois queues » occupaient les plus hautes fonctions de l’empire. Ils étaient commandants en chef, ministres ou gouverneurs des provinces.
SULTAN : de l’arabe « sultan », pouvoir. Primitivement, ce titre fut conféré par les califes abbassides aux princes seldjoukides qui exerçaient, dans leur empire, un pouvoir temporel. Le premier sultan fut Toghrul-Beg. C’est le titre qu’adoptèrent ensuite les empereurs Turcs (jusqu’en 1923). Il fut aussi en usage au Maroc. C’est aussi le titre de dignité que se conféraient certains princes musulmans sans grande autorité (sultan de Zanzibar, sultan des Comores, derniers descendants de Gengis-Khan,…).
VIZIR : de l’arabe « vézir » - Titre conféré à un ministre dans un Etat musulman. La fonction de vizir est apparue sous les califes abassides quoique les musulmans, toujours habiles dans l’art de remonter le temps, prétendent que le vieux Abou Bakr fut le vizir de Mahomet. Dans l’empire turc, le titre de vizir était purement honorifique et tous les pachas à trois queues avaient le droit de le porter. Le grand vizir était le chef de l’administration ottomane. Il commandait aussi les armées de terre et de mer.
Dans le monde francophone, tout le monde connaît Iznogoud, le grand vizir qui veut devenir calife à la place du calife. On prétend que ce personnage de bande dessinée fut inspiré par Al-Mansour (ou Al-Mansor), ce vizir qui assuma le pouvoir effectif à l’époque où régnait le dernier calife omeyyade d’Espagne, le faible et poussif Hicham, véritable « calife d’apparat ». C’est Al-Mansour qui résista aux premières tentatives de « reconquista ». Il avait réussi à prendre le pouvoir à force d’intrigues et en séduisant la femme du calife. Sur les conseils des « juristes », il fit incendier la magnifique bibliothèque rassemblée par le calife Al-Hakam II (grand-père d’Hicham). Il fut tué en l’an 1002, au cours d’une campagne menée contre les chrétiens. Après lui, viendra le « temps des émirs » qui verra l’Espagne sarrasine divisée en un grand nombre de petits états dirigés par des émirs. En 1212, les chrétiens d’Espagne parviennent enfin à marquer des points contre les derniers chefs de la « guerre sainte » : les Almohades (avec à leur tête un sultan). Las Novas de Tolosa est reprise. Le dernier pouvoir musulman d’Espagne disparaît en 1268 tandis que le dernier bastion islamique, celui de Cordoue, s’effondrera lentement entre 1231 et 1492.
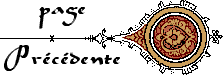 |
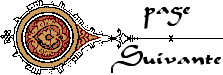 |