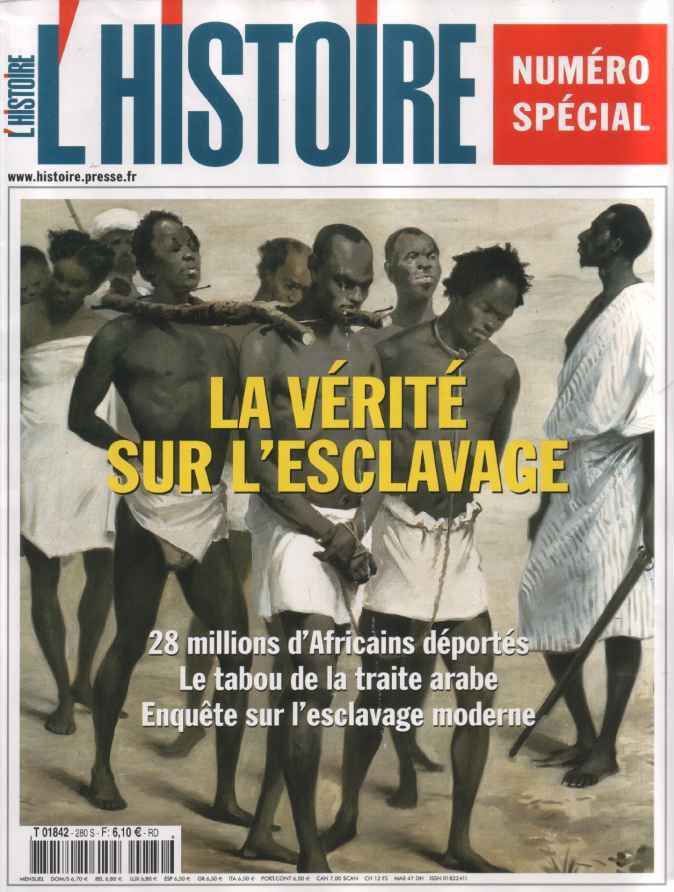
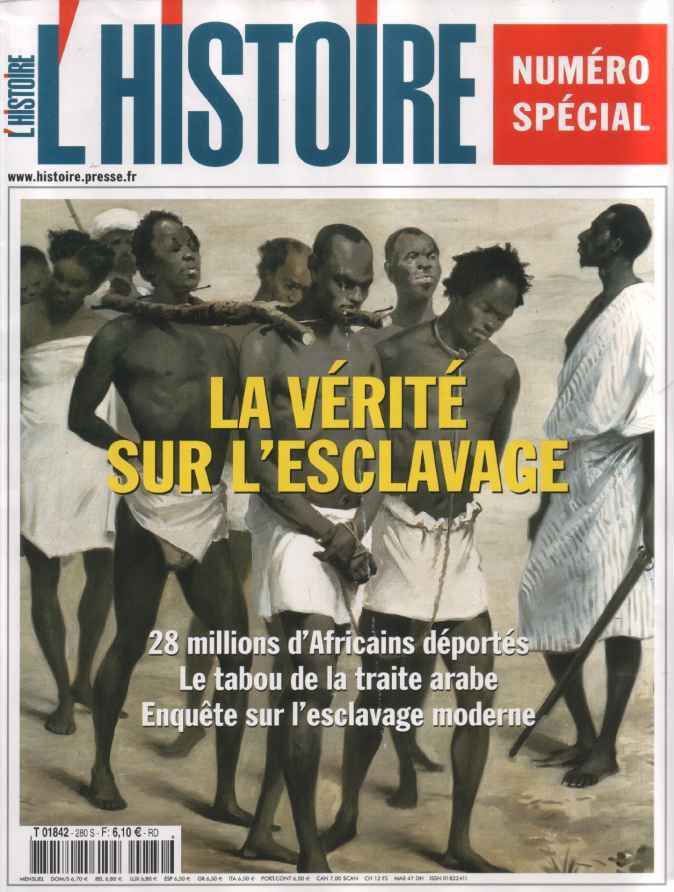
Le mensuel "L'histoire" (www.histoire.presse.fr) est publié par la société d'éditions scientifiques, 4, rue du texel, 75014 Paris.
Ce numéro 280 Spécial contient un dossier de 44 pages sur l'esclavage, dont un article de 8 pages "La traite oubliée des négriers musulmans".
Extrait :
L'AUTEUR
Olivier Pétré-Grenouilleau
est membre
de l'Institut
universitaire
de France. Il
vient d'achever
Les Traites
négrières. Essai
d'histoire globale
(a paraître
chez Gallimard).
La traite oubliée des négriers musulmans
Entre le VIIe et le XIXe siècle, environ 17 millions d'Africains ont été razziés
et vendus par des négriers musulmans. Un épisode aujourd'hui méconnu, resté tabou.
Il s'agit pourtant du plus grand trafic d'hommes de l'histoire.
La traite* négrière est inévitablement associée au grand trafic
transatlantique organisé à partir
de l'Europe et des Amériques,
qui a conduit à la déportation d'environ
11 millions d'Africains en Amérique (cf.
Philippe Haudrère, p. 56). C'est oublier,
d'abord, les traites internes, destinées à
satisfaire les besoins en main-d'œuvre
de l'Afrique noire précoloniale. Elles
auraient pourtant concerné, si l'on applique les méthodes de Patrick Manning, au
moins 14 millions de personnes1. C'est
oublier ensuite les traites « orientales »,
qui alimentèrent en esclaves* noirs le
monde musulman et les régions en relation avec ses circuits commerciaux.
Ces traites sont mal connues. Leurs
évaluations chiffrées font l'objet de nombreuses erreurs. C'est l'historien améri-
cain Ralph Austen2, le meilleur spécialiste
de la question, qui nous fournit les données les plus solides sur le sujet1 Selon lui,
17 millions de personnes auraient été
déportées par les négriers* musulmans
entre 650 et 1920.
Au total, à elles seules, les traites orientales seraient donc à l'origine d'un peu
plus de 40 % des 42 millions de personnes
déportées par l'ensemble des traites
négrières. Elles constitueraient ainsi le
plus grand commerce négrier de l'histoire.
Pourtant, mis à part les travaux - en leur
temps pionniers - de François Renault, le
sujet est le plus souvent à peine effleuré
par les chercheurs français.
Pourquoi un tel oubli ? Il existe une
tendance à dédramatiser le rôle et l'impact des traites orientales, à en minimiser
la dureté.
Cette « légende dorée » de la traite
orientale est d'une part une forme de
réaction à la « légende noire » véhiculée
par les explorateurs européens de la fin du
XIXe siècle. Leur but était d'abolir la traite
en Afrique : ils ont donc parfois exagérément noirci la réalité des traites orientales, insistant sur la cruauté des négriers.
D'autre part, la recherche se heurte
dans ce domaine à des tabous. « Pour le
moment, écrivait Bernard
Lewis en 1993, l'esclavage en
terre d'islam reste un sujet à la
fois obscur et hypersensible,
dont la seule mention est souvent ressentie comme le signe d'intentions
hostiles3. » Analysant des manuels scolaires
du monde entier, Marc Ferro écrivait en
1981, à propos d'un livre de la classe de
quatrième utilisé en Afrique francophone :
« La main a tremblé, une fois de plus, dès
qu'il s'agit d'évoquer les crimes commis par
les Arabes [...] alors que l'inventaire des crimes commis par les Européens occupe, pour
sa part, et à juste titre, des pages entières4... »
Un déni qui s'explique aussi par des raccourcis idéologiques dépassés, comme la
« solidarité » affichée entre pays d'Afrique
noire (parfois musulmans) et monde
musulman, du fait d'une commune marginalisation à l'époque de la bipolarisation
Est-Ouest, ou du sentiment de ne faire
qu'un seul dans un « Sud » défavorisé, par
opposition à un « Nord » développé.
Le tout est renforcé par des témoignages insuffisamment passés au crible de
la critique. C'est le cas de celui d'Emily
Rùete. Née Salmé bint Saïd, cette fille
du sultan de Zanzibar et d'Oman (1791-
1856) a dû quitter l'île de l'océan Indien
pour épouser un commerçant allemand,
Heinrich Ruete. Dans ses Mémoires,
publiés en allemand en 1886, elle écrivait :
« [il] ne faut pas comparer l'esclavage oriental à celui qui existe en Amérique [car, pour
le premier,] une fois arrivés au terme du
voyage, les esclaves sont généralement bien
traités sous tous les rapports.5 »
De nombreux facteurs ont également
contribué à minorer l'ampleur des traites
orientales par rapport aux traites occidentales. Certains tiennent à l'histoire.
La colonisation de l'Afrique noire par
l'Europe ayant suivi (d'un petit demi-siècle quand même) la fin du trafic atlantique, les deux événements
sont parfois assimilés, rendant les réalités négrières
encore plus criantes. Inversement, l'influence des pays
d'islam, pourtant parfois plus profonde
que celle de l'Europe, fut plus diffuse et
souvent plus intériorisée.
Il est vrai aussi que la traite orientale
comportait des caractéristiques qui en
réduisaient la visibilité : elle se déroulait
en partie à l'intérieur du continent africain (alors que le trafic occidental faisait
passer les esclaves d'un continent à un
autre)
(...)