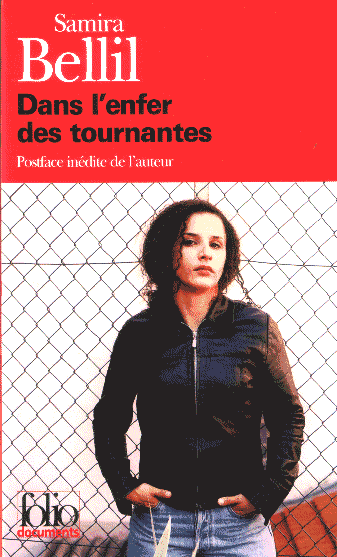

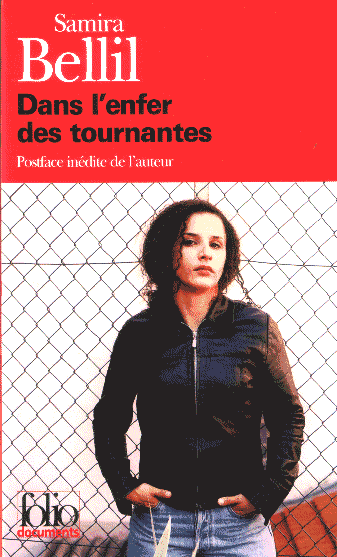 |
 |
"Dans l'enfer des tournantes" a été publié par Samira Bellil en 2003 aux éditions Denoël.
ISBN 2-07-042990-3
Mahomet |
| Samira Bellil était devenue éducatrice en Seine Saint-Denis. Elle est décédée d'un cancer le mardi 7 septembre 2004 à l'âge de 33 ans. |
Epitaphe musulman :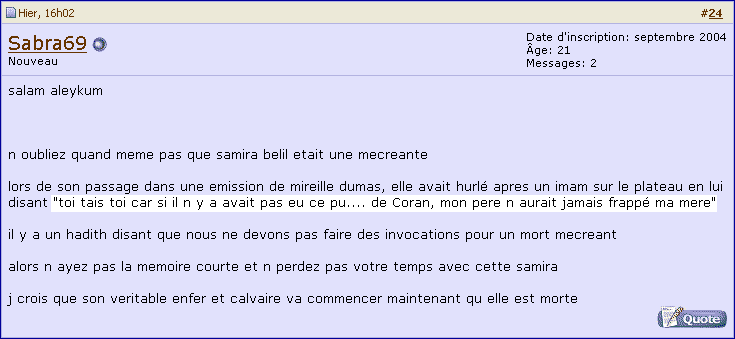
Source : http://www.mejliss.com/showthread.php?t=158277
On assiste, depuis les années 80, à la montée en puissance du phénomène de bande, avec une idéalisation de la figure du petit caïd pour lequel le nombre de viols en réunion, les « plans pétasse », comme il les nomme, est un titre de gloire. Le film La Squale a mis à l'écran et révélé au public la pratique de la « tournante », au cours de laquelle un garçon fait « tourner » sa petite copine.
Ce livre est un livre coup de poing. Il nous jette à la figure ce phénomène de société qu'est, dans certaines cités proches de nos grandes villes, la violence sexuelle instituée et banalisée. La sexualité aujourd'hui s'y résume, bien souvent, à des rapports de force et de domination. La loi qui y règne est celle du plus fort contre le plus faible : la loi de la jungle.
Ce livre lève le voile sur la condition insupportable de certaines jeunes filles qui y vivent, tiraillées entre deux servitudes : obéir en restant enfermées à la maison ou risquer, dans la rue, de devenir la proie des bandes et de leur sauvagerie sexuelle.
Samira est une rescapée. Elle a été victime de deux viols collectifs à quatorze ans, puis d'un troisième à dix-sept ans. Elle a vécu une adolescence ravagée, tenaillée par la honte, la culpabilité, le rejet de tous et la peur d'autres agressions. Écrasée de souffrance, d'incompréhension et de solitude, elle n'a pu réagir que par la violence et les délits, les galères et les fugues. Elle s'est progressivement détruite jusqu'à devenir un petit animal sauvage, une charge de dynamite.
En 1998, la police a arrêté 994 mineurs accusés de viols collectifs sur mineures. Selon l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes, seuls cinq pour cent des viols commis sur les femmes majeures feraient l'objet de plaintes. On ne connaît pas les statistiques en ce qui concerne les filles mineures, mais on sait que très peu osent porter plainte. La honte et la peur des représailles les poussent à garder le silence. C'est pour cette raison que la justice commence seulement à être saisie de crimes de ce type. Bien des responsables continuent de se voiler la face, affirmant que ce sont des phénomènes isolés et que la misère sexuelle se trouve partout.
Il semble que dans ces quartiers que l'on dit pudiquement « sensibles », où la majorité des familles est issue de l'immigration, il soit difficile de donner sa place à la femme. Certains jeunes sont pris dans une contradiction entre le rigorisme de leurs origines culturelles (intégrisme religieux, intouchabilité de la femme, polygamie...) et un environnement culturel très fortement érotisé. Le flirt est proscrit, l'amitié fille-garçon aussi, et la tension sexuelle est exacerbée. La seule éducation sexuelle que reçoivent ces jeunes est celle des films pornographiques, ils n'ont aucune autre image de la relation amoureuse. Ces adolescents n'ont plus aucun repère et ils n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Pour eux, la « tournante » est un jeu et les filles, des objets.
Les jeunes filles abusées deviennent aux yeux des garçons et de toute la cité des « filles à cave » sur lesquelles tout est permis. La violence qui est faite aux filles n'est pas que physique. En plus du traumatisme du viol, elles ont à affronter la violence morale qu'est une réputation brisée, la honte, l'humiliation et la peur des représailles si elles osent porter plainte.
C'est cet enfer que Samira a vécu mais, alors que tant d'autres ont sombré dans la drogue, la prostitution ou la folie, elle a réussi un rétablissement exemplaire et est à vingt-neuf ans une jeune femme pleine de vie et de promesses.
Extrait du Chapitre 1 :
À partir du moment où j'ai rencontré Jaïd, j'ai quand même terriblement changé. Pour les éducateurs, les assistantes sociales et mes parents, je suis passée en un an et demi d'une enfant difficile à une enfant irrécupérable. Le temps de ma relation avec Jaïd.
Bon, maintenant que le décor est planté, je reviens à ce fameux jour où je suis arrivée devant la bande avec mes Weston chourées.
Je marche avec mes Weston aux pieds : « Putain, elles sont trop terribles ! » Après toutes ces fugues, cela fait assez longtemps que je ne suis pas rentrée chez moi. Ce soir, je me dis qu'il ne faut pas abuser, que je rentre, un peu à contrecœur, un peu trop tard, mais je rentre.
Toute la clique est là avec Jaïd, ils sont à la barrière. Tout le monde kiffe sur mes pompes, Jaïd aussi. Il m'adresse la parole, et je ne vois plus que lui.
« Ça va ?
- Ça va.
- T'as une cigarette ? » Je lui en tends une. « Bien, les Weston !
- Merci.
- Tu viens ? »
Avec ces deux mots d'un banal pathétique, je suis aux anges. Ah, je n'étais pas exigeante ! Pas la moindre affection, pas la moindre tendresse! Il me traitait comme un chien, et je nageais dans le bonheur.
Il me dit de venir, je le suis, comme envoûtée. Il m'entraîne dans sa cave. C'était une cave aménagée avec un canapé, qui sentait l'essence et le moisi. J'ai appris plus tard que j'étais loin d'être la seule qu'il attirait ici.
« Elles sont méchantes tes Weston, petite taille, en plus, ça fait stylé ! »
J'avais un peu peur qu'il me les vole pour les revendre, mais un mec ne fait pas cela à sa meuf! J'étais loin de me rendre compte que ce qu'il me faisait était mille fois pire...
Il m'attire à lui. Il m'embrasse. Je kiffe à mort :
les pompes d'abord, puis Jaïd qui est là. Quelle belle journée! Après m'avoir fait «l'amour», après s'être soulagé plutôt, il me laisse repartir.
Je suis tellement triste, aujourd'hui, d'avoir eu si peu de lucidité. Je me sens salie et honteuse d'avoir accepté une telle misère. Se faire tout bonnement sauter dans une cave sinistre, puant l'essence et la merde, sur un canapé pourri avec un vrai fils de pute. C'était lamentable, c'était sordide. Et moi, pauvre abrutie, je me croyais aimée et je nageais dans le bonheur.
Quand je sors de la cave, la clique est toujours à la barrière. Il y en a un qui m'appelle pour une dope, je m'approche pour la lui donner. Il m'explose à la gueule en me sortant une embrouille qu'il invente pour m'attirer vers eux. Pendant que j'essaie de comprendre ce qu'on me veut, les autres arrivent vers nous. Je ne vois pas Jaïd.
Je me prends une baffe sans comprendre pourquoi. Je sens ma joue qui chauffe. J'essaie de répliquer, mais je n'en ai pas le temps, un coup de pompe dans le dos m'a précipitée à terre. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Dix minutes plus tôt, nous rigolions ensemble, maintenant je suis face à des bêtes furieuses qui s'acharnent sur moi. J'entends : « Ferme ta gueule ! » pendant que sept ou huit enragés me défoncent la tête, en réclamant leur part. Ils veulent que je leur fasse une petite « gâterie » à chacun. J'ai de plus en plus peur. Je sens que je vais y passer, pourtant j'essaie de tenir autant que je le peux, malgré les coups qui pleuvent de tous les côtés. J'en reçois sur les jambes, sur le dos, sur le ventre, sur le visage. Je m'accroche, je me débats, je me défends de toutes mes forces. Tout à coup, j'entends une voix qui leur dit d'arrêter. C'est Jaïd? Non, à ma grande surprise, c'est son copain, son meilleur pote : K.
K., c'est une masse, une masse pleine de muscles, une bête sauvage en puissance. Il est immense avec un cou de taureau, des yeux globuleux et d'énormes mains faites pour assommer. On dit que c'est un vrai boucher, un dingue. Il inspire une véritable terreur et tout le monde évite d'avoir affaire à lui. C'est le champion toutes catégories du mal. Il a déjà tué quelqu'un d'un coup de poing et s'en est sorti en arguant la légitime défense. Un jour, je l'ai vu forcer un mec à en frapper un autre, sans raison, en le menaçant de le démolir s'il ne s'exécutait pas. K. avait plusieurs fois essayé de me parler, de rigoler avec moi, mais j'avais si peur de lui que j'esquivais à chaque fois. Après que K. a crié, les coups s'arrêtent enfin, mes agresseurs me lâchent. Je suis sauvée. Le cauchemar est termine. Pleine de reconnaissance, je remercie K.
C'est alors qu'il me donne un énorme coup de poing, il me relève par les cheveux, me traîne, puis me fait comprendre d'arrêter de crier et de le suivre. «Barrez-vous», dit-il aux autres. Les autres se dispersent. Plus je crie, plus il me frappe. Complètement sonnée, abasourdie, terrorisée, j'obéis. Nous arrivons vers la nationale, il me tire par mes vêtements pour me forcer à le suivre. Je suis morte de peur, je le supplie de me laisser tranquille, de me laisser rentrer chez moi. Je lui parle, j'essaie de le raisonner. Il est complètement insensible à mes paroles, il ne m'entend même pas. À un moment, je parviens à m'extirper de son emprise, je cours de toutes mes forces. Je suis complètement affolée. J'essaie d'arrêter une voiture. Je crie, je hurle qu'il faut m'aider mais les voitures tracent, sans prêter attention à moi. Excédé par mes hurlements, K. me frappe encore, de toutes ses forces. Je prends des droites dans la figure, qui m'assomment littéralement. Je pleure d'épuisement, d'impuissance, de douleur. Mon visage est inondé de mes larmes et de mon sang. Il n'a aucune pitié pour moi, il continue à me frapper jusqu'à ce que je n'aie plus la force de réagir, jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y a pas d'autre issue pour moi que de le suivre, si je veux garder une chance de rester en vie.
J'obéis donc. Je le suis, flageolante, épuisée par cette lutte inégale et vaine. Tout au long du trajet, il me frappe par rafales, pour entretenir ma peur et ma passivité. Il ne dit pas un mot. Tout en le suivant, j'essaie quand même de chercher une solution pour me sauver. Je sens que je n'en ai plus la force, car mes jambes sont complètement coupées par la terreur.
C'est terrible, la peur. Ça vous fait perdre tous vos moyens, ça vous coupe les jambes et le souffle. C'est comme une paralysie de tout l'être : le corps et l'esprit sont annihilés. Combien de personnes me diront plus tard : « Moi, j'aurais fait cela à ta place... On peut toujours se défendre... Surprendre l'agresseur, lui mettre un coup de pied dans les couilles... », etc. Combien j'en ai entendu de ces petites phrases assassines qui me trouaient de culpabilité, de ces commentaires sans pitié faits par des gens qui n'ont jamais été sous l'emprise de la vraie peur.
Nous finissons par arriver au pied d'un immeuble, puis montons au troisième étage. Nous nous arrêtons devant une porte sombre : j'ai le temps de lire le nom qui y est inscrit. Nous sommes dans un appartement propre, décoré sobrement, dans les tons beiges, avec un grand canapé marron en arc de cercle. Il y a une télévision, une vidéo, le sol est moquette : c'est simple et plutôt confortable. K. a compris qu'avec les coups qu'il m'a mis dans la figure, je ne vais plus crier, alors il me parle comme si de rien n'était :
« Dis donc, elles sont mortelles, tes pompes... T'as pas la dalle ? Si tu veux manger un morceau ou boire un coup? Alors, tu t'la donnes avec Jaïd?»
Je ne comprends rien à son comportement. Je suis dans une panique sans nom. Où veut-il en venir ? Pourquoi me parle-t-il maintenant calmement après m'avoir tabassée il y a quelques minutes ? Je reste pétrifiée, assise sur le canapé. Tout en l'écoutant, je regarde partout. J'essaie de me souvenir de tout. Je me dis : « Regarde, rappelle-toi, on ne sait jamais, si un jour on t'interroge, tu auras peut-être besoin de ces indices... »
Je m'entends répondre à ses questions. Que m'arrive-t-il ? Comment puis-je accepter pareil dialogue ? En fait, je donne le change. J'ai trop peur de recevoir d'autres coups. Mon attitude me donne la sale impression d'être consentante, mais que puis-je faire d'autre, si je ne veux pas mourir ? Des années durant, je me suis torturée avec cette pensée. Je me sentais coupable de cette allure de consentement. Je sais aujourd'hui que je n'avais pas le choix. J'essayais de sauver ma peau.
« Va te laver ! La douche est là ! Et lave-toi à fond en bas ! » me dit-il en me jetant une serviette. Il me regarde pendant que je me lave, pour voir si je fais bien ce qu'il m'a demandé. Je me tais, mais j'ai la rage. Fils de pute, enculé ! Il me prend pour une crasseuse. Moi, mon pote, même en fugue, je me suis toujours débrouillée pour être propre !
Je sors de la douche. II me dit de venir près de lui. Il se dirige vers le magnétoscope, enclenche une cassette. C'est un film X, « Tu mates et tu fais pareil ! » J'exécute tout ce qu'il me dit de faire. J'ai envie de vomir, mais je me retiens. J'ai peur de prendre encore des coups. Je suis « gentille » pour en finir au plus vite et rentrer.
Alors que j'exécute ses ordres comme un auto» mate, je me réfugie de toutes mes forces dans ma tête. Je la fais travailler à mille à l'heure. Je comprends très vite que c'est le seul endroit qui me reste. Le seul où je peux me sauver. S'il a mon corps, il n'a pas ma tête. Ma tête reste à moi seule.
Alors je pense à mes parents, à mes sœurs qui dorment. Je pense à tout ce qui fait ma vie... Et puis je revois ce nom sur la porte. Je m'y accroche. Je fais venir des images : ma copine Sofia, l'école, les vacances en Belgique, maman Josette, etc. Tout. Plutôt que de sentir ce souffle, cette odeur, cette peau. Il n'est pas question non plus de penser même un seul instant à ce qu'il me fait subir. Je ne veux pas de cette réalité-là, et à force d'habiter ma tête, je parviens à me dissocier de ce que « vit » mon corps, Il n'est plus à moi. Ça se termine enfin. Je ne saurais pas dire combien de temps tout cela a duré. J'espère pouvoir partir, mais voilà qu'il m'emmène dans une chambre au fond du couloir. Il y a des posters partout et des lumières rouges. Il me dit de me coucher sur le lit et il m'enferme. Allongée dans le noir, j'attends sans savoir ce qui va se passer. Je reste là les yeux ouverts. J'entends mon cœur qui prend toute la place dans ma poitrine et dans la pièce. Je crève de trouille, je crois qu'il va me tuer. J'entends du bruit. Une porte se ferme. Puis je perçois des murmures. La porte de la chambre s'ouvre : un autre gars entre avec K. Je ne le connais pas. Il est petit, avec beaucoup de cheveux, et bien moins costaud que K. Il ne dit pas un mot. K. est seul à parler. « Tu vas te laisser faire ! Fais pas la conne, hein ? T'as juste à être gentille ! » Et voilà que ça recommence. K. me force à faire des trucs à son pote.
Je n'en peux plus de toutes ces saloperies. Ça me tord les tripes, ça me retourne le ventre et le cœur. Je ferme les yeux très fort. Je fais ce qu'on me dit de faire, comme un automate. Je ne résiste pas, je suis une espèce d'esclave, je suis une merde, une rien du tout entre leurs mains. « Tu m'fais pas bander, sale pute ! » me dit-il, et il me force à y remédier. Il pue, il me dégoûte, j'ai la nausée. Je voudrais les vomir et me vomir moi-même. Mais j'ai peur des coups qui peuvent repleuvoir d'un instant à l'autre, alors je m'exécute, labourée de peur et de haine. Je supplie Dieu de venir à mon aide, je le supplie de toutes mes forces, de tout mon désespoir. Ma prière monte de mes entrailles, de mon âme, elle explose de ma tête.
Mais au bout d'un moment, un troisième mec arrive dans la chambre. Celui-là non plus, je ne l'ai jamais vu. Il demande à l'autre de se presser et, tout en matant la scène, il se masturbe. Puis ils veulent me forcer à « faire des trucs » à plusieurs. Je panique, je m'affole, je suis en larmes. Je recommence à hurler, je les supplie de me laisser tranquille. K., qui était sorti, revient alors dans la pièce et demande ce qui se passe. Quand ils lui expliquent, il vire le second : « Tire-toi, t'as assez profité ! » Je me retrouve seule avec le troisième.
Je suis au plus bas. Je me sens moulue, usée, abîmée, souillée.
Peu à peu, je m'enferme dans un trou noir, un grand vide. Plus rien ne me concerne. C'est comme si mon esprit s'en allait de mon corps. Ce n'est plus moi qui suis là, allongée sur le lit, à supporter ces mains, cette peau, ces odeurs, ces souillures et cette sauvagerie, c'est juste mon corps, devenu une chose inerte, insensible. Le processus entamé tout à l'heure se poursuit et s'amplifie : j'ai tant fait pour fuir dans mes pensées, pour être absente de ce qui se joue pour moi, que maintenant plus rien ne me touche. Je suis coupée de mon corps, je suis anesthésiée. Je suis ailleurs Mon corps ne m'appartient plus, peut-être est-il mort? En tout cas, ces pilleurs, ces vautours ne m'auront pas pris mon âme : en elle, je suis réfugiée, en elle, je vis.
Ils ont profité de moi toute la nuit, lâchant leurs plus bas instincts. J'ai même subi de la part de K. des tortures physiques dont je ne parlerai pas, l'humiliation a des limites. Réveiller ces souvenirs est une souffrance que j'accepte pour le témoignage. Au petit matin, il ne reste que K. et moi dans l'appartement, les deux autres sont partis. Alors K. se transforme de nouveau, je ne le reconnais pas. Il fait comme si de rien n'était, encore : il me prépare un petit déjeuner, il me cire mes Weston. « T'as vu, semble-t-il dire, j'suis pas un fils de pute : » Et puis, il me laisse m'en aller.
Je sors à l'air, j'ai l'impression de tomber d'une autre planète. Je marche jusqu'à l'arrêt du bus, comme un automate. Je suis là, avec mon pull déchiré et mes Weston qui brillent, misérable. Mes jambes ont du mal à me tenir. « Dépêche-toi le bus! » Je ne sais même pas la tête que j'ai, j'essaie de lire dans le regard des gens : ils ne voient rien. C'est le petit matin, une nouvelle journée commence pour eux, une journée comme les autres, et moi je suis là. Je sors d'un cauchemar. J'essaie de donner le change, face à eux, genre fille-qui-prend-le-bus-normal-quoi.
Je ravale des torrents de larmes. J'enfouis mes cris au fond de moi. Je sens comme une boule dans mon ventre, une boule de cris, de coups, de gros mots, de larmes. Il y a plein de violence autour de cette boule, prête à péter, à voler en éclats. Mais rien ne se passe. Je suis là, debout, à attendre ce putain de bus. Le chauffeur m'embrouille pour le ticket, je lui hurle de ne pas me péter les couilles.
Où aller ? Est-ce que je rentre chez moi ? J'ai envie de partir loin, très loin, pour que personne ne me retrouve, quelque part où l'on ne me posera pas de questions, un endroit où je serais libre, où je serais bien.
Concernant le phénomène des viols collectifs
et de leurs liens éventuels avec la condition féminine dans l'islam, voir aussi :