
Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Sectes page 2
Parmi les schismes modernes, on peut citer le « mouridisme », une communauté fondée au Sénégal vers 1890 par le cheikh Amadou Bamba (1852-1927). Les Mourides considèrent le travail comme un moyen de sanctification, tout autant que la prière. En cela, ils se rapprochent des disciples de Saint Benoît. Ils ont créé des villages communautaires dont Tomba qu’ils considèrent comme leur « ville sainte ». Pour les Mourides, le djihad ne doit pas être violent et les femmes, chose unique en islam, jouent un rôle central dans la société. Pour la prière, les femmes forment un cercle autour de la « maîtresse », les hommes autour du « maître ». Cette branche schismatique de l’islam compte environ trois millions d’adhérents, essentiellement au Sénégal.
A l’opposé du mouridisme, on peut citer la secte soufie de Sanûsiya qui vit le jour en 1837 en Algérie. Fondée par Muhammad Ibn-Ali as-Sanûsi (1787-1859), elle était proche du wahhabisme arabe et militait pour le « retour à la vraie foi », autrement dit pour l’islam pur et dur. Réfugié en Lybie, Al-Sanûsi lutta militairement contre la pénétration italienne et s’allia avec l’ordre des Sénoussis. Le chérif Idris – petit-fils du fondateur de la secte – fut battu par les Italiens en 1931. Il monta sur le trône de Libye en 1951 mais fut renversé par le colonel Kadhafi en 1969.
Le « taçawwuf » - que les Occidentaux nomment « soufisme » - est l’expression du mysticisme islamique avec ce que cela comporte d’aspects divers (notamment ésotériques). Il se fonde sur le coran et la sunna et ses premières manifestations remontent au premier siècle de l’hégire. De façon générale, les « saints » dont les musulmans honorent la mémoires sont des soufis. Le soufisme entra en conflit ouvert avec les califes de Badgad (au Xe siècle, Hallâdj fut jugé hétérodoxe et mis à mort) puis se réconcilièrent avec les autorités officielles de l’islam. Aujourd’hui, le soufisme n’existe plus guère que sous des formes dégénérées comme le maraboutisme africain ou le fakirisme indien. Certaines sectes se réclamant du soufisme participent aussi à des complots politiques. Les soufis s’adonnent à des pratiques spéciales : invocations, litanies, danses,… qui entrent dans le rituel du « dhijr » (souvenir de dieu). On est là à la limite de la religion et de la superstition. C’est ainsi que les « marabouts » prétendent être les descendants de « saints » qui leur auraient transmis leurs pouvoirs spirituels (baraka). La plupart d’entre eux sont des charlatans qui exploitent des populations crédules et analphabètes. Les abus commis par les marabouts ont d’ailleurs été à l’origine d’une réaction réformiste qui n’a cependant pas réussi à faire assainir l’islam africain.
Notons cependant que les « courants réformistes » ne sont pas nécessairement, comme on pourrait le croire en Europe, des courants « libéraux ». Bien au contraire, ce sont des courants « rigoristes » qui prêchent le « retour à la vraie foi », c’est-à-dire l’intégrisme. On peut ainsi citer le courant « salafiya », apparu à la fin du XIXe siècle, qui se réclame des « pieux ancêtres » ( salaf ) tout en prônant un certain modernisme. Parmi les principales figures de ce courant, on peut citer l’Iranien Djamal al-Dîn al-Afghânî qui lança l’idée du « panislamisme » et l’Egyptien Muhammad Abduh (1848-1905), son disciple, qui tenta d’imposer un réformisme théologique et culturel fondé sur un « islam épuré » de ses « saints » et de ses superstitions. Tout en prêchant le retour à la foi originelle, il milita pour l’enseignement des sciences occidentales et de l’histoire. Son combat fut repris par Rachid Ridâ, fondateur de la revue « Al-Manâr » (Le phare) et leader des oulémas algériens. Proche de cette tendance, on trouve le mouvement indien « Ahl-il-Hadith » et le mouvement indonésien « Mahammadiya ». Tous veulent imposer le djihad par l’éducation. Ils sont à l’origine de plusieurs universités dites « islamiques ». Bien que « progressistes », ils n’en sont pas moins dangereux sur le plan religieux.
On sait aussi que le mouvement missionnaire « Tabligh » - qui compte de nombreux adeptes dans le monde – est en constante progression.
Le plus dangereux des courants « réformistes » demeure cependant le wahhabisme saoudien. Il dispose, en effet, de l’appui du régime instauré entre 1920 et 1930 et qui dispose, grâce aux ressources pétrolières, de moyens quasiment illimités pour propager cet islam particulièrement anachronique et antidémocratique qui dénonce les « innovations » (bid’a), la philosophie et les courants schismatiques (chiisme et soufisme en particulier). Le wahhabisme se fonde sur une interprétation littérale du coran et une application stricte de la charî’a.
Pour plus de détails, on se reportera à la lecture du chapitre 6 de la présente étude qui traite plus spécifiquement du wahhabisme et de l’Arabie Saoudite. Nous avons aussi évoqué par ailleurs le cas de certaines mouvances islamiques très dangereuses, tels les « Frères Musulmans ».

Sur cette photo prise en 1929, on voit Mohammed Bakir Effendi entouré de deux de ses coreligionnaires. Il était le « Grand Tchélébi de l’ Ordre Mevlevi », secte musulmane mieux connue des Occidentaux sous le nom de « derviches tourneurs ». Les derviches turcs, craignant le régime « kémaliste » (celui du général Kemal Ataturk), s’étaient réfugiés en Syrie où ils s’étaient placés sous la protection des Français.
|
Selon les données statistiques de 1990, le taux de natalité moyen était de 43‰, contre 34‰ dans les pays du tiers monde non musulman et 12‰ dans les pays industrialisés. La stratégie des islamistes pourrait donc être payante d’ici seulement dix à vingt ans si nous ne prenons pas des mesures visant à endiguer la progression de l’islam et son infiltration dans les pays qui n’appartiennent pas au monde arabo-musulman (en particulier l’Europe occidentale). |
De la secte des
« Assassins » d'Hassan ben Sabbah…
Nous venons de voir que, parmi les sectes musulmanes, il s’en trouvait une dont le nom arabe a été à l’origine du substantif français « assassin » et de ses dérivés (assassinat, assassiner,…).
Elle mérite que nous nous attardions quelque peu sur son histoire car, on retrouve ses motivations et ses méthodes chez les dirigeants du réseau « al Qaïda »(la solide base) et surtout chez le chef de ce réseau, Ussama ben Laden.
En se retranchant dans la citadelle afghane d’Alamut, il n’a pas agi autrement que Hassan ben Sabbah, premier grand maître de la secte des Assassins. Cette secte, comme nous l’avons vu, se rattachait à une branche de l’islam qui prétendait pouvoir interpréter le « sens caché » (batin) des écritures coraniques. D’où le nom de « batiniens » que l’on donne parfois aux « Haschîchiya ».
Ben Sabbah était le fils d’une puissante famille iranienne installée dans la ville de Qom, le centre de la propagande ismaélienne. Cette branche dissidente du schisme chiite qui allait au-delà des « révélations » coraniques en ajoutant aux six « prophètes du verbe » (Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet), un septième « envoyé » : Ismaël. Comme tous les fils de bonne famille, Hassan avait été envoyé au Caire (en 1079) pour y parfaire ses études. Il y avait étudié le coran mais aussi l’ancien et le nouveau Testament et les textes védiques des Hindous (ramenés en Egypte par Alexandre le Grand). De toutes ces religions, il avait tenté de faire une synthèse en y mêlant un zeste de zoroastrisme, croyance à laquelle beaucoup d’Iraniens avaient adhéré dès le VIIe siècle de notre ère, c’est-à-dire, à l’époque où Mahomet concoctait son « islam ». Il y avait même incorporé une pincée de pensée néoplatonicienne.
Durant son séjour au Caire, ben Sabbah s’était aussi lié d’amitié avec Nizar, le fils du calife fatimide al-Mustansir. Manque de chance, Nazir est écarté de la succession au profit du premier ministre en poste, le vizir al-Afdal. Et c’est sans doute ce qui motivera la rancœur de ben Sabbah à l’encontre du pouvoir fatimide qui règne alors sur la région que les Occidentaux nomment « Perse » mais que les autochtones appellent déjà « Iran ». Il réunira autour de lui les amis de Nizar (qui finira assassiné) pour former le clan des « nizarites » et, de retour en Iran, il commence à diffuser sa « doctrine » à Ispahan. Ses prêches religieux - qui s’apparentent à des discours de chef politique – ne tarderont pas à inquiéter les autorités, d’autant qu’en Perse , les Turcs seldjoukides viennent de s’emparer du pouvoir. Pour ces sunnites orthodoxes, les iraniens chiites sont des hérétiques qui doivent être convertis ou persécutés. Mais comme ben Sabbah appartient à une famille puissante, les Turcs se contentent de lui infliger une peine d’exil. Suivi de ses « fidèles », il part pour la Syrie et finit par s’installer dans les montagnes situées au Sud de la mer Caspienne dont il fera son fief.
Proclamant
- à l’instar de David - qu’il peut abattre Goliath,
il décide de déclarer la guerre sainte à tous
ceux qui ne sont pas d’accord avec ses idées et il adopte
pour devise : « Tout oser ! ».
Petit à petit, il s’empare
des places fortes de la région qu’il entend contrôler.
Et c’est un 4 septembre qu’il s’empare de la citadelle
d’Alamut. De là, il va rançonner les populations
et piller les caravanes qui sont razziées par ses hommes de
main. Il va faire régner la terreur dans toutes les régions
comprises entre la mer Caspienne et la Méditerranée.
Dans la foulée, il améliore le réseau de
forteresses qui protège son fief et installe de nombreux
postes avancés. S’emparant de Lamiassar et de Meimoundiz,
le chef des batiniens étend peu à peu son influence
vers la Syrie et l’Irak.
Ben Sabbah se retrouve assez vite à la tête d’une fortune imposante. Mais l’argent ne constitue pas sa motivation essentielle. Il ne l’intéresse que pour lui permettre de reconquérir la Perse, de restaurer la puissance Arabe et d’imposer sa conception de l’ismaélisme. Car il n’a accepté ni l’occupation par les Abbassides (Arabes se réclamant d’Abbas, oncle de Mahomet), ni le pouvoir Fatimide (instauré par les descendants de Fatima, fille de Mahomet), ni celui que les Turcs ont tenté de mettre en place. Il ne veut toutefois pas recruter des mercenaires car ils sont trop prompts à passer du côté de l’adversaire pour quelques pièces d’or ou d’argent. Il lui faut des hommes qui sont prêts à se sacrifier pour sa doctrine. Il lui faut de vrais fanatiques. Dans ses discours, il se présente comme le « houdschet », autrement dit comme la réincarnation du septième imam d’ismaël et les iraniens, séduits par son bagout, s’enrôlent massivement dans ses hordes de moines-soldats musulmans. Ils sont disposés à obéir aveuglément à leur chef, prêts à mourir pour leur « cause ». C’est à cette époque que l’on voit apparaître le terme « Assassins » (37) qui désigne ces guerriers qui étaient censés fumer du haschich (le terme arabe peut être traduit par « enivrés au haschich »).
On ne connaît rien de précis sur les rites et enseignements de la secte de ben Saddah car les textes authentiques ont disparu. Ses ennemis (chrétiens ou musulmans) prétendent cependant qu’avant de faire signer un pacte de fidélité absolue aux nouveaux adeptes, on leur faisait fumer du haschich (peut-être mêlé à d’autres drogues) afin de leur faire « voir » un jardin paradisiaque orné de fleurs aux senteurs admirables, arrosé par mille fontaines où l’eau fraîche coulait sans jamais se tarir et où de ravissantes jeunes filles dévoilaient leurs charmes pour leur prodiguer de savantes caresses.
C’est le fameux « paradis d’Allah » auquel les naïfs musulmans croient encore aujourd’hui. Dès que les drogues avaient cessé de produire leurs effets, les nouveaux recrutés étaient convaincus que le paradis qu’ils venaient d’entrevoir était celui qui leur était promis après leur mort. La vie sur terre leur apparaissait comme fade et dérisoire à côté d’une telle « éternité dorée » et pas mal d’entre eux devenaient empressés de mourir.
Mais encore fallait-il que la mort serve les intérêts du « grand maître » et de son « dieu ». Mourir en éliminant les ennemis - réels ou supposés - devint la meilleure façon d’accéder au « paradis » des Mahométans en général et des Assassins en particulier. Des camps d’entraînement furent créés pour entraîner les hommes au maniement des armes tandis que l’endoctrinement religieux constituait la base de l’enseignement.
On sait que tout en bas de la pyramide, les « lassek » (simples fidèles) étaient recrutés, de gré ou de force, parmi les populations pauvres. On y recrutait les « mujib » (novices) lesquels, en fonction de leurs aptitudes, devenaient des cadres de la secte ou des « fedayin » (ceux qui se sacrifient). Les « rafik » (cadres) étaient affectés au commandement des forteresses, à l’organisation des razzias ou à l’organisation des structures secrètes que la secte implantait dans les villes. Quant aux « daï », ils formaient la caste des propagandistes, des missionnaires et des prieurs. Et tout au sommet de cette pyramide, on trouvait bien évidemment le grand maître, celui qui sera ensuite surnommé « le vieux de la montagne ».
La secte se fonde donc sur une organisation « apparente » et sur une organisation « clandestine ». C’est à Hussein Qâ’ini, le principal propagandiste et agent d’infiltration, que va échoir la tâche qui consiste à structurer les activités clandestines. Outre les habituelles formations religieuses et militaires, les agents clandestins doivent apprendre la langue et les coutumes des peuples qu’ils devront infiltrer. Car ils doivent d’abord gagner la confiance de leurs futures victimes et ne pas se faire remarquer. Cette tactique sera confirmée par plusieurs Assassins qui furent capturés avant qu’ils ne commettent un meurtre (comme Abû Ibrâhim Asibâdâsi, capturé à Bagdad).
Le premier dignitaire à avoir été victime des séides de ben Sabbah fut, en 1092, Nizam al’Musk Tusi, vizir d’Ispahan. Mais avant lui, ils avaient déjà assassiné un simple muezzin qui avait refusé de dire les louanges du « maître ». Le vizir fut tué selon un plan minutieusement établi par ben Sabbah lui-même. C’est un fedayin nommé Bu Tâhin Arrani qui se proposa pour ce meurtre et qui en fut chargé. Déguisé en religieux chiite, il réussit à approcher le vizir et à le poignarder à mort.
En 1101, le mufti d’ispahan fut à son tour assassiné pour avoir osé témoigner contre ben Sabbah. Puis, en 1102, vint le tour du préfet de Bayhaq et, en 1103, celui du chah des Karrâmiyya. En 1108, les Assassins tuèrent le cadi d’Ispahan (qui avait jadis exilé ben Sabbah) et, en 1109, le cadi de Nichapour. En 1110, le « grand maître » alla même jusqu’à faire disparaître deux de ses fils qui avaient osé lui désobéir ! L’une des dernières victimes de ben Sabbah fut le général égyptien Al-Afdal.
Les meurtres politico-religieux ne s’arrêtèrent pas avec la mort de ben Sabbah. Ses successeurs continuèrent dans la voie tracée et firent assassiner de nombreuses personnalités aussi bien que d’obscurs citoyens. Le premier crime connu de Buzourg Umid fut perpétré en 1127 (assassinant du vizir Mu’ïn al-Dîn) et il fit disparaître un autre vizir, un émir, un calife, un préfet, un gouverneur et un mufti entre 1127 et 1136. Le grand maître Muhammad commença par l’assassinant du calife al-Rachid (en 1138) avant de faire tuer un prince, un sultan, un émir, trois cadi et le comte Raymond II de Tripoli (première victime non musulmane en 1150). Quant au grand-maître Qadal al-Dîn Hassan, il tenta à plusieurs reprises de faire assassiner le sultan Saladin (en 1174, 1175 et 1176) avant que la secte ne s’acharne sur les chefs croisés, tuant successivement Conrad de Montferrat (1192), Raymond fils de Bohémond IV d’Antioche (1213) et Philippe de Montfort (à Tyr en 1270). Une tentative visa aussi Edouard d’Angleterre (en 1272).

Portrait
d’Hassan ben Sabbah, chef spirituel et militaire des
« Assassins », aussi nommé le « Vieux
de la Montagne » (enluminure figurant dans un manuscrit
ancien).
Le meurtre est la principale activité de cette secte musulmane dont la devise est : « On ne peut guérir la blessure du monde qu’avec la lame qui la fit ». Mais elle pratique aussi le racket, le chantage et même les « alliances de raison ». C’est ainsi qu’après sa défaite de Mansoura, Saint Louis reçoit les émissaires de la secte qui lui enjoignent de payer tribut comme ses prédécesseurs. Bien que battu, le roi franc refuse de céder à ce chantage, ce qui lui vaudra la considération du grand maître de l’époque. Quelques semaines plus tard, il fait apporter au chef croisé son anneau et sa chemise avec cette déclaration : « La chemise est plus près du corps que tout autre vêtement, ainsi leur maître veut être plus près du roi franc que tout autre ».
A cette déclaration étonnante étaient joints d’autres cadeaux de valeur. En retour, Saint Louis offre des joyaux au « vieux de la montagne » et laisse sur place un ambassadeur permanent, le moine dominicain Yves Le Breton. Ce sera le début d’une curieuse alliance entre les Assassins et les Croisés, une alliance visant à servir les intérêts de la secte au détriment des autorités musulmanes légitimes.
Par la suite, un autre prince osera défier les Assassins. C’est le Mongol Hûlagû qui s’empare de la citadelle d’Alamut en 1256 et décide de la faire raser pour en finir avec cette secte criminelle. Il met ainsi un terme à 166 années de terrorisme.
Pour plus de détails sur l'histoire de la secte des assassins, on peut se reporter à l'un des meilleurs livres écrits sur le sujet : |
 |
Chassés de Syrie en 1272 par les mamelouks, les ismaéliens se dispersèrent au Liban (communauté des Druzes), en Iran et en Inde (tribus des Khodjas). Le dernier descendant des « vieux de la montagne » (38) n’est autre que le prince Agha Khan, membre de la «jet set » internationale !
 |
Ce « pékin », vêtu comme un bourgeois occidental, n’est autre que le prince Mohammed Chah ibn Agaha Ali, autrement dit l’Agha Khan, chef spirituel des ismaéliens et descendant d'Hassan Ben Sabbah. |
Ce qui est saisissant, ce sont les similitudes qui apparaissent lorsque l’on étudie le parcours d’Hassan ben Sabbah (et de ses successeurs) et qu’on le compare avec celui d’un personnage comme Ussama ben Laden. Ils sont tous deux issus d’une famille aisée et ils sont tous deux animés par un fanatisme religieux mêlé de rancoeurs nationalistes. Ben Sabbah veut « libérer » l’Iran et imposer sa vision de l’ismaélisme tandis que ben Laden veut chasser les « impies » du sol saoudien en imposant sa vision du wahhabisme.
Le « réseau » de ben Laden ressemble fort à la secte de ben Sabbah. Les méthodes sont à peu près les mêmes avec une sacralisation du crime que renforcent des promesses de paradis toutes aussi illusoires.
Ben Laden s’est construit un fief dans les montagnes de l’Afghanistan comme ben Saddah dans le massif de l’Elbourz. Il y est devenu une sorte de personnage mythique dont on ne sait pas très bien s’il est mort ou vivant, un peu comme le « vieux de la montagne ».
Ussama ben Laden a-t-il délibérément organisé son « réseau » sur le modèle de la secte de ben Saddah ou s’agit-il plutôt d’une analogie résultant d’un mode de fonctionnement qui découle de la nature de l’islam ?
Nous penchons pour la seconde solution. C’est très vraisemblablement la nature sectaire de l’islam qui aboutit à des comportements qui se reproduisent au fil du temps. Religion sans véritable clergé, l’islam permet à n’importe quel meneur d’hommes de s’ériger en « docteur de la foi » et en « commandeur des croyants ». De nombreux individus, avides de pouvoir, ont su se servir de cette caractéristique pour mener des guerres présumées « saintes » et commettre des crimes odieux au nom de leur dieu invisible.
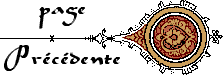 |
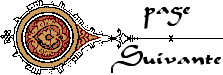 |