
Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Loi & justice

L’islam, la loi et la justice
La loi prétendument sacrée de l’islam, la « shari’a » occupe une place centrale dans la société musulmane, où qu’elle soit implantée dans le monde.
Son histoire se confond avec celle de la montée du pouvoir islamique et la conquête arabo-musulmane. On peut même dire que la shari’a représente le « noyau » de l’islam proprement dit et il est certain que la « loi religieuse » est regardée, par les musulmans, comme étant incomparablement plus importante que les aspects théologiques. On peut donc penser légitimement que c’est la volonté d’imposer un nouveau « code » qui a inspiré Mahomet et ses successeurs. Les prétendues « révélations » du chamelier de la Mekke ne furent, de toute évidence, qu’une astuce pour faire passer la pilule plus facilement ai sein des populations analphabètes et crédules. C’est encore le cas de nos jours dans les pays sous-développés ou en crise.
En 1959, Shaykh Mahmüd Shaltut, recteur de l’université d’al-Azhar, avait publié un ouvrage intitule « al-Islam, ‘aqida wa-shari’a » ou, en bon Français « L’islam, une foi et une loi » (et en bon Bruxellois ? : « L’islam, une loi, une fois » ! :-). La plus grande partie de ce livre était consacrée à la présentation de la loi religieuse. L’auteur s’y attardait longuement sur les « détails techniques » de cette fameuse loi, cependant que l’exposé de la foi islamique occupait moins d’un tiers du volume. Car pour les « dignitaires » de l’islam, ce qui unit les musulmans entre eux, c’est bien plus la volonté de préserver un certain mode de vie et un « idéal commun de la société » (à la mode arabe du VIIe siècle) qu’une simple croyance commune. Aujourd’hui encore, l’effort des autorités musulmanes ne vise pas à prouver l’authenticité et la véracité du dogme islamique mais bien à justifier, par toute sortes de pirouettes de langage, la validité de la shari’a, telle qu’ils la conçoivent. Et nous verrons, dans les chapitres suivants, que l’unanimité est bien loin de régner dans le monde musulman, un monde qui se décompose en une infinité de « chapelles » (de sectes et de sous-sectes) qui se battent pour le pouvoir.
Il est donc essentiel de savoir ce que recouvre la notion de « loi islamique », d’autant que – comme l’indiquent fort justement les chercheurs de l’université de Cambridge dans leur « Encyclopédie générale de l’islam » (Cambridge University Press – 1970) – « …la rareté des études historiques et sociologiques de la loi islamique a été plus souvent regrettée qu’elle n’a suscité des vocations à remplir ce vide. ». Les mêmes chercheurs insistaient aussi sur le fait que le fait de vouloir faire expliquer cette loi islamique par la société islamique ne peut que mener à un « cercle vicieux ».
Nous empruntons d’ailleurs l’essentiel de ce chapitre à leur excellente analyse mais en y ajoutant nos propres commentaires et l’éclairage des évènements récents.
La shari’a prend ses racines dans la société arabe préislamique, bien avant la naissance de Mahomet. Cette société et ses lois tribales, insistons bien sur ce point, sont conditionnés par des traits à la fois profanes et magiques. Les lois tribales des Arabes étaient magiques dans la mesure où leurs processus de recherche et de démonstration étaient dominés par des méthodes relevant de la divination, de l’invocation et du serment. Son aspect profane se concrétisait dans le fait que ces mêmes lois concernaient essentiellement des conflits de paiement et d’indemnisation. Rien, en tous cas, ne permet d’affirmer qu’une « loi sacrée », semblable à celle des Hébreux – existait au sein des communautés arabes préislamiques.
De ces lois archaïques, la shari’a a conservé les traits essentiels des règles qui régissaient le statut personnel, la famille et l’héritage. Elles nous sont parvenues presque inchangées telles qu’on les appliquaient dans les petites villes de la péninsule arabique et au sein des clans de Bédouins. Toutes ces populations étaient régies par un code fondé sur le système patriarcal, un système qui ne conférait aucune protection à l’individu dès le moment où il avait quitté sa tribu et son clan. Un système qui n’avait aucune conception de la « criminalité », au sens juridique du terme. Pour les Arabes, les crimes étaient assimilés à des préjudices et le groupe tribal, dans son ensemble, devait assumer la responsabilité des actes commis par ses membres. C’est le type même du système qui engendre les « vendettas » (comme en Sicile, île qui demeure marquée par l’influence arabe).
 |
A Palerme, cette ancienne mosquée reconvertie en église catholique (San Cataldo) a conservé son aspect typiquement arabo-musulman. La Sicile est demeurée marquée par l’influence arabe, notamment en ce qui concerne les « vendettas ». Le mot « maffia » est lui-même d’origine arabe. |
Ces « vendettas » ne doivent cependant pas être regardées comme une « institution ». Elles se faisaient en dehors des lois et ne rentraient dans le cadre légal qu’à partir du moment où elles impliquaient le paiement du « prix du sang ». C’est à ce moment-là seulement que la loi arabe reprenait ses droits. Il n’existait d’ailleurs, dans la société arabe préislamique, ni autorité politique (dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui), ni pouvoir judiciaire organisé.
Dans les cas où des conflits étaient du ressort des lois tribales (droits de propriété, héritages, indemnisations), il était possible de recourir à un arbitrage lorsqu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé. Etant donné que, pour les Arabes, la qualité essentiel d’un médiateur (ou arbitre) était de posséder des « pouvoirs surnaturels », l’arbitrage était généralement du ressort des devins. La décision du médiateur n’était pas considérée comme un « jugement exécutoire » mais comme une simple confirmation du droit coutumier ou de ce qu’il devait être (d’après le devin). Par la suite, la fonction de médiateur se confondit avec celle des législateur, personne autorisée (en vertu de ses « dons ») à interprété la « coutume légale normative » ou « sunna ».
Transposé dans le cadre islamique, ce concept de « sunna » allait devenir l’un des plus importants – sinon le plus important – ferment de la loi islamique et les « ‘ulema’ », les « interprêtes autorisés de la loi », devinrent de fait les législateurs de l’islam.
Mahomet appartenait à une famille qui était supposée avoir des dons de divination. Son grand-père, el-Mottalib, était à la fois devin et sourcier car, pour les Arabes, celui qui parvenait à trouver une source ne pouvait être qu’un devin inspiré par les dieux. Quand il entama sa carrière de «réformateur religieux » à la Mekke, il se servit de la renommée de son grand-père et se présenta comme un « émissaire de dieu », version monothéiste des anciens devins. A Médine, il s’érigea en législateur en s’efforçant d’imposer une nouvelle base religieuse et sociale qui devait dépasser le cadre étroit de la société tribale. A la Mekke, ses concitoyens ne le considéraient que comme un simple devin et cela explique qu’il s’empressa d’abandonner le principe d’arbitrage tel qu’il était pratiqué par les Arabes polythéistes. Cependant, quand on faisait appel à lui pour régler un conflit au sein de sa propre communauté de « muslims », il continuait à se comporter en arbitre. Le coran recommande d’ailleurs de nommer un médiateur originaire de chacune des familles du mari et de la femme en cas de litige entre conjoints. C’est une survivance typique du droit préislamique.
On ne trouve qu’un seul verset du coran où le terme arabe traditionnel pour l’arbitrage est remplace par un terme nouveau – purement islamique – désignant une décision judiciaire. Il dit : « Mais non, par le Seigneur, ils ne croiront pas vraiment tant qu’ils ne t’auront pas nommé arbitre de leurs querelles, et qu’ils ne répugneront pas à admettre ce que Tu as décidé, et s’y soumettront en totale soumission » (Sourate IV-68). Une variante en traduction dit : « J’en jure par ton dieu, ils ne seront point croyants jusqu’à ce qu’ils t’aient établi le juge de leurs différents. Ensuite, ne trouvant eux-mêmes aucune difficulté à croire ce que tu auras décidé, ils y acquiesceront d’eux-mêmes ». On constate que l’une des traductions produit le mot « arbitre » (terme traditionnel) tandis que la seconde produit le mot « juge ». En fait, l’un se superpose à l’autre. le juge islamique est la parfaite continuité du « devin-arbitre » de la société préislamique.
Ce verset est aussi très intéressant en ce qu’il indique clairement le subterfuge employé par Muhammad-le-devin pour acquérir le pouvoir, pour s’ériger en législateur au nom de la divinité unique qu’il proposait pour remplacer l’ancien panthéon arabe. Il se veut le « juge unique », celui qui va imposer « ses » décisions à ses naïfs contemporains. Une telle stratégie eut été impossible à mettre en œuvre avec toute une kyrielle de dieux !
Dans la version arabe dudit verset, le premier verbe fait référence au rôle d’arbitre de Muhammad tandis que le second (décider) - d’où vient le terme arabe « Qâdi » - insiste sur le caractère autoritaire de la décision. C’est le premier indice de l’émergence d’un nouveau concept de la justice. C’est la justice « autoritaire », dictatoriale, que veut imposer Mahomet. C’est la justice des oulémas wahhabites (voir chapitre 6).
De nombreux versets du coran montrent que ce nouveau concept fut long à s’imposer. Ce n’est que par ses conquêtes militaires (donc politiques) que le prétendu prophète parvint à ses fins. La loi islamique n’est parvenue à s’imposer que par la force et par le sang. Mais c’est d’abord grâce à la fortune de sa femme que Mahomet a réussi son coup de force. Sans l’argent de Khadidja, il n’aurait pas pu lever une armée et partir à la conquête de l’Arabie. Il n’est pas inutile d’insister sur ce point.
Devenu « Législateur-Prophète », Mahomet exerça son pouvoir en maître absolu, en dictateur implacable. Le cadre légal étant à peu près inexistant, il exerça ce pouvoir en se référant à dieu et à ses prétendues révélations. Cela marchait avec les « croyants », autrement dit avec les plus crédules et les plus naïfs de ses concitoyens. Pour les « tièdes », son autorité fut finalement considérée comme étant d’ordre politique.
En tant que « prophète », il avait peu de raisons de modifier radicalement les lois coutumières existantes. Son but n’était d’ailleurs pas d’instaurer un nouvel ordre légal mais, en apparence du moins, d’enseigner aux hommes les moyens de réaliser leur salut. C’est ainsi que la loi islamique est un amalgame de devoirs, d’obligations rituelles, légales et morales qui sont tous censés être sanctionnés par un même « commandement de dieu ».
Sur le plan pénal, le coran impose des sanctions qui sont essentiellement morales. Il ne dit rien des sanctions pénales telles que les Occidentaux les conçoivent. Tout au plus instaure-t-il des dispositions visant à renforcer les liens du mariage, à limiter les effets des vengeances personnelles et de la loi du talion ou encore à éradiquer les vendettas. Il tente aussi de mettre un frein au relâchement de la morale sexuelle, ce qui est assez comique quand on connaît la personne de Mahomet et quand on étudie un tant soit peu sérieusement la vie de ses successeurs (les califes). Le coran, c’est « faites ce que je dis, pas ce que je fais » !
Le but de Mahomet était de dissoudre les communautés bédouines, difficiles à contrôler politiquement, pour leur superposer une « communauté unique des croyants », calquée sur un modèle plus urbain. Il en résulta de nombreux problèmes qui furent traités, non par dieu, mais par Muhammad et au coup par coup. L’encouragement de la polygamie par Mahomet est une parfaite illustration de ce fait.
Cet encouragement était basé sur la volonté d’accroître rapidement la communauté des croyants et surtout de fournir de la piétaille pour les guerres de conquête. Mais il entraîna de sérieuses modifications dans les usages relatifs à l’héritage, même si le coran en conserva les traits essentiels.
On ne peut pas dire que la shari’a, telle que nous la connaissons aujourd’hui, existait à l’époque où Mahomet exerçait le pouvoir. En fait, elle se constitua très progressivement au cours du premier siècle de l’hégire. Et c’est au cours de cette même période que la société islamique naissante créa ses propres institutions juridiques. L’ancien système d’arbitrage fut maintenu sous les premiers califes (califes de Médine), tout comme les lois coutumières préislamiques. Dans leurs fonctions de souverains et de législateurs suprêmes, les premiers califes jouèrent essentiellement le rôle de législateurs de la communauté musulmane. Pendant le premier siècle de l’hégire, les fonctions législatives et administratives du gouvernement islamique se confondent étroitement. Toutefois, l’objet de cette législation n’était pas de modifier la loi coutumière au-delà de ce qui était dit dans le coran. Elle devait d’abord organiser les territoires nouvellement conquis par les armées musulmanes et assurer la viabilité d’un Etat islamique qui s’agrandissait de jour en jour.
Les premiers califes, ces « compagnons de routes du prophète », calquèrent leur comportement sur celui de Mahomet. Ils réprimèrent très sévèrement, souvent dans le sang, les manifestations de déloyauté. Ils allèrent jusqu’à faire fouetter les auteurs de poèmes satyriques contre des tribus rivales – forme en principe autorisée d’expression littéraire – sous prétexte que ces écrits menaçaient la sécurité intérieure de l’Etat.
Bien que n’étant pas prises en vertu du coran, de nombreuses décisions émanant des califes obtinrent une reconnaissance officielle et furent intégrées dans le droit islamique. Le recours à la lapidation comme châtiment de la luxure est l’une de ces décisions. La plupart des théoriciens arabes de la loi islamique prétendent qu’il s’agit là d’un « commandement du prophète ». Ils se réfèrent à un verset du coran qui parle, en effet, de la lapidation mais dont on sait qu’il ne faisait pas partie du texte « officiel » (version d’Othman) et qu’il doit être regardé comme apocryphe. Les « traditions » (sunna) qui font état des « actions » et des « dires » de Mahomet – dont nous savons qu’elles sont plus que douteuses – devinrent des « références en droit » dès la fin du premier siècle de l’hégire. Le verset apocryphe dont il vient d’être fait mention représente l’une des premières tentatives visant à faire établir – à posteriori – la validité « divine » (donc légale) d’une ordonnance d’un calife.
Les schismes qui affectèrent la communauté musulmane peu après sa fondation (voir chapitre 3) affectèrent peu le concept global de la loi islamique. Chez les chi’ites, la loi de la Shi’a est toutefois dominée par le concept de « taqiyya » (dissimulation – pratique qui découla des persécutions qu’ils eurent à subir de la part des sunnites) et par la distinction entre les doctrines exotériques et ésotériques de leur différentes « écoles de pensée »(sic). Chez les Kharijites, on trouve les notions spécifiques de « walaya » (solidarité) et de « barâ’a » (exclusion ou excommunication).
Très vite, la notion préislamique de « sunna » se réaffirma dans la communauté musulmane. Ce qui était coutumier était décrété « juste et vrai ». Ce que les ancêtres avaient fait méritait d’être imité. C’est dans cette idée de « précédent », de « sunna » que le monde arabe s’est – si l’on peut dire – développé (on devrait dire « sous-développé »). On y trouve le ferment du conservatisme et du « passéisme » outrancier, maladif, qui affecte le monde arabo-musulman. Un monde qui refuse d’évoluer et s’enferme dans sa coquille dès qu’il se croit menacé par le « progrès ». Sur le plan mental, les musulmans sont de véritables fossiles vivants.
On comprendra, dès lors, que le fait de vouloir aider les nations musulmanes à se « développer » (au sens où les Occidentaux l’entendent) relève de l’utopie. Les « aides au développement » que nous leur accordons beaucoup trop généreusement sont, ou bien détournées par les dirigeants politiques et les fonctionnaires, ou bien utilisées pour poursuivre une politique passéiste dans le domaine de l’enseignement et des actions sociales. Dans certains cas, elles servent carrément à financer l’enseignement dit « coranique » et même des groupements subversifs qui prêchent le djihad (c’est notamment le cas en Palestine où les subventions de l’Union européennes sont honteusement détournées au profit de l’enseignement coranique et des actions terroristes).
Revenons à nos moutons.
La « sunna », considérée dans le contexte islamique, avait initialement une connotation bien plus politique que juridique. La question qui se posait aux premiers musulmans consistait à savoir si les ordonnances des deux premiers califes (Abou Bakr et Omar) devaient être assimilées à des précédents contraignants (sunna). Elle fut soulevée lors de l’accession au pouvoir du troisième calife, en l’an 644 de notre ère. Il s’agissait du très contesté Othman (ou ‘Usmân), un personnage tout aussi équivoque que Mahomet lui-même. Nous savons qu’il appartenait à un clan qui était en rivalité ouverte avec celui de Mahomet. Musulman « opportuniste », Othman n’avait semble-t-il adhéré à la nouvelle religion que pour pouvoir en retirer des avantages pour son clan et lui-même. Il s’empressa donc d’éliminer les représentants de l’islam primitif qui pouvaient avoir quelque influence.
C’est la même politique qui conduisit Othman a faire rédiger un coran à la mesure de ses ambitions, un coran « édulcoré » et « arrangé » selon sa volonté. Et pour être certain qu’il ne subsisterait plus rien du coran primitif, il fit disparaître tous les exemplaires existants des autres versions (on prétend qu’il existait à l’époque une soixantaine de versions différentes des « révélations » mahométanes). Cette politique, jugée scandaleuse par les musulmans « purs et durs », conduisit à son assassinat, en l’an 655. C’est avec « son » coran à la main qu’il fut poignardé par ses coreligionnaires qui l’accusaient - sans doute avec raison - de s’être beaucoup trop écarté du coran véritable et de la politique de ses deux prédécesseurs. Cependant, au cours des onze années de son califat, Othman avait réussi à faire disparaître une part importante – et sans doute essentielle – des déclarations véritables de Mahomet. Et pourtant, aujourd’hui encore, le coran d’Othman demeure la référence officielle des musulmans. C’est un peu comme si les chrétiens se référaient à un Nouveau Testament qui aurait été revu et corrigé par Judas !
C’est dans ce contexte quelque peu surréaliste que naquit la notion de « sunna du prophète », non encore identifiée à un ensemble de règles mais servant de lien entre la « sunna d’Abou Bakr et d’Omar », la « sunna d’Othman » et ce qui pouvait subsister du message coranique.
Il en résulte qu’à partir de cette époque lointaine, le droit islamique ou coranique s’est instauré sur la base d’un principe général (sunna) qui n’avait rien de spécifiquement islamique et sur un texte (le coran d’Othman) plus que suspect. Ce n’est pas là le moindre paradoxe de l’islam !
Les trente années que durèrent les règnes des califes dits « de Médine » seront présentées, plus tard, comme l’ « Age d’or » de l’islam. C’est en tous cas le cliché qui prévaut, aujourd’hui encore, chez les musulmans qui ont subi le lavage de cerveau de l’enseignement coranique. Or, ce que nous savons de l’histoire authentique (et vérifiable) de l’islam primitif démontre que ce fut loin d’être le cas. C’est ainsi que les chercheurs de l’université de Cambridge qualifient, à juste titre, cette période d’ « entracte trouble entre les premières années de l’islam et le royaume arabe des Omeyyades ».
En effet, au cours de cette période, les commandements du coran ne furent même pas appliqués sans restriction. L’étude du développement des doctrines juridiques issues de l’islam montre que l’on ne prêta qu’un intérêt très superficiel à ces commandements. Les conclusions, autres qu’élémentaires, que les Arabes tirèrent du message mahométan survinrent à des époques bien plus tardives. On constate même que, dans plusieurs cas précis, la doctrine de la shari’a primitive est en totale contradiction avec les termes explicites du coran (du moins celui d’Othman). Le verset 8 de la sourate V dit : « O croyants ! quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous les mains jusqu’au coude ; essuyez-vous ensuite la tête et les pieds jusqu’aux chevilles » mais la loi n’imposait que le seul lavage des pieds. Ailleurs, le verset 282 de la sourate II avalisait la pratique qui consistait à consigner par écrit les contrats dont l’exécution n’était pas immédiate. Cette habitude, usuelle chez les commerçants des villes arabes, fut consignée dans le coran mais la loi islamique vida ce commandement de sa puissance contraignante en niant la validité des documents écrits et en accordant la primauté aux déclarations des témoins, lesquels ne sont pourtant que des personnages secondaires, accessoires, si l’on interprète bien le verset dont il est ici question.
D’une certaine manière, Mahomet était un « homme de la ville », un chamelier devenu commerçant qui avait rompu avec les traditions des nomades. Après sa mort, certaines de ces traditions reprirent les dessus et supplantèrent les commandements mahométans. La plupart des conflits qui surgirent au cours du premier siècle de l’hégire ne sont d’ailleurs que le reflet des rivalités qui existaient entre les Bédouins et la bourgeoisie citadine, celle-la même que Mahomet avait pu fréquenter après son riche mariage. Le problème se pose toujours actuellement. Il existe un véritable gouffre entre la manière dont l’establishment arabe conçoit le droit coranique et la conception que peuvent en avoir les pauvres et les « sans grade ». Sur ce plan-là non plus, l’islam n’a pas progressé depuis le VIIe siècle de notre ère.
On peut penser que ces dérives eurent pour origine l’exacerbation des attitudes tribales dans l’agitation consécutive aux victoires remportées par les musulmans lors des guerres de conquête. Le coran, dans une situation exceptionnelle (celle des guerres menées par Mahomet en personne) avait autorisé la polygamie (nous avons déjà dit pourquoi) mais ce qui était considéré primitivement comme une sorte de dérogation à l’usage devint rapidement l’un des traits essentiels du code islamique régissant le mariage. L’exception devint la règle.
Il en résulta une détérioration définitive de la position des femmes mariées dans la société arabo-musulmane. C’est ce qui apparaît très nettement si l’on prend la peine de la comparer avec ce qu’elle était dans la société préislamique. Cette détérioration fut encore accentuée par le fait que de nombreuses pratiques sexuelles, parfaitement respectables, avaient été proscrites par l’islam.
Mahomet avait insisté sur la notion de « fraternité » entre musulmans mais ne s’était guère attardé sur la notion d’égalité. Quand à la notion de « liberté », elle était inexistante dans l’esprit du fondateur de l’islam. Il avait, par contre, tenté de combattre l’orgueil des Arabes et leur esprit de caste (pour mieux les contrôler). On sait cependant que la discrimination sociale et l’orgueil n’ont jamais disparu en terre d’islam. Dès le départ, les convertis non arabes - quel que fut leur statut social antérieur – furent considérés comme des citoyens de seconde catégorie. On les désignait du nom de « mawâli ». Toutes les écoles de droit eurent aussi l’obligation de reconnaître l’existence de « degrés » dans l’échelle sociale. Ces degrés n’interdisaient pas le mariage entre deux personnes de rangs différents mais ils permettaient, le cas échéant, d’en exiger la dissolution par devant le qâdi.
Le coran avait accepté le concubinage tel qu’il existait dans la société arabe préislamique mais, dans le principal verset qui aborde cette question (sourate IV, verset 3), le concubinage apparaît seulement comme une alternative moins coûteuse à la polygamie. On est loin de la pratique du concubinage illimité qui fut pratiqué, en plus de la polygamie, aussitôt que Mahomet eut disparu. Il est vrai qu’il n’avait pas été un parfait exemple en cette matière ! Le concubinage illimité devint une règle reconnue par toutes les écoles coraniques.
Les éléments du droit islamique applicables à la répudiation des épouses constituent également des interprétations abusives des commandements coraniques et l’on peut en dire tout autant de l’obligation, pour les femmes, de porter un voile.
De toute façon, nous savons que la « loi islamique » - au sens strict du terme – n’est apparue qu’au cours du second siècle de l’hégire, plus de cent ans après la mort de Mahomet. Les premiers musulmans s’intéressaient très peu aux aspects « techniques » de la loi et de la justice. Ceci explique la survivance, dans le droit musulman, de pratiques juridiques héritées des peuples soumis au joug arabe.
On peut ainsi mentionner la manière de traiter les religions « tolérées » (judaïsme et christianisme) qui fut calquée sur les règles juridiques de l’empire byzantin. Il en va de même pour les modes d’imposition ou l’institution de l’emphyteusis. Le principe de conservation des pratiques juridiques préislamiques fut même parfois officiellement reconnu, notamment par l’historien al-Balâdhuri (mort en l’an 892 de notre ère). Cependant, en règle générale, des précédents islamiques fictifs furent inventés de toutes pièces en guise de justification.
|
Pour comprendre cette acceptation de concepts et de méthodes juridiques étrangères à la doctrine coranique – lesquels s’étendent jusqu’aux modes de raisonnement et aux idées fondamentales du droit islamique – il faut considérer le rôle joué par les convertis cultivés. Car au cours des deux premiers siècles de l’hégire, ces convertis appartenaient essentiellement aux classes sociales supérieures. Ils étaient les seuls auxquels l’entrée dans la société islamique – même en tant que citoyens de seconde catégorie – permettait d’acquérir des avantages considérables. Ils étaient aussi et surtout ceux qui avaient bénéficié de l’ éducation libérale, imprégnée de rhétorique hellénistique, qui était de règle au Proche-Orient avant la conquête arabo-musulmane. Ces convertis instruits entrèrent en islam avec les idées et les conceptions qui leurs étaient familières et ils les intégrèrent peu à peu dans la nouvelle religion. C’est ainsi que des éléments du droit romain et byzantin, des éléments du droit canon des Eglises orientales, des éléments du droit talmudique et rabbinique, ainsi que des éléments du droit sassanide s’infiltrèrent dans le code islamique naissant. Cette « infiltration » eut lieu pendant la période d’incubation du premier siècle de l’hégire et se concrétisa dans les doctrines islamiques qui furent élaborées entre les IIe et VIIIe siècles de l’hégire.
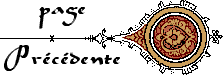 |
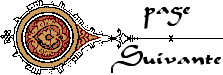 |