
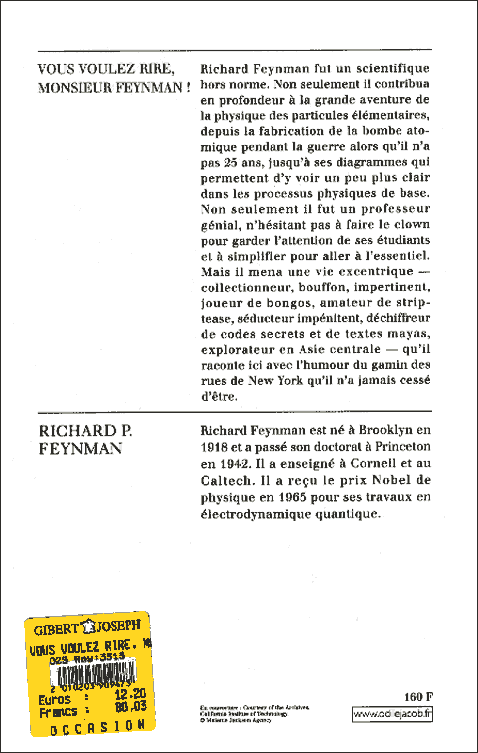
 |
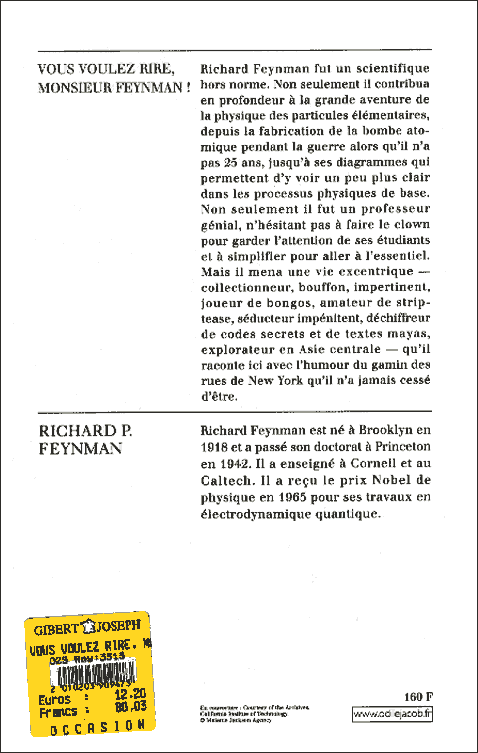 |
"Vous voulez rire, monsieur Feynman !" a été publié par Richard P. Feynman, prix Nobel de physique, et Ralph Leighton en 1985 aux éditions Odile Jacob, 15 rue soufflot, 75005 Paris.
L'édition originale de cet ouvrage a été publié aux Etat-Unis
par W.W. Norton & Company, Inc., New-York,
sous le titre "Surely You're Joking, Mr. Feynman !" Adventures of
a Curious Character as told to Ralph Leighton, edited by Edward Hutchings.
© 1985 by Richard P. Feynman and Ralph Leighton.
Pour la traduction Française :
© , InterEditions, Paris.
ISBN 2.7381.0771.0
Est-il possible de provoquer soi-même ses propres hallucinations ?
A quoi ces hallucinations vont-elles ressembler ?
Ces hallucinations seront-elles distinguables de la réalité ?
Une personne sujette à des hallucinations, peut-elle à la longue arriver à controler, guider, voire provoquer volontairement ces hallucinations ?
Dans un chapitre de ce livre, le professeur Feynman répond à ces questions en nous faisant part de sa PROPRE expérience. Loin de son laboratoire de physique, il expérimente lui-même les phénomènes hallucinatoires.
Les passages surlignés et les [commentaires entre crochets] sont des ajouts qui établissent le parallèle avec le cas de mahomet.
Chapitre "Les états perturbés [de la conscience]" : À une certaine époque, je faisais cours une fois par semaine aux ingénieurs de la Hughes
Aircraft Company. Un jour que j'étais arrivé en avance et que j'en profitais pour faire un brin
de cour à l'hôtesse qui se trouvait à l'entrée, j'ai vu arriver un groupe d'une demi-douzaine de personnes que je n'avais
jamais vues auparavant.
« Est-ce bien ici que le Professeur Feynman fait cours ?
- Oui », a répondu l'hôtesse.
Celui qui avait l'air de diriger le groupe a demandé s'il était possible d'assister au
cours. Je suis intervenu :
« Je ne pense pas que cela puisse vous intéresser ; c'est très technique.
- Je parie que vous êtes le Professeur Feynman », s'est alors exclamée la femme
qui l'accompagnait, et qui avait l'air plus futée que les autres.
Renseignements pris. l'homme s'appelait John Lilly et était l'auteur d'un travail
remarquable sur les dauphins. Sa femme et lui étaient maintenant engagés dans des
recherches sur les effets de carences sensorielles ; pour cela, ils avaient construit
des « caissons à isolation sensorielle » dans lesquels on était entièrement privé de
stimuli sensoriels [un peu comme lorsque mahomet s'isole dans une grotte, dans le noir et dans le silence, privé de stimuli visuels et auditifs].
« Est-ce que ça ne provoque pas des hallucinations ? ai-je demandé tout excité.
- Absolument. »
J'avais de tout temps été fasciné par les images que l'on voit en rêve, et de
façon plus générale, par les images mentales qui ne sont provoquées par aucun
stimulus sensoriel direct. J'avais toujours voulu savoir comment tout ça fonctionne
dans nos têtes et j'avais toujours rêvé d'avoir des hallucinations. À un moment,
j'avais même envisagé de prendre des drogues hallucinogènes ; mais au dernier
moment, j'avais eu peur : faire fonctionner mon cerveau est pour moi un tel plaisir
que je ne tiens pas à bousiller la machine. En revanche, il me semblait qu'un séjour
dans un caisson à isolation sensorielle ne pouvait guère présenter de danger.
C'est pourquoi j'ai immédiatement accepté l'aimable invitation des Lilly à venir
essayer leurs caissons. (Quant à eux, ils sont restés à mon cours, avec tout leur
groupe.)
La semaine suivante, je me suis rendu au laboratoire de M. Lilly. Il m'a conduit à
l'endroit où se trouvaient les caissons. Il y avait partout des lampes (du genre néons)
remplies de gaz différents. M. Lilly m'a débité tout un baratin, tableau de Mendeleiev
à l'appui, d'où il ressortait que les diverses lumières avaient des influences bien
spécifiques. Il m'a aussi expliqué comment me mettre en condition avant d'entrer
dans le caisson : il fallait que je me regarde dans un miroir en appuyant fortement
mon nez contre la glace ; tout cela accompagné d'un blabla inepte dont je n'avais
rien à faire. Mais comme je tenais absolument à faire l'expérience des caissons, j'ai
fait tout ce qu'il m'a demandé ; peut-être d'ailleurs que tous ces préparatifs aidaient
réellement à avoir des hallucinations ? J'ai donc fait scrupuleusement tout ce qu'il
m'a dit de faire ; par contre, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire quand il m'a demandé quelle
lumière je préférais : je croyais que dans le caisson on était plongé dans le noir...
Ces caissons ressemblaient en fait à de grandes baignoires fermées par un
couvercle que l'on rabattait. À l'intérieur, régnait l'obscurité la plus complète [comme dans la grotte où mahomet allait méditer et où il vit « l'Ange Gabriel » pour la première fois] et
comme le couvercle était très épais, on n'y entendait aucun bruit venant de
l'extérieur [comme dans la grotte où mahomet allait méditer et où il vit « l'Ange Gabriel » pour la première fois]. Les caissons étaient équipés d'une petite pompe destinée à renouveler
l'air. En fait, le volume était suffisamment grand pour que le problème ne se pose pas
: d'ailleurs, l'expérience ne durait que quelques heures et en deux ou trois heures,
quand on respire normalement, on ne consomme pas tellement d'air. Mais comme
me l'a expliqué M. Lilly, la pompe était surtout là pour rassurer les gens ; ce n'était
qu'un support psychologique ; c'est pourquoi j'ai demandé à M. Lilly d'arrêter la
pompe qui faisait un peu de bruit.
Dans l'eau de la baignoire on avait ajouté du sulfate de manganèse qui, en
augmentant la densité de l'eau, permettait de flotter plus facilement. La température
était maintenue à une température voisine de celle du corps humain. Rien n'était
laissé au hasard : on ne voyait rien, on n'entendait rien, on ne ressentait aucune
sensation de chaud ou de froid, rien. De temps en temps, le corps roulait légèrement
sur le côté ; ou bien, une goutte de condensation formée sur le couvercle venait à
tomber ; mais tout cela ne se produisait que très rarement.
J'ai fait l'expérience une bonne demi-douzaine de fois et, à chaque fois, je suis resté
près de deux heures et demie dans la cabine. La première fois, je n'ai eu aucune
hallucination [De même mahomet avait pris l'habitude de s'isoler dans une grotte pour méditer et il n'a pas vu « l'Ange Gabriel » la première fois]. La fois suivante, les Lilly m'ont présenté un homme qui se disait
docteur en médecine et qui m'a parlé d'une drogue, la kétamine, que l'on utilisait
surtout en anesthésie. Comme je m'étais toujours intéressé aux phénomènes qui
précèdent l'endormissement, ou qui ont lieu quand on est assommé, j'ai pris, après
avoir lu attentivement la notice qui accompagnait le médicament, un dizième de la
dose normale de kétamine [Ici, le professeur Feynman perturbe volontairement le fonctionnement de sa conscience en faisant usage d'une faible dose de drogue. mahomet n'a pas utilisé de drogue mais le fonctionnement de sa conscience a parfaitement pu être partiellemnt perturbé par une crise de la quarantaine comme il en arrive quotidiennement à de nombreuses personnes.]. J'ai alors ressenti quelque chose que je suis incapable de bien décrire, maintenant
que j'y repense. L'effet de la drogue s'est d'abord fait sentir sur ma vision : je ne
voyais plus distinctement. Pourtant, si je fixais sérieusement mon attention sur
quelque chose, je voyais de nouveau très clairement. C'était un peu comme
lorsqu'on laisse aller son regard sans l'attacher à quelque chose de particulier, on ne
voit pas réellement, tout semble dans le vague ; mais si l'on se concentre, alors tout
redevient normal - pour un moment du moins. Je me suis aperçu, à mon grand
étonnement, que j'étais par exemple tout à fait capable de distinguer les formules
compliquées d'un livre de chimie organique qui traînait par là.
Toujours sous l'effet de la drogue, j'ai fait d'autres expériences, comme par exemple
de rapprocher mes mains l'une de l'autre, pour voir si j'arrivais encore à les faire se
rejoindre. Bien que j'aie eu sur le moment l'impression d'avoir perdu le sens de
l'orientation, il s'est avéré qu'en fait il n'y avait rien que je ne puisse faire en me
concentrant.
J'ai déjà dit que la première fois, je n'avais pas eu d'hallucinations. La deuxième fois,
non plus. Mais j'ai découvert que les Lilly étaient des gens charmants et intéressants
; ils m'ont beaucoup plu et nous avons souvent déjeuné ensemble. Nous en sommes
venus à discuter de toutes ces choses sur un tout autre mode que celui du baratin
qu'il m'avait servi au début. Je me suis aperçu à cette occasion que la plupart des
gens ressentaient lors de leur passage dans les cabines une impression d'effroi. Moi,
j'y voyais surtout une invention ingénieuse et intéressante ; cela ne me procurait
aucun sentiment d'effroi, parce que je savais qu'après tout ce n'était rien d'autre
qu'une baignoire pleine d'eau à laquelle on avait additionné du sulfate de
manganèse.
Lors de mon troisième essai, j'ai fait la connaissance d'un certain Baba Ram Das
(j'ai rencontré des tas de gens intéressants dans cet endroit). Baba Ram Das était
ancien élève de Harvard ; il avait été en Inde et était l'auteur d'un livre intitulé Ici et
Maintenant. Dans ce livre, il racontait comment son gourou lui avait appris, en Inde, à
« sortir de son corps » (ce n'était pas la première fois que je rencontrais cette
expression) : il fallait se concentrer très fort sur sa propre respiration, sentir la
succession des inspirations et expirations.
Ce jour-là, je suis entré dans le caisson, bien décidé à avoir des hallucinations, coûte
que coûte. Et effectivement, au bout d'un moment, je me suis aperçu - c'est difficile à
expliquer - que j'étais à cinq centimètres de moi-même [A comparer avec ce que décrit Salman Rushdie dans son roman Les Versets Sataniques, au bloc cinq de l'extrait qui a donné son nom au roman, bloc débutant par "Mais quand il s'est reposé il entre dans un sommeil différent, une sorte de non-sommeil"...]. En d'autres termes : ma
respiration semblait décentrée ; mon « moi » était déplacé de cinq centimètres
environ.
Je me suis mis à me demander où se trouve situé mon moi. On dit généralement
que la pensée a son siège dans le cerveau - mais qu'est-ce qu'on en sait ? Je
savais, pour l'avoir lu quelque part, que cela n'avait pas toujours été évident. Les
Grecs, par exemple, pensaient que le siège de la pensée se trouve dans le foie. Je
me suis dit : « Si l'on a l'impression que la pensée se situe dans le cerveau, n'est-ce
pas tout simplement parce que, étant enfant, on a vu les grandes personnes se
prendre la tête entre les mains et dire "Laisse-moi réfléchir" ? » L'idée que le moi
puisse être localisé dans le cerveau, derrière le regard, peut-être n'est-ce après tout
qu'une convention. ? Je me suis fait la réflexion que si j'avais pu décentrer mon moi
de cinq centimètres, rien ne s'opposait à ce que je le déplace encore un peu plus. En
fait, j'étais déjà en train d'avoir une hallucination.
En m'appliquant, j'ai réussi à faire descendre mon moi le long de mon cou, jusqu'à
ma poitrine. À un moment, une goutte d'eau, tombée du couvercle, m'a touché
l'épaule et j'ai ressenti une impression bizarre, comme si tout ça se passait au-dessus de mon moi. Mais chaque fois qu'une goutte tombait, j'étais surpris, mon moi
remontait à sa place ordinaire ; et il fallait que je recommence à le faire descendre en
me concentrant. Au début, ça m'a demandé beaucoup d'efforts ; mais petit à petit,
c'est devenu de plus en plus facile. J'ai pu me faire descendre jusqu'aux reins, mais
pas plus loin.
La fois suivante, je me suis dit que puisque j'avais été capable de me déplacer,
jusqu'aux reins, il n'y avait pas de raison pour que je ne puisse pas sortir
complètement de mon corps. Et effectivement, je me suis retrouvé « à côté de moi ».
C'est difficile à expliquer... Je bougeais les mains, je les agitais dans l'eau, et bien
que je ne puisse pas les voir, je savais où elles étaient ; mais au lieu d'être, comme
dans la vie réelle, de part et d'autre de mon corps, mes mains étaient maintenant
toutes les deux du même côté. J'avais exactement la même sensation dans les
doigts que d'habitude, simplement mon moi était à l'extérieur, « en observateur ».
À partir de ce moment-là, j'ai eu des hallucinations à chaque séance et j'ai pu sortir
de « moi » de plus en plus loin. Quand je bougeais les mains, j'avais l'impression qu'il
s'agissait d'objets mécaniques, certainement pas d'objets de chair. Pourtant, j'étais
encore capable de « sensations », et ces sensations étaient en accord avec mes
mouvements ; mais en même temps je me voyais en train de m'observer. Pour finir,
je suis arrivé à faire sortir mon « moi » de la pièce ; il se déplaçait jusqu'à tel ou tel
endroit où, auparavant, j'avais assisté à tel ou tel événement [A comparer avec le fantasmagorique voyage de Mahomet].
J'ai multiplié les expériences de ce genre. Un jour, par exemple, j'ai « vu »
derrière ma tête. J'avais les mains croisées derrière ma nuque, j'ai bougé les doigts,
et entre le pouce et l'index j'ai vu, réellement vu, le ciel bleu. Évidemment ce n'était
qu'une hallucination. Mais - et c'est important - quand je bougeais les doigts, le
mouvement que je sentais correspondait exactement au mouvement que je croyais
voir. Tout ce que je voyais en imagination semblait, et était, en accord avec ce que je
sentais et faisais. C'était un peu comme quand on se réveille lentement : il arrive
qu'on touche quelque chose sans bien comprendre ce que c'est, et puis, tout d'un
coup, on comprend. Là, c'était pareil, sauf que l'impression était pour le moins
inhabituelle : alors qu'on s'imagine en général que le moi est localisé sur le devant de
la tête, là je le ressentais à l'arrière de ma tête.
Ce qui me préoccupait sans cesse durant ces hallucinations, c'était l'idée que
j'étais peut-être tout simplement en train de dormir, qu'il ne s'agissait peut-être que
d'un rêve. Cela me causait du souci, parce que je recherchais des expériences
vraiment nouvelles. Mais ce souci était très émoussé ; quand on a des hallucinations,
on est plutôt dans le cirage, on fait des choses absurdes - comme de vouloir vérifier
que l'on ne rêve pas - sans vraiment y penser, simplement parce que l'on s'est mis
en tête de les faire. Quoi qu'il en soit, je ne cessais de vérifier que je n'étais pas en
train de rêver ; et comme, en général, je me tenais les mains croisées derrière la nuque, je n'arrêtais
pas de frotter mes deux pouces l'un contre l'autre, juste pour les sentir. Évidemment,
j'aurais très bien pu rêver tout cela ; mais quelque chose me disait que cela n'était
pas le cas.
Au bout d'un certain temps, j'ai été capable d'avoir de longues hallucinations ;
j'avais dépassé le stade où la moindre perturbation les faisait surgir ou cesser. [mahomet a eu des hallucinations durant plus de vingt ans. On comprend par conséquent aisément que, tout comme le professeur Feynman, mahomet était parfaitement capable d'avoir de longues hallucinations ayant dépassé le stade où la moindre perturbation les faisait surgir ou cesser. De nombreux hadiths témoignent de "révélations" faites dans les circonstances les plus diverses et parfois "sur-commande", "révélations" de mieux en mieux maitrisées au fur et à mesure que les années passent] Au bout de deux semaines, je me suis mis à réfléchir à la manière différente dont
le cerveau et un ordinateur stockent l'information. Comment le cerveau accumule-t-il
et garde-t-il en mémoire les souvenirs ? Comment fonctionne la mémoire du cerveau
? Contrairement à ce qui se passe avec les ordinateurs, où les ordres doivent être
correctement adressés pour être exécutés, l'accès aux cases mémoires du cerveau
peut s'effectuer de plusieurs façons et il n'est pas nécessaire d'en connaître l'adresse
exacte. Prenons le mot « location » ; je peux y avoir accès à l'occasion d'un mot
croisé, en cherchant un mot qui commence par « lo », qui a un « a » au milieu et qui
finit par « on », ou bien, en pensant à des transactions immobilières ou financières,
liées à la location d'un appartement par exemple. Ce mot-là à son tour m'ouvre un
tas d'autres « mémoires » qui lui sont associées. Je me suis alors mis à réfléchir à la
possibilité de construire un ordinateur « imitant », à qui l'on parlerait et qui apprendrait
à parler par imitation, comme le font les enfants qui apprennent à parler. Mais je
n'arrivais pas à imaginer un moyen pour que la machine stocke l'information de
manière à pouvoir l'utiliser pour son propre usage.
À la suite de ces réflexions, je me suis mis à fixer mon attention, durant mes périodes d'hallucinations, sur mes tout premiers souvenirs.
J'essayais de remonter toujours plus loin dans mes souvenirs. J'ai alors constaté que
lorsque je retrouvais un souvenir, datant par exemple de Far Rockaway,
immédiatement je sentais me revenir tout un tas d'autres souvenirs liés à Far
Rockaway. Et si je changeais d'endroit, si je me mettais à penser à Cedarhurst par
exemple, alors tout un tas de trucs associés à Cedarhurst me revenaient en
mémoire. J'en ai conclu que les souvenirs sont rangés dans la mémoire selon
l'endroit où l'événement dont on se souvient s'est passé.
Le jour où j'ai fait cette « découverte », je suis sorti du caisson fort content de moi
; j'ai pris une douche ; je me suis rhabillé et je me suis mis en route pour Hughes
Aircraft où je devais faire cours. Ce n'est que trois quarts d'heure après être sorti du
caisson que je me suis aperçu qu'en fait je n'avais rien découvert du tout, que je
n'étais pas plus avancé qu'auparavant et que je n'en savais toujours pas plus sur le
fonctionnement du cerveau. J'avais simplement eu une hallucination portant sur le
stockage de l'information dans le cerveau. Ce que j'avais découvert n'avait rien à voir
avec la question en général ; c'était purement subjectif et personnel.
Au cours des nombreuses discussions que j'avais eues avec les Lilly, ou d'autres,
j'avais essayé de leur faire comprendre que la réalité n'a rien à voir avec la manière
dont on s'imagine les choses réelles. Si à force de voir un globe doré (je dis un globe
doré comme je dirais n'importe quoi d'autre) [par exemple si à force d'avoir entendu parler de l'ange Gabriel, de la bible, de moïse, d'abraham, des évangiles etc...], quelqu'un [par exemple mahomet] s'imagine, lors d'une
hallucination, qu'un globe doré [ou l'Ange Gabriel] lui parle et lui révèle qu'il existe une autre forme
d'intelligence [ou lui parle et lui révèle qu'il n'existe qu'un et un seul dieu, Allah-le-Tout-Miséricordieux-le-Très-Miséricordieux, et que lui, mahomet, est son prophète], cela ne prouve nullement qu'il existe d'autres formes d'intelligence [cela ne prouve nullement qu'il n'existe qu'un et un seul dieu, Allah-le-Tout-Miséricordieux-le-Très-Miséricordieux, et que lui, mahomet, est son prophète] ;
tout ce que l'on peut dire, c'est que cette personne a eu une hallucination liée aux
globes dorés [Tout ce que l'on peut dire c'est que mahomet a eu une hallucination liée à l'Ange Gabriel]. Dans mon cas, c'était la même chose ; j'avais cru, réellement cru, avoir
découvert comment l'information est stockée dans le cerveau et il m'avait fallu plus
de trois quarts d'heure pour m'apercevoir de mon erreur [Au bout de plus de vingt ans, mahomet ne s'est pas aperçu de son erreur, au bout de plus de 1000 ans, les musulmans ne se sont toujours pas aperçus de leur erreur. Ce doit être pour cela que mahomet n'a jamais eu le prix Nobel de physique, ni aucun musulman, jusqu'à ce qu'on leur donne un lot de consolation avec un prix nobel de la paix attribué à une iranienne en 2003]. Pourtant, ce n'était pas
faute d'avoir mis les autres en garde contre ce genre d'illusion.
Je me posais, entre autres questions, celle de savoir si les hallucinations, tout
comme les rêves, dépendent de ce que l'on a déjà en tête - des désirs ou des
expériences diurnes. N'était-ce pas parce que nous avions longuement discuté de
ces expériences où l'« on sort de soi-même » que j'avais eu précisément ce type
d'hallucination ? [N'était-ce pas parce que mahomet avait souvent entendu parler de l'Ange Gabriel qu'il a eu précisément ce type d'hallucination ?] Et n'était-ce pas parce que j'avais réfléchi à la manière dont
l'information est stockée dans le cerveau que j'avais eu cette dernière hallucination ?
J'ai beaucoup discuté avec les gens que j'ai rencontrés chez rencontrés Lilly sur la
réalité de l'expérience. D'après eux, une expérience devait être considérée comme
réelle dès lors qu'elle était reproductible. Dans ces conditions, si quelqu'un voit à
plusieurs reprises un globe doré lui parler, ce globe doit être considéré comme réel.
Selon moi, dans ces cas-là on découvre toujours, en cherchant bien, que la
personne en question avait déjà, avant d'entrer dans la cabine, l'esprit occupé par les
globes dorés ; par exemple parce qu'elle venait d'en discuter avec d'autres. Si bien
que lorsque dans son hallucination elle voit quelque chose qui ressemble de près ou
de loin à un globe doré - une sphère bleue par exemple - il lui semble que
l'expérience se répète. Il me semble qu'il faut distinguer le type d'unanimité que l'on
obtient de gens déjà convaincus du type d'unanimité que l'on rencontre dans le
travail expérimental. Je m'étonne qu'une notion aussi simple à concevoir soit aussi
difficile à préciser.
Je suis persuadé qu'il n'y a rien dans les hallucinations qui ne puisse être
rapporté à l'état psychique interne de celui qui est le sujet de ces hallucinations. Mais
on ne peut nier que les gens qui éprouvent des hallucinations croient en la réalité de
leurs hallucinations. [C'est ce qui a trompé les Arabes de l'époque de mahomet, c'est aussi ce qui trompe les adeptes de La Révélation d'Arès. Cela ne devrait pourtant plus nous tromper maintenant que nous sommes au 21ème siècle et que les connaissances en psychologie et en psychiatrie ont fait la lumière sur ces phénomènes] On pourrait en dire autant de l'interprétation des rêves et c'est
comme cela que j'explique le succès remporté par ceux qui prétendent interpréter les
rêves. En disant cela, je pense évidemment aux psychanalystes qui tentent
d'interpréter les rêves à coups de symboles dont ils expliquent la signification à leur
patient. Rien d'étonnant alors à ce que ces mêmes symboles fassent leur apparition
dans les rêves que fait ensuite ledit patient. À mon avis, l'interprétation des
hallucinations, tout comme l'interprétation des rêves, sont des phénomènes qui une
fois lancés s'entretiennent d'eux-mêmes [C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de mahomet]; on y réussit d'autant mieux que l'on en
discute plus avec celui qui rêve ou est halluciné [C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de mahomet, d'abord avec sa femme, puis avec Ali son premier disciple, puis avec ses premiers convertis, puis avec les gens de Médine, puis avec les gens de La Mecque].
En règle générale, il me fallait à peu près quinze minutes pour arriver à ressentir une
hallucination ; mais ces quinze minutes pouvaient être réduites à quelques minutes
lorsque je consommais de la marijuana. Souvent alors, au moment où commençait
l'hallucination, j'étais la proie de pensées désordonnées et confuses ; il me semblait
que je vidais la poubelle de mes pensées. J'ai souvent essayé de me souvenir après
coup du contenu de cette poubelle, sans jamais y arriver vraiment. Je pense que cet
état confus ressemble à celui dans lequel on se trouve au moment de s'endormir.
Apparemment les pensées s'enchaînent les unes aux autres de façon logique, mais
lorsqu'on tente de rétablir la succession des pensées, de se rappeler comment on
est passé de telle pensée à telle autre, on n'y parvient pas. De fait, on en arrive
même à oublier ce que l'on est en train de chercher à retrouver ; ça File entre les
doigts.
M. Lilly avait réalisé plusieurs réalisé plusieurs cabines, que cabines, toutes
essayées, sans remarquer de grandes différences dans la nature de mes
hallucinations. J'en suis venu à penser que la cabine ne joue guère de rôle dans le
phénomène des hallucinations et que l'on peut s'en passer. J'ai donc essayé d'avoir
des hallucinations chez moi, allongé dans le noir [Comme la première fois pour mahomet dans sa grotte]. Eh bien, je n'ai jamais réussi à
éprouver la moindre hallucination dans ces conditions. J'aurais bien aimé ; mais je
n'y suis jamais arrivé [parce que le professeur Feynman n'était pas naturellement enclin aux hallucinations, contrairement à mahomet à partir de sa crise de la quarantaine. Qui plus est, le professeur Feynman, contrairement à mahomet, n'a pas construit sa vie exclusivement sur ses hallucinations]. Pourtant, je suis persuadé que cela n'a rien d'impossible, qu'il
suffit de s'entraîner [C'est exactement ce qu'a fait mahomet durant ses premières années de prêchi-prêcha à La Mecque];
mais je n'ai jamais pris le temps de m'entraîner. [Mahomet, lui, n'a fait que cela à partir de sa crise de la quarantaine et jusque sur son lit de mort.]