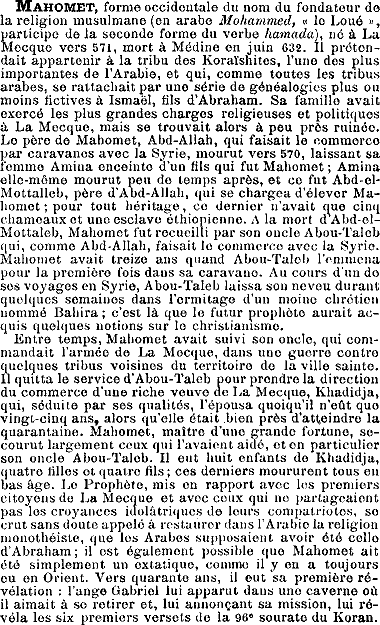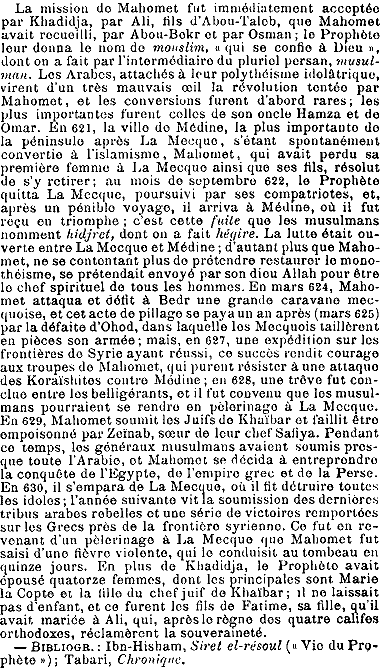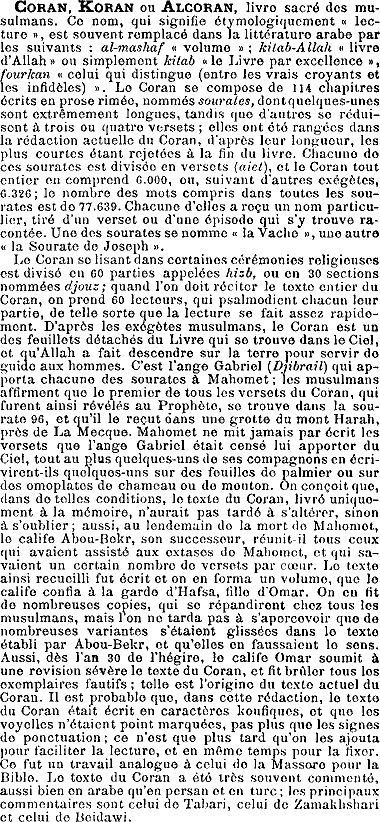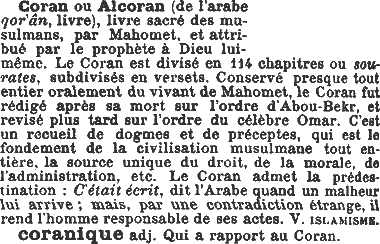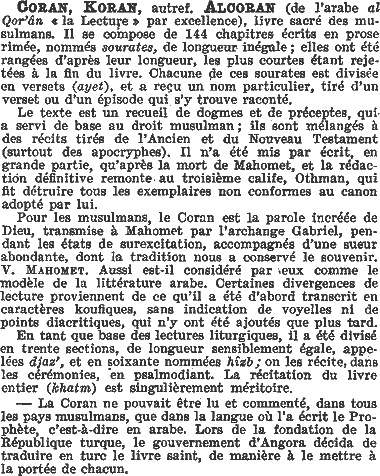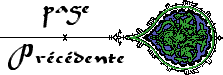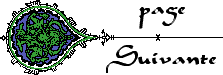Le coran, Etude analytique > Versets sataniques page 2
Notons
que le mot « islam » est donné comme
issu de l’arabe « slam’ »
signifiant « résignation ». On note
aussi que les partisans de l’islamisme sont nommés
« islamites » et non « islamistes »
comme c’est le cas aujourd’hui. Il apparaît très
clairement que les termes « musulmans »,
« mahométans » ou « islamites » et sa forme moderne
« islamistes », sont de parfaits synonymes.
Ils veulent dire exactement la même chose (partisans de l'islamisme = mahométans = musulmans) et peuvent être
employés indifféremment l’un pour l’autre.
Il
n’y a pas, comme on cherche à nous le faire croire, les
« bons musulmans » d’un côté
et les « méchants islamistes » de
l’autre.
Il n'y a que, d'un côté, les musulmans à qui le droit laïque et démocratique ambiant interdit de mettre en application CERTAINS préceptes de l'islam et, de l'autre côté, les musulmans qui ont, s'arrogent ou tentent d'obtenir légalement, le droit d'appliquer TOUS les préceptes de ce MÊME islam. |
Ergoter entre « musulmans », « musulmans modérés », « musulmans laïques », « islamistes », « musulmans intégristes » ou « musulmans fondamentalistes » n’est
qu’artifice de langage. On ne parle pas de « catholiques modérés », de « protestants laïques », de « boudhistes intégristes » ou autres. Cette multiplication de qualificatifs au bénéfice exclusif des musulmans, c’est de la poudre aux yeux pour
berner les naïfs et les ignorants, ceux-là même qui
croient encore que l’islam est une sorte de christianisme à
la mode orientale tandis que le coran serait une manière de
Bible écrite en langue arabe.
Nous allons toutefois céder à la mode en proposant nous aussi, à titre expérimental, de nouveaux termes permettant d'englober, de clarifier, et ,in-fine, de remplacer tous ceux qui précèdent :
Mahométisme : doctrine pronant Mahomet comme prophète et beau modèle, le coran comme livre inimitable et parole de Dieu, l'islam comme religion et culture.
Mahométique : conforme au mahométisme.
Mahométiste : adepte du mahométisme.
Cette définition serait bien entendu incomplète sans les nuances typiques qu'affectionnent les intellectuels :
modéré : mahométiste pronant de ne pas contrevenir aux lois locales contrevenant les lois mahométiques, sauf si le rapport de force permet de se soustraire aux sanctions locales prévues.
intégriste : mahométiste pronant de contrevenir aux lois locales contrevenant les lois mahométiques, sauf si le rapport de force ne permet pas de se soustraire aux sanctions locales prévues.
mauvais : mahométiste intégriste ne sachant pas évaluer un rapport de force.
bon : mahométiste modéré sachant évaluer un rapport de force.
laïque : mahométiste ne sachant pas ce qu'est un rapport de force.
Mahométiser : convertir au mahométisme, appliquer la loi mahométique.
Mahométisation : action de mahométiser.
Tant que nous y sommes, voici quelques autres définitions à connaître, quoique peu usitées :
Mahométal : élaboré selon les rites mahométiques.
Mahométalal : forme désuète de "mahométal".
Mahométanique : aussi grand que Mahomet.
Mahométer : agir comme Mahomet.
Mahométhon : animation télévisée destinée à recueillir des fonds pour la recherche mahométique.
Mahométiagra : médicament paradisiaque.
Mahométissant : qui rend mahométique.
Mahométix : personnage légendaire ayant tenté sans succés de convertir au mahométisme un village d'irréductibles gaulois.
Mahométogyne : femme possèdant les caractéristiques sexuelles de Mahomet.
Mahométoïde : famille d'alcaloïdes canabiques lysergiques diéthylamides ecstasyques.
Mahométologie : science qui étudie Mahomet.
Mahométonique : qui fouette.
Mahométonyme : se dit d'une personne qui s'appelle mohammed ou muhammad.
Mahométopathie : système thérapeutique qui consisite à traiter les malades à l'aide du mahométisme.
Mahométopathe : mahométiste intégriste fou.
Mahométophage : qui bouffe du mahométiste.
Mahométophobe : crainte pathologique du mahométisme et des mahométistes.
Mahométorique : ensemble de procédés permettant de parler comme Mahomet.
Mahométrique : ensemble des mesures ayant pour base Mahomet.
Mahométrologie : science qui étudie les mensurations de Mahomet.
Mahométude : mahométisation des facultés intellectuelles.
Mais revenons à nos définitions officielles...
A « Mahomet »,
et toujours dans le même dictionnaire (Larousse 1905), on trouve la définition
suivante :
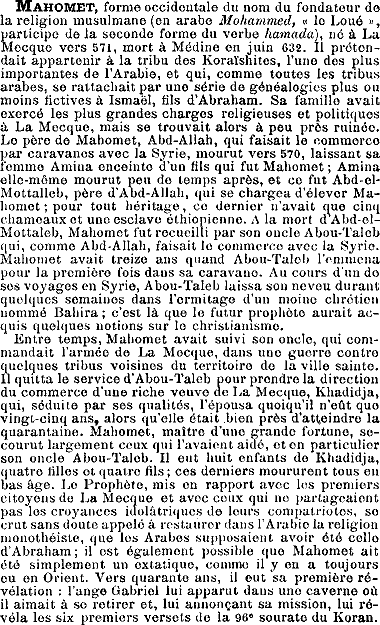 |
MAHOMET, forme occidentale du nom du fondateur de la religion musulmane (en arabe Mohammed, « le Loué », participe de la seconde forme du verbe hamada}, né à La Mecque vers 571, mort à Médine en juin 632. il prétendait appartenir à la tribu des Koraïshites, l'une des plus importantes de l'Arabie, et qui, comme toutes les tribus arabes, se rattachait par une série de généalogies plus ou moins fictives à Ismaël, fils d'Abraham. Sa famille avait exercé les plus grandes charges religieuses et politiques à La Mecque, mais se trouvait alors à peu près ruinée. Le père de Mahomet, Abd-Allah, qui faisait le commerce par caravanes avec la Syrie, mourut vers 570, laissant sa femme Amina enceinte d'un fils qui fut Mahomet ; Amina elle-même mourut peu de temps après, et ce fut Abd-el-Mottalleb, père d'Abd-Allah, qui se chargea d'élever Mahomet ; pour tout héritage, ce dernier n'avait que cinq chameaux et une esclave éthiopienne. A la mort dAbd-el-Mottaleb, Mahomet fut recueilli par son oncle Abou-Taleb qui, comme Abd-Allah, faisait le commerce avec la Syrie. Mahomet avait treize ans quand Abou-Taleb l'emmena pour la première fois dans sa caravane. Au cours d'un de ses voyages en Syrie, Abou-Taleb laissa son neveu durant quelques semaines dans l'ermitage d'un moine chrétien nommé Bahira; c'est là que le futur prophète aurait acquis quelques notions sur le christianisme.
Entre temps, Mahomet avait suivi son oncle, qui commandait l'armée de La Mecque, dans une guerre contre quelques tribus voisines du territoire de la ville sainte. Il quitta le service d'Abou-Taleb pour prendre la direction du commerce d'une riche veuve de La Mecque, Khadidja, qui, séduite par ses qualités, l'épousa quoiqu'il n'eût que vingt-cinq ans, alors qu'elle était bien près d'atteindre la quarantaine. Mahomet, maître d'une grande fortune, secourut largement ceux qui l'avaient aidé, et en particulier son oncle Abou-Taleb. Il eut huit enfants de Khadidja, quatre lilles et quatre fils ; ces derniers moururent tous en bas âge. Le Prophète, mis en rapport avec les premiers citoyens de La Mecque et avec ceux qui ne partageaient pas les croyances idolâtriques de leurs compatriotes, se crut sans doute appelé à restaurer dans l'Arabie la religion monothéiste, que les Arabes supposaient avoir été celle d'Abraham; il est également possible que Mahomet ait été simplement un extatique, comme il y en a toujours eu en Orient. Vers quarante ans, il eut sa première révélation ; l'ange Gabriel lui apparut dans une caverne où il aimait à se retirer et, lui annonçant sa mission, lui révéla les six premiers versets de la 96e sourate du Koran. |
Il est
intéressant de relever que cette première partie de la
définition, bien que très « classique »
sur le plan historique, tend à présenter Mahomet comme
un personnage qui s’est « cru appelé »
à restaurer la religion monothéiste en Arabie ou encore
comme un « extatique » à la mode
orientale. Quelle que soit la solution retenue (il se peut qu’il
ait été un mélange des deux), cela revient à
dire que Mahomet fut un manipulateur et que ses « révélations »
n’avaient strictement rien de « divines ».
Au tout début du XXe siècle, le principal dictionnaire
de la langue française (tout au moins sur le plan de la
diffusion) indiquait donc que, selon toute vraisemblance, l’islam se fondait sur une
mystification. C’est évident pour n’importe quel
analyste sérieux mais ça ne l’est toujours pas
pour toute une série d’ « intellectuels
négationnistes », musulmans et non musulmans, qui
persistent à nier des réalités pourtant
flagrantes. D’où la nécessité de poursuivre
pour « négationnisme », tout individu
qui ose présenter Mahomet et l’islam sous des aspects
fallacieux et mensongers.
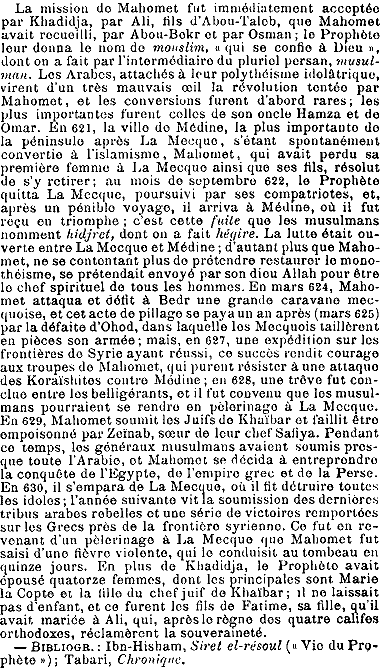 |
La mission de Mahomet fut immédiatement acceptée par Khadidja, par Ali, fils d'Abou-Taleb, que Mahomet avait recueilli, par Abou-Bekr et par Osman ; le Prophète leur donna le nom de mouslim, « qui se confie à Dieu », dont on a fait par l'intermédiaire du pluriel persan, musulman. Les Arabes, attachés à leur polythéisme idôlatrique, virent d'un très mauvais œil la révolution tentée par Mahomet, et les conversions furent d'abord rares; les plus importantes furent celles de son oncle Hamza et de Omar. En 621, la ville de Médine, la plus importante de la péninsule après La Mecque, s'étant spontanément convertie à l'islamisme, Mahomet, qui avait perdu sa première femme à La Mecque ainsi que ses fils, résolut de s'y retirer; au mois de septembre 622, le Prophète quitta La Mecque, poursuivi par ses compatriotes, et, après un pénible voyage, il arriva à Médine, où il fut reçu on triomphe ; c'est cette fuite que les musulmans nomment hidjret, dont on a fait hégyire. La lutte était ouverte entre La Mecque et Médine ; d'autant plus que Mahomet, ne se contentant plus de prétendre restaurer le monothéisme, se prétendait envoyé par son dieu Allah pour être le chef spirituel de tous les hommes. En mars 624, Mahomet attaqua et défit à Bedr une grande caravane mecquoise, et cet acte de pillage se paya un an après (mars 625) par la défaite d'Ohod, dans laquelle les Mecquois taillèrent en pièces son armée; mais, en 627, une expédition sur les frontières de Syrie ayant réussi, ce succès rendit courage aux troupes de Mahomet, qui purent résister à une attaque des Koraïshites contre Médine; en 628, une trêve fut conclue entre les belligérants, et il fut convenu que les musulmans pourraient se rendre en pèlerinage à La Mecque. En 629, Mahomet soumit les Juifs de Khaïbar et faillit être empoisonné par Zeïnab, sœur de leur chef Safiya. Pendant ce temps, les généraux musulmans avaient soumis presque toute l'Arabie, et Mahomet se décida à entreprendre la conquête de l'Egypte, de l'empire grec et de la Perse. En 630, il s'empara de La Mecque, où il fit détruire toutes les idoles; l'année suivante vit la soumission des dernières tribus arabes rebelles et une série de victoires remportées sur les Grecs près de la frontière syrienne. Ce fut en revenant d'un pèlerinage à La Mecque que Mahomet fut saisi d'une fièvre violente, qui le conduisit au tombeau en quinze jours. En plus de Khadidja, le Prophète avait épousé quatorze femmes, dont les principales sont Marie la Copte et la lille du chef juif de Khaïbar; il ne laissait pas d'enfant, et ce furent les fils de Fatima, sa fille, qu'il avait mariée à Ali, qui, après le règne des quatre califes orthodoxes, réclamèrent la souveraineté.
— BIBLIOGR. : Ibn-Hisham, Siret el-resoul (« Vie du Prophète»); Tabari, Chronique. |
Le Larousse en 7 volumes de 1905 consacre aussi une
dizaine de lignes à « Mahomet ou le Fanatisme »,
cette pièce de Voltaire qui semble curieusement « oubliée »
par les auteurs de dictionnaires et d’encyclopédie de ce
début de XXIe siècle (voir chapitre 13).
La troisième définition qui nous
intéresse est bien évidemment celle du mot « coran ».
Celle qui figure dans le « Nouveau Larousse illustré
de 1905 » est très complète.
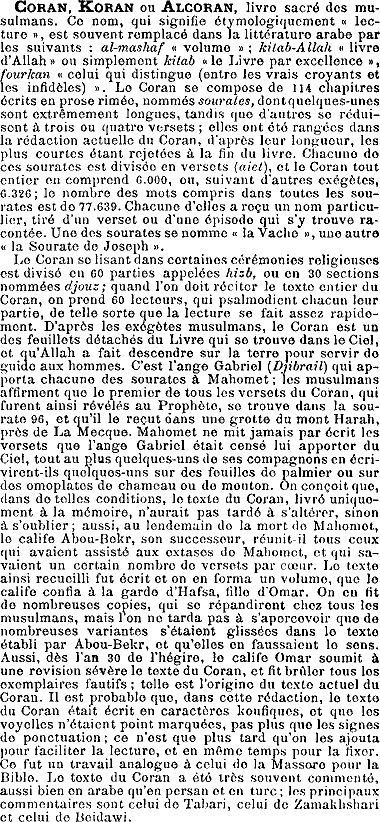 |
CORAN, KORAN ou ALCORAN, livre sacré des musulmans. Ce nom, qui signifie étymologiquement « lecture », est souvent remplacé dans la littérature arabe par les suivants : al-mashaf « volume » ; kitab-Allah « livre d'Allah » ou simplement kitab « le Livre par excellence », fourkan « celui qui distingue (entre les vrais croyants et les infidèles ». le Coran se compose de 114 chapitres écrits en prose rimée, nommés sourates, dont quelques-unes sont extrêmement longues, tandis que d'autres se réduisent à trois ou quatre versets ; elles ont été rangées dans la rédaction actuelle du Coran, d'après leur longueur, les plus courtes étant rejetées à la fin du livre. Chacune de ces sourates est divisée en versets (aiet), et le Coran tout entier en comprend 6.000, ou, suivant d'autres exégètcs, 6.326; le nombre des mots compris dans toutes les sourates est de 77.639. Chacune d'elles a reçu un nom particulier, tiré d'un verset ou d'une épisode qui s'y trouve racontée. Une des sourates se nomme « la Vache », une autre « la Sourate de Joseph ».
le Coran se lisant dans certaines cérémonies religieuses est divisé en 60 parties appelées hizb, ou en 30 sections nommées djouz ; quand l'on doit réciter le texte entier du Coran, on prend 60 lecteurs, qui psalmodient chacun leur partie, de telle sorte que la lecture se fait assez rapidement. D'après les exégètes musulmans, le Coran est un des feuillets détachés du Livre qui se trouve dans le Ciel, et qu'Allah a fait descendre sur la terre pour servir de guide aux hommes. C'est l'ange Gabriel {Djibrail) qui apporta chacune des sourates à Mahomet; les musulmans affirment que le premier de tous les versets du Coran, qui furent ainsi révélés au Prophète, se trouve dans la sourate 96, et qu'il le reçut dans une grotte du mont Harah, près de La Mecque. Mahomet ne mit jamais par écrit les versets que l'ange Gabriel était censé lui apporter du Ciel, tout au plus quelques-uns de ses compagnons en écrivirent-ils quelques-uns sur des feuilles de palmier ou sur des omoplates de chameau ou de mouton. On conçoit que, dans de telles conditions, le texte du Coran, livré uniquement à la mémoire, n'aurait pas tardé à s'altérer, sinon à s'oublier; aussi, au lendemain de la mort de Mahomet, le calife Abou-Bekr, son successeur, réunit-il tous ceux qui avaient assisté aux extases de Mahomet, et qui savaient un certain nombre de versets par cœur. Le texte ainsi recueilli fut écrit et on en forma un volume, que le calife confia à la garde d'Hafsa, fille d'Omar. On en fît de nombreuses copies, qui se répandirent chez tous les musulmans, mais l'on ne tarda pas à s'apercevoir que de nombreuses variantes s'étaient glissées dans le texte établi par Abou-Bekr, et qu'elles on faussaient le sens. Aussi, dès l'an 30 de l'hégire, le calife Omar soumit à une révision sévère le texte du Coran, et fit brûler tous les exemplaires fautifs; telle est l'origine du texte actuel du Coran. Il est probable que, dans cotte rédaction, le texte du Coran était écrit en caractères koufiques, et que les voyelles n'étaient point marquées, pas plus que les signes de ponctuation; ce n'est que plus tard qu'on les ajouta pour faciliter la lecture, et en même temps pour la fixer. Ce fut un travail analogue à celui de la Massore pour la Bible. Le texte du Coran a été très souvent commenté, aussi bien en arabe qu'en persan et en turc; les principaux commentaires sont celui de Tabari, celui de Zamakhshari et celui de Beidawi. |
Hormis quelques détails purement
« techniques » (comme le nombre de versets ou
de mots, sans grand intérêt pratique), cette définition
es strictement classique. Contrairement à ce qui figure dans
le « Grand Mémento encyclopédique »
(voir plus haut), il n’est pas fait mention des versets dits
« sataniques ».
En ce qui
concerne le culte musulman proprement dit, le mémento en deux
volumes de 1936 nous rappelle que l’islam suppose la soumission
totale et que le musulman « …a le sentiment de
la dépendance totale de l’homme en face d’une
toute-puissance illimitée à laquelle il doit
s’abandonner en abdiquant toute volonté propre… »
en précisant encore que « …Ce
pouvoir sans limites de la divinité, qui a pour corollaire
l’abandon total de l’être humain, exige que, dans
tous les domaines, l’activité de l’homme soit régie
par des règles précises et inéluctables. Il ne
saurait donc exister d’actes indifférents et l’islam
aura son mot à dire sur tous les problèmes… ».
C’est la parfaite définition de ce qu’est une
« dictature religieuse »,
au sens strict et déplorable du terme. On nous rappelle aussi
que cinq « prières » quotidiennes sont
obligatoires pour les musulmans mais qu’il ne s’agit pas de
« prières » au sens occidental du terme
puisque « …la prière musulmane est un
acte d’adoration de la divinité, à laquelle il
serait malséant et inopérant d’adresser une
demande… ». De fait, le musulman ne prie pas au sens mystique du terme :
il se prosterne afin de montrer sa soumission à ce
dieu que le Coran nomme Allah.
Allah... divinité omnipotente mais invisible, impalpable, inaccessible... et résolument muette.
Car Allah ne s’est jamais adressé à personne, pas
même à Mahomet. Et pour cause, puisqu’il n’existe
que dans l’imagination fertile des populations superstitieuses manipulées avec une adresse toute
« satanique » par des voyous sans scrupules !
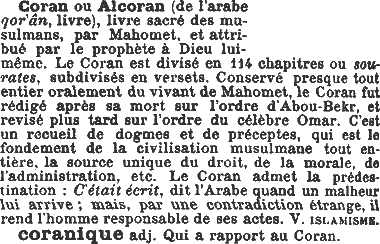 |
Coran ou Alcoran (de l'arabe qor'ân, livre), livre sacré des musulmans, par Mahomet, et attribué par le prophète à Dieu lui-même. Le Coran est divisé en 114 chapitres ou sourates, subdivisés en versets. Conservé presque tout entier oralement du vivant de Mahomet, le Coran fut rédigé après sa mort sur l'ordre d'Abou-Bekr, et révisé plus tard sur l'ordre du célèbre Omar. C'est un recueil de dogmes et de préceptes, qui est le fondement de la civilisation musulmane tout entière, la source unique du droit, de la morale, de l'administration, etc. Le Coran admet la prédestination : C'était écrit, dit l'Arabe quand un malheur lui arrive, mais, par une contradiction étrange, il rend l'homme responsable de ses actes. V. ISLAMISME.
coranique adj. Qui a rapport au Coran.
|
Le Coran :
définition donnée par le « Larousse
universel en 2 volumes » - Edition de 1922
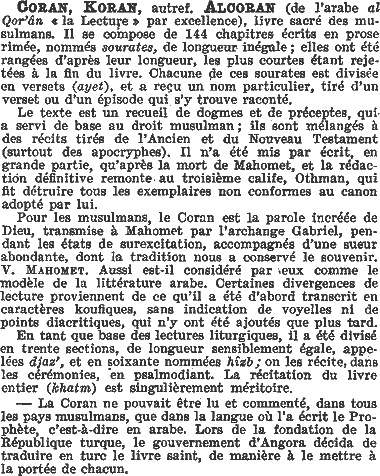 |
CORAN, KORAN, autref. ALCORAN (de l'arabe al Qor'ân « la Lectuye » par excellence), livre sacré des musulmans. Il se compose de 144 chapitres écrits en prose rimée, nommés sourates, de longueur inégale ; elles ont été rangées d'après leur longueur, les plus courtes étant rejetées à la fin du livre. Chacune de ces sourates est divisée en versets (ayet), et a reçu un nom particulier, tiré d'un verset ou d'un épisode qui s'y trouve raconté.
Le texte est un recueil de dogmes et de préceptes, qui a servi de base au droit musulman ; ils sont mélangés à des récits tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament (surtout des apocryphes). II n'a été mis par écrit, en grande partie, qu'après la mort de Mahomet, et la rédaction définitive remonte au troisième calife, Othman, qui fit détruire tous les exemplaires non conformes au canon adopté par lui.
Pour les musulmans, le Coran est la parole incréée de Dieu, transmise à Mahomet par l'archange Gabriel, pendant les états de surexcitation, accompagnés d'une sueur abondante, dont Ïa tradition nous a conservé le souvenir. V. MAHOMET. Aussi est-il considéré par eux comme le modèle de la littérature arabe. Certaines divergences de lecture proviennent de ce qu'il a été d'abord transcrit en caractères koufiques, sans indication de voyelles ni de points diacritiques, qui n'y ont été ajoutés que plus tard.
En tant que base des lectures liturgiques, il a été divisé en trente sections, de longueur sensiblement égale, appelées djaz' et en soixante nommées hîzb; on les récite, dans les cérémonies, en psalmodiant. La récitation du livre entier (khatm) est singulièrement méritoire.
— Le Coran ne pouvait être lu et commenté, dans tous les pays musulmans, que dans la langue où l'a écrit le Prophète, c'est-à-dire en arabe. Lors de la fondation de la République turque, le gouvernement d'Angora décida de traduire en turc le livre saint, de manière à le mettre à la portée de chacun. |
Définition
extraite du « Larousse du XXe siècle »
(en 6 volumes) – 1929
Les définitions données par les dictionnaires du XIXe
siècle ou de la première moitié du XXe siècle
sont sans complaisance vis-à-vis de l’islam. Elles sont
claires et n’hésitent pas à présenter le Coran comme n’étant rien d'autre qu'une
adaptation des écrits bibliques. |