
Les versets dits « sataniques »
Le coran, Etude analytique > Versets sataniques

Les versets dits « sataniques »
Nous avons évoqué, à plusieurs reprises, et dès le début de cette étude (dans le chapitre 2), les versets du coran que l’on qualifie de « sataniques » et qui ont servi de prétexte au pseudo roman de Salman Rushdie « les versets sataniques ».
Nous avons dit que les musulmans nient l’existence de ces versets qui avaient été consignés dans les premières versions du coran (celles qui ont été détruites sur ordre du calife Othman) et qui ont ensuite fait l’objet d’une transmission orale au sein de plusieurs branches schismatiques de l’islam. Il est un fait que ces versets sont extrêmement gênants pour les musulmans. Ils démontrent que Mahomet n’était qu’un mystificateur, un manipulateur qui avait tenté d’accommoder ses prétendues « révélations divines » en y incorporant des éléments issus du panthéon arabe qui avait les faveurs des habitants de la Mekke.
Aujourd’hui, les « intellectuels » occidentaux ont, pour la plupart, adopté une fort prudente « réserve » à propos de ces fameux versets. Car il est « de bon ton » de ne pas choquer une communauté musulmane de plus en plus susceptible et surtout de plus en plus agressive et belliqueuse.
Il n’en a cependant pas toujours été ainsi. Si nous nous reportons, par exemple, au très sérieux « Grand mémento encyclopédique » de Larousse – édition de 1936 - nous pouvons lire, à la rubrique « Histoire des Arabes » (tome 1 – pp.225 à 230) que «…Il semble qu’au début de son apostolat, Mahomet ait tenté de gagner des adeptes parmi les Koréichites en introduisant, dans la suite d’Allah Très-Haut, les divinités inférieures des sanctuaires mecquois… ». Sans que cela soit précisé dans le texte, il s’agit bien là d’une allusion directe à l’affaire des versets sataniques. Et les éminents rédacteurs d’ajouter : « Il est probable que, contrairement à la tradition, les Koreichites ne se sont vraiment préoccupés de lui (Mahomet) et de sa doctrine que quand celle-ci eut affirmé son horreur pour les idoles et que la communauté musulmane eut pris, par la conversion d’Abou-Bekr, de Hamza et d’Omar, une réelle importance. Puis Mahomet chercha un autre milieu où développer sa doctrine. Il prit garde de ne point se tourner vers les Bédouins chez lesquels il ne pouvait trouver que mépris du sédentaire et indifférence religieuse. Après la mort de Khadidja, il fit une tentative sur At-Taïf, petite cité montagnarde célèbre pour son sanctuaire de la déesse Al-Lât et habitée par une population liée aux Koréichites par une alliance intime : il y fut fort mal reçu. Il comprit qu’il lui fallait se tourner vers Yathreb, ville et oasis à 400 kilomètres de La Mecque, dont les habitants, d’origine yéménite et agriculteurs, étaient en rivalité avec les Mecquois, Arabes du Nord et commerçants.
A Yathreb, deux grandes tribus juives avaient été mêlées aux querelles des deux groupements arabes, les Aws et les Khazraj qui, épuisés, s’étaient réconciliés. Ces tribus juives ont eu une grande influence sur l’esprit du prophète durant les deux premières années de sa vie à Médine ; alors que l’inspiration chrétienne avait été dominante dans les dogmes du début de la révélation, ce sont des faits juifs qui s’imposent à la nouvelle pratique du culte musulman : dans la prière rituelle, on se tourne vers Jérusalem et on jeûne Achoura (Tichri).
Les Aws et les Khazraj, venus à La Mecque pour les cérémonies païennes du pèlerinage, entrèrent en relation avec Mahomet, se convertirent. Il prépara désormais son départ, dont les Koréichites ne semblent avoir compris la gravité qu’à la dernière heure. Le 20 juin 622 (hégire, début de l’ère musulmane), le prophète, accompagné d’Abou-Bekr et d’un chamelier, s’enfuit de La Mecque et parvint à Yathreb. Il fut rejoint à Médine, désormais « Cité du prophète », par plusieurs familles fidèles… ».
En quelques phrases, l’équipe dirigée par Paul Augé a parfaitement résumé l’essentiel de l’affaire. On y retrouve bel et bien le Mahomet méprisé par ceux qui le connaissent – et le prennent pour un fou plus ou moins dangereux – qui tente d’amadouer ses compatriotes de la Mekke puis ceux d’At-Taïf. Rejeté par son clan (celui des Koréichites), assigné à résidence, il parvient à séduire les naïfs habitants de Yattrib (ou Yathreb) qui lui accorderont l’asile à bonne distance de la Mekke. Le même ouvrage des Editions Larousse nous indique également que « …Sa famille, les Hachem, le protégea par sentiment de l’honneur, non par conviction religieuse… ». On y apprend encore que la première bataille qui opposa les Koréichites aux musulmans (le combat de Bedr qui eut lieu après une razzia menée par les hommes de Mahomet sur une caravane revenant de Syrie) fit 63 morts (et sans doute de nombreux blessés). Les auteurs ont également précisé que le dessein intime de toute la vie « religieuse » de Mahomet consistait à faire entrer dans l’islam les sanctuaires païens qu’il avait vénérés tout au long de sa jeunesse, en particulier le petit temple mecquois de la Ka’ba et les autres « lieux saints » de la Mekke (omra).
Les versets « sataniques » ont sans nul doute existé. Les manœuvres « sataniques » des califes, des mollahs, des ayatollahs et des imams ont aussi existé. Elles continuent même à produire leurs sordides effets en ce début du III e millénaire de l’ère dite chrétienne. Et tout cela grâce au coran, grâce à ce livre maudit que l’on peut, globalement, qualifier de « satanique » !
Le mémento encyclopédique comporte, par ailleurs, une rubrique consacrée aux religions et notamment à la religion musulmane (tome 1 – pp.469-471). A propos des cultes préislamiques, on peut que « …la majorité des Arabes étaient païens. Ceux-ci n’adoraient aucune idole façonnée à l’image de l’homme, mais bien des blocs informes de pierre. La divinité des Koréichites, la tribu mecquoise à laquelle appartenait Mahomet, était un morceau de lave ou de basalte, la fameuse Pierre Noire dont l’islam a conservé la vénération et qui est encastrée dans un des murs du temple de La Mecque, appelé la Caaba. Comme dans beaucoup de sociétés primitives, on note dans l’ancienne Arabie des croyances totémistiques, décelées au moins par les noms d’animaux que portaient certaines tribus… ».
L’avis des rédacteurs du Larousse encyclopédique de 1936 rejoignent assez nos propres conclusions en ce qui concerne le fétichisme idolâtre qui est à la base du culte de la pierre noire. Sans doute faut-il voir dans cette « incorporation fétichiste », une dernière tentative de Mahomet pour amadouer les habitants de la Mekke. Ayant dû renoncer à placer les divinités païennes aux côtés d’Allah, il contourna le problème en plaçant la pierre noire de la ka’ba au centre du culte qu’il tentait d’imposer et dont nous venons de voir qu’il fut inspiré par le culte chrétien dans un premier temps et par le culte hébraïque dans un second temps.
L’islam de définitions en définitions
A la lumière des constatations précédentes, il est intéressant - pour le chercheur tout comme pour le simple « curieux » - de s’attarder un instant sur les différentes définitions du coran, de l’islam et de Mahomet que l’on peut trouver dans les dictionnaires et encyclopédies rédigés en langue française et édités par des maisons d’éditions ayant une renommée internationale.
Nous avons pu consulter une vingtaine d’ouvrages de ce type qui ont été édités entre 1900 et le début de notre XXIe siècle, les plus récents étant des versions « multimédia » disponibles sur CD-Rom.
Nous avons été étonnés de la très grande « différence de ton » que l’on constate d’un ouvrage à l’autre, essentiellement en fonction de l’époque où il a été édité. Et pourtant, l’islam ne date pas d’hier : apparu vers l'an 600, cette doctrine a maintenant plus de 1400 ans. On ne peut donc pas dire que les historiens et les spécialistes des religions n’étaient pas en mesure, au début du siècle dernier (c'est à dire au bout de 1300 ans...), de juger le coran, l’islam et Mahomet à leur juste mesure. En fait, c’est de nos jours que les historiens et les spécialistes des religions ont des « trous de mémoire ».
Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que les éditeurs d’aujourd’hui sont animés par une très grande « prudence » (en clair : ils ont la Sainte Frousse) et qu’ils sont, en outre, soumis à des pressions variées. Ceci explique cela.
Nous ne pouvons que regretter ce manque de courage,
d’autant que les dictionnaires et les encyclopédies
demeurent - pour le grand public et bon nombre de professionnels
(enseignants, journalistes,…) la principale source de référence.
En mentant « par omission », les éditeurs
se muent en complice des islamistes, en valets de l’islam. Du
même coup, ils deviennent des agents actifs dans le processus d'érosion des valeurs liées
à la laïcité, à la libre pensée et
au respect des droits imprescriptibles de l’homme, de la femme
et de l’enfant.
Il a été créé en France un délit de « racolage passif ». S'il existait un délit international pour « islamisation passive », quelques rédacteurs de dictionnaires et d'encyclopédies pourraient aller tailler le bout de gras avec leurs gentils camarades scouts que les Américains ont généreusement invité à un sympathique jamboree tout frais payés sur l'île de Guantanamo.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de reproduire les définitions que l’on peut trouver dans toute une série d’ouvrages à caractère encyclopédique. Nous reproduisons la plupart de ces textes à la fois en fac-similé et « in extenso » en les assortissant, si nécessaire, de quelques commentaires. Tous ces ouvrages peuvent être consultés dans de très nombreuses bibliothèques, ce qui permet de vérifier nos sources. Ils démontrent que la plupart des affirmations qui découlent de nos analyses sont confirmées par des textes rédigés par de très éminents spécialistes et ce, depuis longtemps déjà. Car il est connu que l’on ne confie pas la rédaction des dictionnaires et des encyclopédies au premier venu. Il n’y a guère que dans le monde arabo-musulman que l’on puisse accepter l’idée de prendre pour ouvrage de référence, et qui plus est pour ouvrage de référence dans TOUS les domaines, un livre dicté par... un illettré !
Nous débuterons cette étude comparative avec les définitions que l’on peut trouver dans le « Nouveau Larousse illustré » en 7 volumes datant des environs de 1905. Comme toujours, à cette époque, le terme « islam » renvoie au mot « islamisme » qui constitue la définition proprement dite. L’islam est le mot qui qualifie la religion musulmane ou, de façon plus générale, la communauté des musulmans, considérée dans son ensemble. En fait, « islam » et « islamisme » sont synonymes.
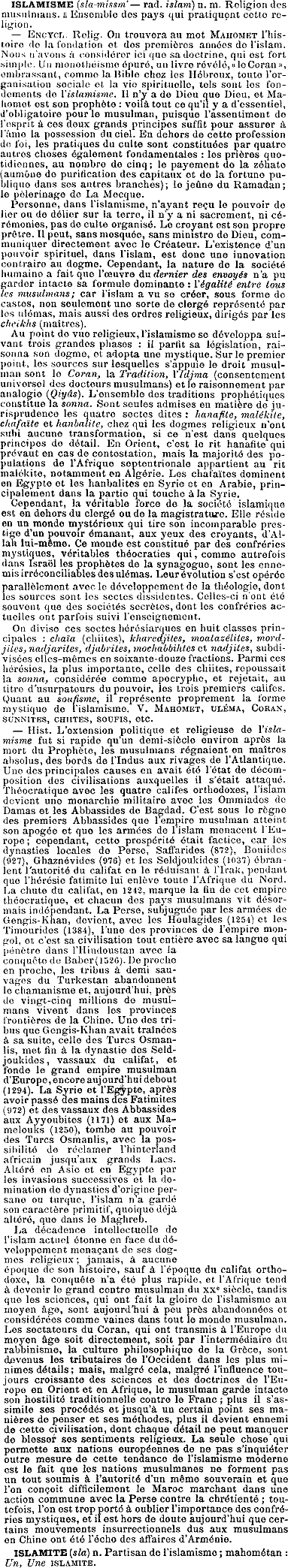 |
ISLAMISME (sla-missm' — rad. islam) n. m. Religion des
musulmans. || Ensemble des pays qui pratiquent cette religion. |
Cette définition datant d’il y a tout juste un siècle est intéressante à plus d’un titre, surtout dans sa troisième partie dont nous pouvons constater de nos jours l'extrème lucidité de celui qui l'a rédigée. Il est certain qu'actuellement aucune maison d’édition, pas même la maison Larousse (qui appartient à présent au groupe Hachette-Lagardère), n’oserait publier une telle analyse prospective. Nous verrons, en observant l’évolution des définitions que nous avons cru utile de reproduire, qu'en fait ils n'osent même pas publier ce qui se révèle au bout d'un siècle être exactement ce qu'ils avaient eux-même prévu.
C'est le monde à l'envers : tandis qu'une Elisabeth Teissier, un Jean-Charles de Fontbrune, un Paco Rabanne et des légions de voyants myopes comme des taupes nous inondent années après années avec des cohortes de livres bourrés de prédictions se révélant toutes plus grand-guignolesques et plus fausses les unes que les autres, les prévisions des encyclopédistes qui se révèlent maintenant parfaitement exactes et que tout un chacun peut vérifier sont, elles, censurées !
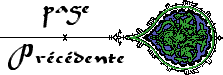 |
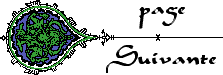 |