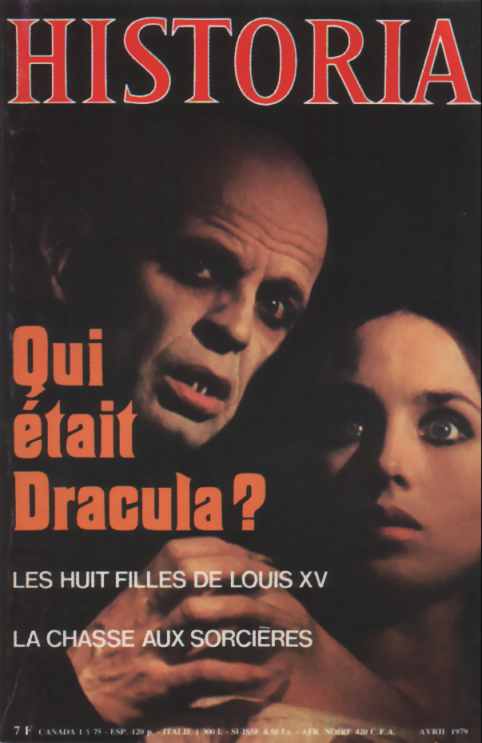
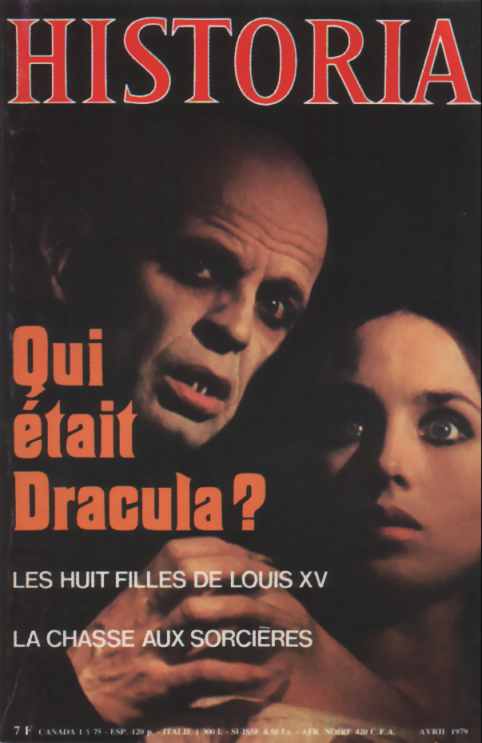
Ce numéro contient un dossier de 10 pages sur Mahomet.
ANDRÉ MIQUEL
Professeur au Collège de France
Nos lecteurs n'ont pas oublié les importants articles où Jean Guitton et J.-R. Armogathe ont évoqué la figure et l'historicité de Jésus qui sert de base à la croyance de neuf cent cinquante-quatre millions de chrétiens. De son côté, l'Islam, avec ses cinq cent trente millions de croyants s'inspire de Mahomet. Contrairement à l'usage, il faudrait écrire non l'épopée de Mahomet, mais l'épopée muhammadienne, c'est-à-dire celle de l'homme, Muhammad, qui a fondé une religion. Ce monde de l'Islam qui, aujourd'hui, par les problèmes du Proche-Orient, par sa position dans diverses parties du monde, par sa puissance pétrolière, par le drame qui ébranle l'Iran, agit sur tous nos destins, on ne peut le comprendre que si on le replace dans son contexte religieux, si on définit les notions d'islam et d'arabisme. L'étude en est naturellement austère mais elle donne les clefs d'une civilisation qui nous touche chaque jour. Aussi nos lecteurs nous sauront gré de l'aborder. L'auteur de « l'Islam et sa civilisation » (Armand Colin), André Miquel, professeur au Collège de France, dont on connaît les importants travaux sur la civilisation arabe, en donne la synthèse. Elle est précieuse en ces jours où se dessine, dans le monde musulman, une réaction religieuse contre le modernisme.
En vingt ans, servi à la fois par les circonstances et par un génie exceptionnel, un Mekkois nommé Muhammad va se hausser au rang de prophète d'une religion nouvelle, et surtout fonder une organisation temporelle dont l'élan bouleversera la face entière du Vieux Monde.
L'enfant choisi pour la nouvelle Révélation est né à La Mekke, sans doute vers 570. Il passe, en nourrice, les cinq premières années de sa vie au désert. Comme Jésus, la tradition le fait pauvre : à la mort de sa mère, il n'hérite que d'une esclave, de quelques moutons et de cinq chameaux ; il est recueilli par son grand-père, puis par son oncle paternel, dont le fils, Ali, sera un de ses premiers disciples.
II n'est âgé que de sept ans alors, mais il a reçu les marques de la prédestination : la clarté divine s'est posée sur son père au moment même de la conception de l'enfant et, comme Marie, sa mère a échappé à certains stigmates de la maternité. Lui-même arrive au monde dans une lumière surnaturelle qui affole les étoiles et incendie les palmeraies. Satan s'inquiète mais, au désert, deux anges ouvrent la poitrine de Muhammad, en retirent le signe du diable et le marquent aux épaules de celui de la prophétie.
Protégé par Dieu des périls de la jeunesse, il est gardien de moutons puis, à vingt-neuf ans, caravanier au service d'une riche veuve, Khadidja, de dix ans au moins son aînée, qui l'épouse : union heureuse dont survivra une fille, la très aimée Fatima, plus tard mariée à Ali.
C'est alors que Muhammad ressent les premières atteintes de la révélation : méditation, retraites, marches autour de La Mekke, visions, appels, puis un silence d'au moins deux ans, « la nuit », avec ses tentations de la folie et du suicide.
Enfin, sur le mont Hira, vers les années 612, dans une autre nuit, « bénie » celle-là, c'est, du 26 au 27 du mois de Ramadan, l'éblouissement suprême, l'apparition qui lui ordonne, malgré ses protestations d'humilité :
- Prêche, au nom de ton Seigneur ! Les révélations se multiplient, violentes, et Muhammad redoute ces irruptions qui l'épuisent, il s'interroge, se voile à l'approche du Dieu :
- O toi qui t'enveloppes de ton manteau ! Debout ! Avertis ! Ton Seigneur, magnifie-le ! Tes vêtements, purifie-les !
Peu à peu, pourtant, il se rassure sur l'origine des ordres qu'il reçoit et commence à s'en ouvrir à un petit nombre d'intimes : Khadidja d'abord, le premier confident, le plus ferme soutien, et les quatre futurs califes : Ali, Uthman, surtout Umar et Abu Bakr.
Umar, longtemps farouchement hostile, ne se convertira qu'en 616, mais alors son énergie et son autorité morale seront pour le jeune Islam des atouts décisifs.
Décisif aussi l'appui d'Abû Bakr, un des premiers gagnés : la communauté des débuts vivra pour une bonne part sur sa fortune, et son exemple de grand marchand converti sera d'autant plus précieux que la prédication de Muhammad, né et resté humble malgré l'ascension sociale qu'il doit à Khadidja, ne touchera guère, d'abord, en dehors du cercle des intimes, que les petites gens, artisans, ouvriers, esclaves, chrétiens ou judaïsés, bref tous ceux qui vivent en marge de l'oligarchie mekkoise, méprisés et exploités.
Le courroux de l'aristocratie a sans doute ainsi, pour raison première, la composition de la communauté musulmane à ses débuts : ou des gueux ou des traîtres. Car, pour le reste, la prédication de Muhammad, purement religieuse, ne remet pas en cause les fondements de la cité.
Un thème la domine : celui du châtiment que doivent valoir aux Arabes, selon l'exemple des peuples disparus sous la colère céleste, leurs habitudes idolâtres, impies à l'égard d'un Dieu unique et généreux.
Mais il n'est pas question de changer l'édifice social ni même ses pratiques culturelles : si Muhammad prie souvent seul ou avec ses fidèles, il se mêle aussi à ses compatriotes païens dans leurs coutumes de dévotion à la Ka'ba, à la pierre noire et à la source de Zemzem. Il élargit ainsi, à l'occasion, le cercle de sa prédication, tout en montrant déjà que l'on peut ne rien toucher à un rituel en place pourvu qu'on consente seulement, dans une intention nouvelle, à le rapporter à Dieu seul.
L'hostilité des Quraych ne désarmant pas, la petite communauté va connaître l'exil : vers 615, un premier groupe de fidèles se réfugie en Abyssinie, cependant que Muhammad cherche des appuis en Arabie même. Débouté à Ta'if, il se tourne vers Médine, où vivent côte à côte une puissante communauté juive et deux tribus arabes d'origine yéménite.
L'accord conclu, Muhammad et ses partisans quittent La Mekke : c'est l'exil, l'Hégire, qui sera prise, environ dix-sept ans après, comme le début de l'ère islamique.
Tournant décisif, en effet : de simple prédicateur, Muhammad devient le chef d'une association nouvelle où vont se distendre les vieux liens de la tribu. Par le contrat d'allégeance, émigrés mekkois et alliés de Médine, s'ils ne rompent pas tous les liens avec leurs groupes d'origine, leur en superposent au moins un autre, celui d'une croyance commune représentée par un chef unique et incontesté.
Ce chef lui-même évolue : il a maintenant l'assurance que lui donne un
passé déjà prestigieux, avec ce voyage nocturne notamment, pendant
les dernières années de La Mekke, où il a été ravi en extase au-dessus
de Jérusalem et jusqu'au septième siècle [lire : septième ciel] .
Khadîja morte en 620, il s'est engagé dans la voie de la polygamie, consolidant, par ses mariages, les liens existants et en créant d'autres; sa situation conjugale devient affaire d'État et même de Coran. A sa voix et à son exemple, la communauté s'organise, des coutumes s'instaurent, qui deviendront, plus tard, sources du droit et du rituel.
Et déjà, l'Islam forge, dans les luttes, ses victoires décisives. Déçu par l'entêtement des juifs, Muhammad, avant de se défaire d'eux par l'expulsion ou le glaive, change l'orientation de la prière : Jérusalem est abandonnée pour La Mekke.
Double symbole : l'Islam n'entend décidément pas se réduire à un quelconque héritage judéo-chrétien, ni oublier qu'il doit un jour revenir au sanctuaire d'où il est parti : affirmation qui inquiète d'autant plus les Mekkois que l'Islam passe aux actes.
La rancune, un atavisme bédouin renouvelé à l'idée de la guerre sainte contre l'idolâtre, le désir d'accroître les ressources de la communauté médinoise et d'en souder, par l'épreuve des armes, les deux fractions, autochtone et immigrée, expliquent la politique de razzias menées contre les caravanes quraychites.
La jeune communauté a son Valmy : Badr, en l'an 2 (624), et ses revers : Ohod. Le tournant est le siège de Médine, que les Mekkois doivent abandonner. De longues tractations débouchent sur une trêve, dont Muhammad profite pour assujettir, au nord, l'oasis juive de Khaybar, passer traité avec des tribus et des groupes chrétiens et envoyer vers la mer Morte une armée qui sera défaite par les Byzantins.
En 8 (630) enfin, profitant d'une situation favorable, les troupes médinoises s'emparent de La Mekke sans coup férir : le Prophète entre dans la Ka'ba, détruit les idoles et reçoit l'allégeance de la cité, convaincue, à défaut de foi, qu'elle assure ainsi la paix de ses caravanes.
Dès lors, la grande histoire de l'Islam est en marche. Elle passe évidemment par l'unité de l'Arabie : au pouvoir de Muhammad, installé à Médine, se rangent Ta'if, puis des tribus de plus en plus nombreuses, du Najd jusqu'aux marges du Yémen. Mais aussi, réaffirmation des visées vers le nord : même vaincue par la chaleur, l'armée, qui sous les ordres du Prophète s'en revient des parages du golfe d'Aqaba où elle était parvenue sans combat, a montré les voies de l'expansion future.
Et c'est l'année 10 (632) : Muhammad, dont les forces déclinent, accomplit le Pèlerinage, en fixant par ses gestes le rituel pour l'avenir, et demande, dans diverses harangues plus tard regroupées sous le titre de prône de l'Adieu, aux croyants assemblés, quitus de sa mission.
Revenu à Médine, il implore le pardon de ses frères, attend la fin avec sérénité et la reçoit dans les bras d'A'icha, son épouse de dix-huit ans ; fidèle à tant d'humilité, l'histoire n'a pas retenu le jour exact de cette mort.
Le débat est depuis longtemps ouvert, pour Muhammad comme pour tout homme exceptionnel, des parts respectives de la personne et de l'histoire. La tradition musulmane exalte évidemment la prédestination du Prophète, en un portrait d'ailleurs touchant, plus vrai et moins systématiquement idéalisé qu'on ne croirait : comme Dieu le lui fait dire par le Coran, il n'est qu'un homme, objet de faiblesses, de doutes ou d'inquiétudes, et ses vertus cardinales en apparaissent d'autant mieux.
Il reste, aux yeux de l'historien, que la moins contestable de ces vertus fut le succès. Si inspiré, si grand soit-il, Muhammad intervient à une époque où la société de l'Arabie traditionnelle se transforme, notamment en ces villes où se développe une classe d'artisans et d'esclaves exploités par l'oligarchie marchande, sensibles à la contradiction qui oppose le système officiel des valeurs et la réalité de distances sociales accrues par l'extension du phénomène monétaire.
Ces tensions, toutefois, n'expliquent pas à elles seules que le succès de Muhammad ait débordé largement les villes et leurs campagnes pour gagner peu à peu le désert : car, même plus réticents, moins fondamentalement imprégnés par la foi nouvelle, ce sont les Bédouins qui vont assurer les premiers grands triomphes de l'Islam.
Ici interviennent, mais amplifiées, les constantes, les « structures » économiques de la vie au désert. En un sens, le système caravanier établi à l'initiative des marchands citadins avait fixé, en reconnaissant l'usage de la taxe de protection, ce besoin séculaire de l'incursion qui est l'une des caractéristiques bédouines.
Mais l'usage de la razzia subsistait, notamment de groupe à groupe : à cet usage, l'Islam va donner la dimension nouvelle de l'expansion, vocation étemelle du nomade vers les terres riches : les oasis juives de l'intérieur, d'abord, puis le Croissant Fertile, puis encore l'Orient et la Méditerranée.
Des deux vocations traditionnelles de la vieille Arabie, la sédentaire du Sud et la bédouine du Centre et du Nord, c'est donc la seconde, servie par le déclin yéménite, qui va servir de moteur à l'expansion. Culturellement, le succès de l'Islam s'explique sans doute par une réponse à des inquiétudes religieuses latentes, mais aussi par son accord profond, même s'il la remodèle, avec une tradition qui lui préexiste.
Tradition « nationale », d'abord : contrairement au judaïsme et au christianisme, religions étrangères et restées isolées, l'Islam, lui, est fils de l'Arabie, et il parle sa langue ; avec lui, l'unité ne tente plus de s'imposer du dehors, elle est consentie d'instinct.
Tradition « littéraire », ensuite : le Coran emprunte son expression non à un quelconque dialecte parlé, mais à un langage poétique, intertribal de surcroît ; par là, il ne fait pas que rechercher le plus grand dénominateur commun dans l'ordre de la compréhension possible, il se présente, davantage encore, comme un ennoblissement : celui que confère, à quiconque en récite le texte, non pas même l'usage d'un idiome bénéficiant de tout le prestige traditionnel de la poésie, mais la sublimation de cet idiome en une forme exemplaire parce que divine.
Avant d'être le germe de futurs principes littéraires, l'inimitabilité coranique est celui de l'unité, conçue comme la possession d'une valeur indivise à tout le groupe et inaccessible à tous les autres.
Plus qu'une révolution, l'Islam apporte ainsi un équilibre aux contradictions dont souffre la société arabe du VIIe siècle. Il reprend de nouvelles aspirations : religieuses, égalitaires, unitaires ou, plus simplement, au mieux-être ; mais il ne rompt pas pour autant avec quelques-unes des vieilles habitudes de la péninsule, en particulier avec la razzia.
Devenue la conquête, elle permettra, elle aussi, en un sens, de surmonter les tensions sociales, en offrant indistinctement à tous, aux pauvres comme aux autres, pourvu qu'ils paient de leur personne, la chance de devenir, dans les pays conquis, les nouveaux seigneurs d'une féodalité nouvelle. Ici aussi on se battra « pour se faire honneur, pour faire son chemin et sa fortune ».
A toutes ces tendances, ataviques ou récentes, plus ou moins nettement ressenties, l'Islam donnera une expression. Certes, on n'expliquera pas ainsi l'irruption de ces mystères qui ont nom foi, prophétie, apostolat, et tant d'autres attitudes où la démarche inconsciente se dérobe toujours aux regards. Mais au moins comprendra-t-on, en dehors d'une optique trop sereinement providentialiste, pourquoi ces mystères ont réussi.
Sans doute ces vues sont-elles exactes : l'histoire de l'Islam ne s'inscrit pas au ciel, hors de la société des hommes. Phénomène global, l'Islam demande, commence à être étudié non seulement en ses formes religieuses, mais, tout autant, dans le contexte de son économie, de sa vie collective ou quotidienne, de sa culture profane.
Il reste toutefois que c'est lui et lui seul, en tant que phénomène religieux, qui donne sa marque originale à la civilisation qu'on désigne sous son nom. Plus que toutes, son histoire est faite d'événements auxquels on chercherait en vain une autre origine qu'une préoccupation religieuse ou philosophico-religieuse.
Pour ces raisons, la connaissance de l'Islam est préalable à toute étude de son histoire.
L'Islam, en premier lieu, c'est une histoire de la Révélation. Entamée avant lui, c'est en lui néanmoins qu'elle trouve sa forme suprême : la plus claire, la plus complète, achevée, par conséquent dernière. Muhammad, le dernier venu, est « le sceau des prophètes », dont il clôt pour toujours la série.
Avant lui, Abraham, Moïse et Jésus dominent le cours de la Révélation. Le dernier, surtout, est particulièrement honoré : dépositaire de l'esprit de lumière et de sainteté, nouvel Adam né d'une vierge consacrée au Seigneur, il a échappé au supplice que lui préparaient les juifs; en lui substituant un autre homme sur la croix, Dieu l'a élevé jusqu'à lui.
le Coran ouvre ainsi la voie aux initiatives des exégètes, qui développeront le thème dans le sens du messianisme : Jésus reviendra sur Terre à la fin des temps pour tuer l'Antéchrist et inaugurer un règne de justice.
Mais, si grands soient-ils, les prophètes restent des hommes, de simples envoyés de Dieu réduits, comme Muhammad, à un rôle d'annonciateur des vérités essentielles et des châtiments réservés à ceux qui les ignorent. Et parce qu'ils ne sont qu'hommes parmi les hommes, ils se heurtent à l'incrédule hostilité de leurs semblables, dont l'attitude précipite le châtiment un instant suspendu à la voix du prophète.
Les prédications sont donc, chaque fois, les heures de la dernière chance, et l'histoire de la Parole est indissolublement liée à celle du Châtiment ; Noé et le déluge, Loth et la pluie de pierres, Hûd, le prophète de l'Arabie du Sud, et la tempête : autant de signes que Muhammad invoquera dès les débuts de sa mission.
Si la Révélation est close sur ce dernier avertissement, on voit que l'Islam, en bonne logique ramènera toujours, en cas de doute, la vérité aux principes une fois pour toutes affirmés par son prophète : pratiqué ou prétexté, le retour aux sources sera ainsi une démarche fondamentale de l'orthodoxie musulmane.
Inversement, la pensée schismatique qu'on appelle ici chî'ite refusera, sinon d'admettre le silence définitif de Dieu lui-même, du moins de s'en tenir au sens apparent du texte sacré et elle fera, de l'interprétation allégorique ou symbolique de son sens caché, le prolongement normal de la Révélation coranique.
Face à la jâhiliyya (ignorance, paganisme, mais aussi « barbarie ») des anciens Arabes ou des peuples étrangers, la religion nouvelle se définit comme un acte de soumission (islam) à Allah, maître du monde et de la vie.
Dieu rétributeur, d'abord : au jour du Jugement, et même dès la tombe, les âmes des méchants connaîtront, sans intercession possible, le prix de leurs péchés, au seul vu des comptes qui en sont gardés.
Mais Allah est compatissant, accessible à la pitié pour peu que l'homme se repente : grâce essentielle que rappelle la formule de l'invocation, à chaque instant de la vie du croyant :
« Au nom d'Allah, le Bienfaiteur, le Miséricordieux! »
A ces deux noms fondamentaux, le Coran et la tradition en ajoutent quatre-vingt-dix-sept autres : au total cent, avec celui même d'Allah, pour désigner, sous des variantes multiples, l'éternité, la toute-puissance et l'omniscience, mais, par-dessus tout encore, l'unité de Dieu, dogme central de la foi musulmane et pierre d'achoppement avec le christianisme : « Dieu n'a pas été engendré, pas plus qu'il n'a engendré », et Jésus porte témoignage contre son peuple coupable de l'avoir divinisé.
Chrétiens et juifs, pourtant, sont détenteurs de l'Écriture, « gens du Livre », et Muhammad a espéré, en un temps, leur conversion à un message qui se présentait comme le prolongement du leur.
Mais l'entêtement doctrinal des chrétiens, la résistance politique des juifs, les dangers que leurs critiques représentaient pour certains hésitants de la communauté musulmane ont entraîné un changement de point de vue, transcrit dans les faits, on l'a vu, par la substitution de La Mekke à Jérusalem comme pôle de la prière.
Désormais, chrétiens et juifs sont les faussaires de l'Écriture, qu'ils ont adultérée, jusque dans la lettre des textes, afin de diluer, dans leurs égarements, le sens, pourtant clair, du message de l'unité et de l'universalité divines. Gaspilleurs de leurs chances, restés à mi-chemin de la vraie foi, ils seront tolérés, protégés même, mais toujours un peu comme des croyants de seconde zone : situation que sanctionne leur statut social.
L'Islam est donc, après les malfaçons du judaïsme et du christianisme, l'avènement enfin réussi d'un monothéisme sans compromission. Ce sera une constante, peut-être même la définition fondamentale de l'orthodoxie musulmane, que la hantise du polythéisme, du chirk, littéralement « l'acte d'associer », sous-entendez : d'autres réalités à la substance divine.
Hantise qui fera, des attributs de Dieu, un redoutable problème posé à la conscience des croyants. Au propre, Allah est l'inconnaissable, l'indéfinissable dont on ne peut dire : il est ceci ou cela, mais : il est, tout simplement. Entre un Dieu ainsi enfermé dans une transcendance jalouse et un homme défini comme son esclave, il ne peut y avoir aucun intermédiaire possible, et le temple devient, selon l'heureuse formule de Gaudefroy-Demombynes, « la maison vide du Dieu partout présent ».
Pour le musulman, écrasé sous le poids du mystère auquel il doit se livrer sans espérer rien en connaître, la foi (imam) est décidément la vertu cardinale.
L'ensemble de la Révélation, que Dieu a fait descendre sur son Prophète par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, se trouve consigné dans le Coran : lecture, récitation.
Reproduction d'un archétype céleste, le texte sacré se décompose en cent quatorze sourates, elles-mêmes réparties en versets (ayât, littéralement : signes, miracles). Versets et sourates sont, au reste, de longueur inégale. En gros, le Coran suit un ordre contraire à la chronologie de la Révélation : les sourates les plus amples, celles où Muhammad, devenu chef de la communauté musulmane, légifère autant qu'il prédit, sont situées en tête du livre. A une exception près : le texte s'ouvre sur une sourate courte en sept versets, dite liminaire, qui est un peu le « Notre Père » des musulmans, et dont la tradition recommande une récitation aussi fréquente que possible.
Quant aux sourates courtes, elles se trouvent groupées vers la fin du livre : c'est là, dans le secret des rythmes et des sons, qu'il faut chercher les modèles de la somptuosité coranique, si chargé d'échos, si magique que Dieu devra intervenir pour défendre son prophète, accusé d'être un devin ou un poète possédé.
Quand le ciel s'entrouvrira,
Quand les planètes se disperseront,
Quand les mers seront projetées hors de [leurs rivages
Quand les sépultures seront bouleversées,
Toute âme saura ce qu'elle aura amassé pour [ou contre elle.
Le succès de la prédication était peut-être inscrit dans des pages aussi exemplaires ; mais il ne devait pas, à lui seul, résumer le fait coranique. Car, au-delà du phénomène religieux, toute la vie culturelle du Moyen Age d'expression arabe se trouve impliquée dans l'apparition de ce texte essentiel. le Coran, en effet, ne consacre pas seulement une religion, mais une langue, l'arabe, et cela sous trois formes.
Comme véhicule de la Révélation, l'arabe devient manifestation divine, intouchable donc : on comprend les longues réticences de l'Islam à admettre les traductions du Coran en langues « barbares », tout comme son souci de fixer à jamais l'écriture, le vocabulaire et les structures morphologiques ou syntaxiques de l'arabe.
Conservateur par tempérament, autant et plus que les autres langues sémitiques, et protégé de surcroît par d'aussi formidables interdits, l'arabe classique traversera les siècles, au moins jusqu'au nôtre, sans concessions ni inquiétudes majeures.
Mais le langage n'est pas que l'expression d'une foi, il est aussi l'âme d'un peuple : en affranchissant les Arabes de la servitude qui avait lié jusqu'alors la Révélation à une langue étrangère, juive surtout, en leur rendant, pour l'accès à cette Révélation, l'usage de leur langue propre. Dieu fait plus que les réconcilier avec la vérité, il les fait se trouver eux-mêmes : le Coran devient un événement national autant que religieux.
Un peu plus ou autrement, du reste, que Muhammad ne l'avait prévu : car, si les Arabes, dans l'histoire, ont effectivement saisi et exploité ce langage, sanctionné par la Révélation, comme un des plus sûrs fondements de leur originalité, c'est au prix d'un gauchissement de la pensée coranique.
Certes, la prédication s'appuyait bien sur une ethnie dont elle empruntait la langue et à qui elle permettait ainsi de prendre sa propre mesure, mais ce n'était ni en vertu d'un privilège spécial et gratuit de Dieu, ni pour toujours.
La Révélation n'avait pas choisi les Arabes ni leur langage en tant que tels, mais parce que ce langage avait été, par Dieu, jugé le plus apte à exprimer le message de son unité.
D'où il s'ensuivait que, langue la plus claire possible, l'arabe recevait une vocation universelle, tout comme le message même qu'il était chargé de transcrire ; d'où il s'ensuivait aussi que l'ethnie originelle était conviée, à travers son langage, à s'étendre aux dimensions de l'univers, à se fondre dans l'humanité entière et croyante, dont elle aurait eu l'honneur d'être le premier noyau.
S'il est donc bien, au départ, un idiome national, réservé à un groupe déterminé, l'arabe se voit tout de même, tant en raison de ses qualités intrinsèques que de sa destinée universelle, consacré par le Coran comme la forme parfaite des langages humains.
« Illumination sublime et sage, exempte de tortuosité », trésor commun au-delà des ethnies : tel le fera en effet, au moins pour un temps, la civilisation internationale du Moyen Age musulman.
Autre conséquence du fait coranique, mais sur un point particulier cette fois : celui des lettres arabes. Le langage qui se trouve ainsi consacré comme expression d'une croyance, d'un peuple et d'une civilisation n'était pas, on l'a vu, un dialecte, du Hijaz ou d'ailleurs, mais une koinè poétique, en d'autres termes une langue de prestige.
le Coran instaure ou confirme ainsi, de tout son poids, le modèle, entre langage parlé et langage écrit, dialectes et langue savante, littérature populaire et littérature enregistrée, une coupure décisive qui ira en s'aggravant avec les siècles, jusqu'à la crise moderne.
L'Islam, tel qu'il se dégage du Coran ou tel que l'en dégagera la tradition, repose sur cinq « piliers ». La profession de foi est, par excellence, l'acte de conversion à l'Islam. « II n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est l'envoyé d'Allah » : la formule, récitée dans les circonstances les plus graves de la vie, trouve une forme suprême dans le témoignage du martyre.
La prière, précédée des ablutions rituelles, est dite à cinq moments de la journée : aube, midi, après-midi, coucher du soleil, soir. Prier en commun est toujours recommandé et prescrit le vendredi : on s'assemble alors à la mosquée, face au mihrab, niche décorée indiquant la direction de La Mekke. L'iman, qui se place devant l'assemblée des fidèles, n'est que le guide de la prière collective, et non prêtre à quelque degré que ce soit. Pièce essentielle de la réunion du vendredi : le sermon, prononcé en chaire.
Le jeûne est explicitement défini par le Coran comme une continuation de la loi juive et chrétienne. Néanmoins, pour le distinguer de ces antécédents, Muhammad finira par lui assigner une date spécifique : Ramadan, mois de la Révélation, mais peut-être aussi mois sacré chez les anciens Arabes.
Au passage, détail de calendrier : lorsque le Prophète abandonnera, en 10 (632), afin de se couper des coutumes de l'Arabie païenne, la pratique du mois intercalaire utilisé, tous les deux ou trois ans, pour combler la différence entre le comput solaire et les douze mois de vingt-neuf ou trente jours. Ramadan, « le feu du ciel », se déplacera régulièrement à travers les diverses périodes de l'année.
L'immobilité saisonnière du jeûne s'ajoute ainsi aux inconvénients d'une coutume qui, en ralentissant les activités diurnes, perturbe l'existence quotidienne et même, aujourd'hui, l'économie des nations. Malgré tout, l'usage résiste, car l'Islam y trouve une de ses plus hautes expressions spirituelles et, plus encore peut-être, communautaires : cohésion que souligne, à la fin du jeûne, une des manifestations les plus honorées de l'Islam : le îd aççagjir ou « petite fête ».
Plus honorée, du reste, que la grande, qui sanctionne l'autre rassemblement, physique celui-là, des croyants : le pèlerinage aux lieux saints de La Mekke, recommandé à tout musulman dès qu'il en a la force et les moyens.
Sur les lieux et avec des rites hérités de l'Arabie païenne, mais reconvertis à l'adoration du Dieu unique, le hajj rassemble, du 7 au 13 du mois de Dhu l-hijja, le dernier de l'année musulmane, des pèlerins venus du monde entier.
Au centre de leurs dévotions, la Ka'ba, de plan rectangulaire, parée d'un voile de brocart que l'on renouvelle tous les ans; encastrée dans un de ses angles, la pierre noire ; à côté, dans l'enceinte, la source de Zemzem et la pierre d'Abraham, sur laquelle le patriarche monta pour réparer le faîte du temple.
L'ensemble du territoire de La Mekke est tabou et les pèlerins, pour y accéder, revêtent, à certaines stations déterminées de leur route, le costume de sacralisation : deux pièces d'étoffé ne comportant aucune couture. Vêtement uniforme, participation collective aux rites, identité des interdits, sexuels ou autres : ici véritablement se forge, au-delà des nations et des langues, le sentiment d'une communauté.
L'aumône peut être interprétée comme une reconversion, dans un sens spiritualiste, des vertus traditionnelles de générosité et d'hospitalité pratiquées par l'Arabie païenne. Pour l'Islam comme pour d'autres religions, le malheureux a une créance sur le riche, lequel, pour s'en libérer, doit « purifier » son bien en le reversant en partie sur les indigents, les esclaves, les orphelins et les voyageurs.
Ce devoir de charité comporte une part laissée à l'initiative volontaire et secrète de l'individu et une autre institutionnalisée, sous la forme d'une contribution du croyant aux dépenses de la collectivité : face aux ressources extérieures - prises de guerre, confiscations, impôt de capitation payé par les juifs et les chrétiens - l'aumône légale représente l'effort de la communauté sur elle-même.
Tels sont les piliers ou emblèmes de l'Islam. Les auteurs y ajoutent parfois le jihad, littéralement l'« effort » pour le règne de Dieu : effort personnel de dignité ou d'ascèse, mais, plus souvent, participation à l'oeuvre communautaire par excellence, à la lutte armée pour l'expansion ou la défense de l'Islam.
Les préceptes du Coran et l'exemple du Prophète, perpétué par la tradition, ont fait de l'Islam une croyance active, intégrée à la vie de l'individu et de la communauté, liant étroitement le religieux au quotidien, au social et au politique. Ainsi l'Islam a-t-il connu et posé, au moins autant que les autres confessions, le problème de la foi et des oeuvres.
Il aura, certes, lui aussi, ses quiétistes, ses laxistes et ses pharisiens, mais, en règle générale, il décrétera que seule la foi et l'intention peuvent vivifier les oeuvres, au demeurant indispensables : association du matériel et du spirituel qu'on retrouve transposée dans l'autre monde, les plaisirs quotidiens et sensuels s'accompagnant, pour les élus, de ces béatitudes qui ont nom paix, bénédiction et, peut-être, contemplation de la face de Dieu.
L'éthique musulmane combine dans le même esprit, pour l'individu et la collectivité, un ensemble de pratiques où se retrouve, dans l'unité d'une foi qui doit inspirer toutes les attitudes, un double souci d'ascèse spirituelle et d'efforts vers le bonheur de tous.
De la première relèvent les interdits, alimentaires surtout, avec la viande du porc ou des bêtes non saignées, avec les boissons fermentées aussi, dont le Coran condamne au moins l'abus, sinon l'usage.
Quant au souci du bien du plus grand nombre, il apparaît dans une morale à la fois optimiste et communautaire, l'idée générale étant que Dieu veut, ici-bas, le bonheur matériel de son peuple, mais que celui-ci implique le maintien des bonheurs individuels en deçà de l'égoïsme et de l'excès : principes, par conséquent, de justice, sinon d'égalité sociale.
Deux exemples en démontreront la portée pour le temps où ils furent proclamés. le Coran s'est préoccupé de la situation des femmes : il tolère, certes, quatre épouses, mais recommande la monogamie à qui craint « de n'être pas équitable » ; il prescrit une pudeur assez stricte d'où naîtra l'usage régulier du voile, mais protège les épouses contre les abus ou les conséquences de la répudiation.
Il bouleverse même, en faveur des femmes, les règles jusque-là suivies par le droit successoral, plus encore peut-être : en la faisant participer de plein droit à toutes les obligations de la foi - même au pèlerinage, dès qu'elle peut s'y faire accompagner d'un parent - le Coran consacre définitivement, fût-ce avec un brin de condescendance, la dignité de la femme et son droit au bonheur.
En matière économique, le Coran, né dans une ville marchande, ne condamne pas, loin de là, le commerce, la location, la propriété ou le salariat, mais seulement le mauvais usage de l'activité économique, sous la forme du riba : à l'origine, sans doute doublement de la dette non remboursée au moment de l'échéance, puis prêt à intérêt, usure ou, plus généralement, gain exorbitant.
Dans les deux cas cités, certes, la tradition musulmane a connu des aboutissements assez éloignés des principes coraniques : si, pour les femmes, elle semble avoir surenchéri sur les vérités au détriment des libertés et des droits, en matière économique, au contraire, elle s'est montrée étonnamment souple et apte à tourner les prescriptions originelles au profit des impératifs économiques bien compris.
Mais, quelque sens que prenne l'évolution, la vérité de l'Islam - en l'occurrence, de justice sociale et de modération économique - est à chercher dans ses origines : leçon que n'oubliera pas, lorsque son temps viendra, le mouvement réformiste et moderniste.
Droits et devoirs, croyance et prescriptions sociales fondent la communauté des croyants, leur lieu de rassemblement, au spirituel comme au temporel. Il y a ainsi : un temps musulman, que rythment, au calendrier de l'Hégire, les fêtes dans l'année et les prières chaque jour ; une terre musulmane, le dar al-Islam, théoriquement appelé à se grossir peu à peu, par la victoire des armes, aux dépens du voisin étranger, du « territoire de guerre » ; un costume musulman, que symbolisent la tête couverte, le vêtement ample, sans oublier les silhouettes voilées des femmes ; des coutumes musulmanes enfin : prohibitions alimentaires, rites du mariage, attitudes de l'oraison, et ces cimetières que l'orthodoxie veut aussi dépouillés que la foi.
Tout cela innervé, bien entendu, par cette foi elle-même, raison dernière de tant d'habitudes et fondement suprême, fondement unique plutôt, de la communauté, au-delà des groupements tribaux, ethniques, sociaux et linguistiques.
« Les croyants sont frères », proclame le Coran, et la tradition se plaira à rappeler que la première annonce publique de la prière fut faite, en la personne de Bilal, par un esclave noir d'Abyssinie.
Ce sont là, une fois de plus, des principes. Plus tard en effet, l'Islam assimilera son triomphe à celui des Arabes, porteurs privilégiés du message divin, et vainqueurs de surcroît; toute l'histoire des rapports avec les peuples soumis va se résumer à l'acceptation ou à la contestation de la suprématie, ainsi posée, de droit ou de fait.
Schématiquement, ces peuples accepteront la première et récuseront l'autre. Jouant le jeu de l'unité religieuse et linguistique, donnant même aux lettres arabes quelques-uns de leurs plus grands pionniers, ils refuseront toujours d'accepter, sous le couvert de cette allégeance, la prédominance des Arabes en tant que groupe ethnique.
Souvent appuyés eux-mêmes à de solides traditions provinciales ou nationales et forts de leur fidélité à la vocation universaliste et multiraciale de l'Islam, ils opposeront à la tradition profane des Arabes, sous le nom de chu'ubiyya, une manière de patriotisme ou de nationalisme avant la lettre.
En face, ceux qui se veulent originaires de la péninsule en affichent d'autant plus la pure tradition, l'arabicité ou uruba. Mais une pareille éthique n'est pas sans poser à son tour, pour les Arabes eux-mêmes, de sérieux problèmes sur le plan d'un Islam strictement interprété.
Si, pour les étrangers, Islam et arabisme sont en un sens inconciliables, les Arabes, en revanche, ont tendance à considérer la religion comme la forme la plus haute de leur spécificité : interprétation qui, certes, prend ses libertés avec l'idéal d'un Islam universel et communautaire, mais qui n'en fut pas moins, historiquement, une des constantes de la conscience arabe et, pour l'empire temporel de l'Islam, la source de bien des difficultés.
André Miquel
Professeur au Collège de France
Illustrations
Apparition de l'ange Gabriel à Mahomet : « Au nom de ton seigneur qui a créé l'homme de sang coagulé... il a appris à l'homme ce que l'homme ne savait pas... » (Grav. XVIIe siècle).
A g., représenté sur un manuscrit persan (B.N.), Abou-Bekr, ami d'enfance de Mahomet l'un des trois premiers convertis. A dr., Mahomet et le jeune Ali son gendre, triomphent des idolâtres. (Gravure d'Achille Deveria).
La Mekke avec au centre de la mosquée, recouverte d'un brocart noir, la Ka'ba. Tout bon musulman doit aller à La Mekke une fois dans sa vie. La prière, précédée d'un rite d'ablutions avec de l'eau ou, à défaut, du sable, est récitée cinq fois par jour en se tournant vers La Mekke.
Le tombeau de Mahomet à Médine, au XVIIIe siècle. Il y a aujourd'hui environ 550.000.000 de musulmans dont 90 % sont des sunnites ou orthodoxes. Les chî'ites (dont la majorité vit en Iran et en Irak), représentent 8,75% de ce nombre.
Consulter d'autres biographies de Mahomet. |